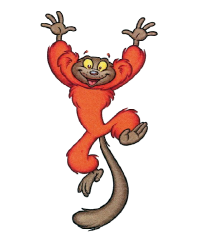Action
en constatation, action en constatation négative, intérêt digne de
protection, action en exécution, action formatrice, opposition,
marque verbale, marque combinée, marque figurative, interprétation
du contrat, principe de la confiance, principe de la bonne foi, droit
d’être entendu, arbitraire, Von Roll, recours rejeté ; art. 9
Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 18 al. 1 CO, art. 3 LPM, art. 14 LPM,
art. 31 al.1 LPM, art. 33 LPM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC,
art. 88 CPC.
L’un
des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll,
s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la
scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre
eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit
d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale
« vonRoll » avec les adjonctions « infratec »,
« hydro », « casting » et « itec »,
en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la
défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces
désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces
enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le
tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit
contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du
tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une
violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al.
2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9
Cst. par l’instance précédente (c. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi
valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la
défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle
aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al.
2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (c. 3). L’action en
constatation de droit vise à faire constater l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur
doit établir un intérêt digne de protection à la constatation
immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature
juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette
condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques
entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être
levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas
suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du
demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave
dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en
constatation négative, notamment, il faut également tenir compte
des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer
de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle
selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur,
de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une
procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il
est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et
les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la
constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose
d’une action en exécution ou d’une action formatrice,
immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement
le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce
sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport
à ces actions (c. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie
l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant
valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition
s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion,
dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des
art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement
limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il
ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure
d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant
valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels.
La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le
même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans
importance dans la présente procédure que la défenderesse soit
habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la
relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse
est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements
litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque
prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut
faire valoir son droit exclusif à l'encontre de la partie
contractante que si celle-ci viole le contrat (c. 3.3). L’argument
de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité
de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire
une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne
peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant
de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à
l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des
différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre
les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt
digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la
procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas
atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans
la relation juridique entre les parties peut être levée par la
décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la
défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (c.
3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se
basant sur l’art. 18 al.1 CO, une interprétation erronée des
conventions passées entre les parties (c. 4). Compte tenu de la
formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux
contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les
parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la
désignation « vonRoll » dans le second contrat, de
restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant,
elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la
demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll »
dans cette orthographe. Le Tribunal fédéral est lié par ces
constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une
concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher
à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des
principes d’interprétation pertinents du droit des contrats,
conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en
effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû
comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain
sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris
cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas
compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au
moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de
l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le
principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout
état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle
permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe
« VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque
verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une
orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en
outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la
première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue
objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans
autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il
ne pouvait être déduit du simple fait de l'orthographe spécifique
utilisée qu'une représentation graphique des éléments du mot,
telle qu'elle était utilisée dans les marques déposées par la
défenderesse, n'était pas contractuellement autorisée (c. 4.3.2).
Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne
peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant,
sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires
« VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne
dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques
sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet
elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant
ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des
marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que
l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords
conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse
ne violent pas les marques verbales "VON ROLL" et "VON
ROLL ENERGY" détenues par la requérante, et que celles-ci ne
font pas obstacle à leur enregistrement (c. 4.4). Le recours est
rejeté (c. 5). [SR]