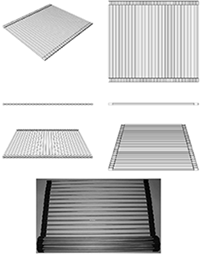sic! 1/2015, p. 24-36, « Botox / Cellcare
Botocare » ; motifs absolus d’exclusion, signes descriptifs, signe dégénéré, force
distinctive, force distinctive originaire, cercle des destinataires pertinents, médecin,
usage de la marque, usage à titre de marque, usage sérieux, sondage, impression
générale, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes
sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des
produits ou services, canaux de distribution, but poursuivi, posologie, usage offlabel,
marque notoirement connue, signe notoire, marque de haute renommée,
force distinctive moyenne, risque de confusion nié, vocabulaire de base anglais,
Care, concurrence déloyale, botox, neurotoxine botulique, Swissmedic, produits
thérapeutiques, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD,
art. 3 al. 1 lit. e LCD.
À l’époque de l’enregistrement de la marque attaquante « BOTOX », la toxine botulique n’était pas connue du grand public. Lors de la commercialisation du produit, la documentation médicale et publicitaire de la requérante associait le signe ® à la marque « BOTOX », de sorte que pour les spécialistes également, ce signe n’avait pas originairement un sens descriptif (c. 2.4.2.1). La défenderesse argue qu’à défaut, le signe « BOTOX » a postérieurement dégénéré en un terme descriptif. Il appert des diverses publications produites à titre de moyens de preuve que le signe « BOTOX » est tantôt utilisé comme abréviation pour la neurotoxine botulique et tantôt comme un terme commercial ou un signe. De manière générale, le terme « botox » est utilisé comme un terme générique et descriptif dans les médias de masse, alors que les publications destinées aux spécialistes distinguent clairement le signe « BOTOX » et la neurotoxine botulique. Il faut donc considérer que pour le grand public, ce terme est général et descriptif et que pour les spécialistes, celui-ci désigne la marque d’un produit en particulier (c. 2.4.2.2 e)). Comme établi précédemment, au moins parmi les spécialistes, la marque de produit thérapeutique « BOTOX » est distinguée de la neurotoxine botulique. Ainsi, le signe « BOTOX » est valable, bien qu’il existe une tendance de cette marque à dégénérer en un terme général et descriptif (c. 2.4.3). Il ressort du « sondage de représentativité » produit par la demanderesse que 87% des sondés connaissent le signe « BOTOX », mais seuls 7% d’entre-deux l’associent au domaine « produit pharmaceutique, médicament, médical ». Les sondés associent bien davantage ce signe avec ses domaines d’application (« rides, traitement des rides, raffermissement de la peau, rajeunissement du visage », « beauté, soins de beauté », « neurotoxine, toxine », « seringue ») et donc avec la neurotoxine en question que comme un signe distinctif, ce qui plaide en faveur de la dégénérescence en un terme générique et descriptif. Pour autant que les sondages réalisés en France en 2003 et en Espagne en 2012 aient été correctement menés, ils ne sont pas propres à illustrer la notoriété du signe en Suisse en 2012. Il ressort du sondage réalisé en Suisse que le signe « BOTOX » n’atteint pas les exigences jurisprudentielles et doctrinales en matière de degré de notoriété. Pareillement, la marque « BOTOX » ne peut pas être qualifiée de marque de haute renommée (c. 2.5.2). En ce qui concerne l’usage de la marque pour les « produits thérapeutiques » en classe 5, le conditionnement dans lequel Swissmedic a autorisé la mise sur le marché du produit n’est pas déterminant. Le fait que le conditionnement du produit « solution à injecter dans les tissus musculaires » soit utilisable aussi bien comme produit thérapeutique et que comme produit cosmétique n’est pas pertinent en ce qui concerne l’usage de la marque. La demanderesse ne vend pas de produits cosmétiques sous la marque « BOTOX ». Le fait que les spécialistes et les consommateurs finaux comprennent le terme « BOTOX » comme une description des produits cosmétiques vendus sous une autre marque, ne constitue pas un usage à titre de marque. Que la demanderesse tolère que ses produits thérapeutiques revendiqués soient utilisés « off-label » dans le domaine cosmétique, ne valide pas l’usage de la marque en classe 3 pour des produits cosmétiques. L’interdiction générale émise par Swissmedic de commercialiser des produits cosmétiques sous la même marque qu’un produit thérapeutique autorisé n’est pas un motif justificatif du non-usage de la marque pour les produits cosmétiques en classe 3. Par ailleurs la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable l’usage de la marque « BOTOLIFT » en classe 3 (c. 2.5.3). Le signe « BOTOX » s’inspire du nom de la neurotoxine « Botulinum toxin ». Pour les spécialistes, mais également pour 27% des destinataires finaux, il est clair que le signe « BOTOX » renvoie à une neurotoxine. Même si seuls 2% des consommateurs finaux sont capables de nommer correctement cette substance, ce lien entre le signe « BOTOX » et le nom de la neurotoxine en question diminue la force distinctive de la marque. La demanderesse prétend que l’usage massif de la marque « BOTOX » aurait augmenté sa force distinctive. Or, pour un produit thérapeutique délivré uniquement sur ordonnance, la publicité est très limitée : elle ne doit s’adresser qu’à des spécialistes, dans des revues ou lors de manifestations spécialisées. De plus, comme déjà mentionné, la presse ne fait pas clairement la distinction entre le signe «BOTOX », le terme générique de « traitement au botox » et de la neurotoxine « botulinumtoxin ». Swissmedic a par ailleurs mené une procédure (C-1795/2009), qui a débouché sur la publication « Toxine botulique de type A », qui limite l’utilisation du terme « BOTOX ». Dans le grand public, « botox » est connu comme terme général et descriptif, mais pas comme une marque ou comme une indication de provenance industrielle. En revanche, les spécialistes connaissent bien la marque « BOTOX ». Compte tenu de ce qui précède, le signe « BOTOX » jouit d’une force distinctive normale (c. 2.5.4). La marque opposante est composée de deux syllabes (BO-TOX), alors que la marque attaquée en compte cinq (CELL-CARE BO-TO-CARE). La première syllabe de la marque opposante est fortement imprégnée par la voyelle « O » et la seconde syllabe par la consonne «X». La suite de voyelles « O-O » diffère de la suite de voyelles de la défenderesse «E-A-O-O-A». Les deux éléments de la marque de la défenderesse se terminent par le mot anglais « care ». Les destinataires connaissent le terme « care » (soins) et par conséquent, ils prononceront la marque attaquée comme un mot anglais. Ainsi, la similarité des signes sur le plan sonore doit être rejetée. Sur le plan sémantique, les éléments « CELLCARE » et « -CARE » de la marque attaquée sont descriptifs des produits revendiqués et de leurs buts. Le signe « BOTOX » désigne une neurotoxine injectée dans les tissus musculaires, il n’y a pas de lien avec les soins de la peau. Il n’y a pas de similarité sur le plan sémantique non plus. Sur le plan visuel, la marque opposante compte cinq lettres, alors que la marque attaquée en dénombre seize. Parmi celles-ci, seule la suite de lettres « BOTO » est reprise par la marque attaquée. L’élément identique « BOTO- » est court, de sorte que de faibles différences suffisent déjà à exclure le risque de confusion entre les signes. Comme dit auparavant, le « X » final de la marque attaquante imprègne fortement l’impression d’ensemble de la marque et se distingue clairement de l’élément « -CARE ». Il n’y a pas de similarité sur le plan visuel non plus (c. 2.5.4.2.). Les marques opposées sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5. Cependant les produits offerts sous les marques « BOTOX » et « VISTABEL » de la demanderesse ne sont disponibles que sur ordonnances de médecins spécialistes, alors que les produits proposés sous la marque « CELLCARE BOTOCARE » de la défenderesse sont en libre accès. Les produits revendiqués ne sont donc similaires ni par leurs canaux de distribution ni par leurs destinataires. Les produits diffèrent par leurs caractéristiques : le produit de la défenderesse est une puissante neurotoxine, alors que la substance active des produits de la défenderesse est l’hexapeptid. Les produits se distinguent également par leur mode d’utilisation : le produit de la demanderesse est injecté dans la musculature, alors que le produit de la défenderesse doit être appliqué sur la peau. En revanche, les produits poursuivent le même but : l’élimination des rides, afin d’obtenir un visage plus jeune. Cependant, il est notoire que dans le secteur des produits cosmétiques, la concurrence est rude. Un risque de confusion indirect découlerait avant tout du recours aux mêmes canaux de distribution et de caractéristiques des produits identiques (c. 2.5.4.3.). Il n’y a pas de violation du droit à la marque de la demanderesse. La marque « BOTOX » n’a pas encore dégénéré en un terme général et descriptif, mais elle n’est pas non plus une marque de haute renommée. Faute d’usage sérieux dans ce domaine, les marques « BOTOX » et « BOTOLIFT » ne bénéficient pas de la protection du droit des marques en classe 3. Il n’y a pas de risque de confusion entre « BOTOX » et « CELLCARE BOTOCARE ». La marque « BOTOX » jouit d’une force normale, car son caractère quasiment descriptif est compensé par son usage intensif dans les cercles de destinataires spécialisés. Il n’y a pas de similarité des signes (c. 2.6). En ce qui concerne le risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, les produits des parties se présentent de manière suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion. En effet, le produit de la demanderesse est distribué aux médecins spécialistes dans des flacons au travers desquels il est possible de piquer (typique des produits injectables), le produit de la défenderesse est commercialisé dans des récipients cylindriques polis et brillants, emballés dans un packaging d’un design moderne. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent que les produits proviennent du même producteur. Le slogan de la défenderesse : « il est possible d’obtenir sans aiguille un effet semblable à celui de la botuline » n’est pas déloyal, car cela ne fait pas référence au produit de la demanderesse, mais à la neurotoxine botulique. Le fait que cette substance soit contenue dans les produits de la demanderesse ne lui confère aucun droit, puisque le terme descriptif de botuline n’est pas monopolisable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.4.1). Il n’y a pas non plus de violation du droit de la concurrence au sens de l’art. 3 al. 1 lit. e LCD, car le slogan de la défenderesse ne compare pas son produit avec celui de la demanderesse, mais avec la neurotoxine botulique, qui est une matière naturelle (c. 3.42). La demande est rejetée (c. 5). [AC]