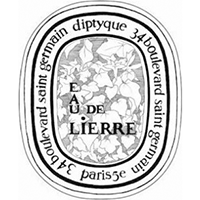« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.
Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]