Le
terme anglais « BOND », signifiant « obligation »
ou « caution » et l'abréviation « ST. »,
signifiant entre autres « rue », appartiennent tous deux
au vocabulaire anglais de base. Londres compte plusieurs rues portant
le nom de « Bond ». En 1847, le marchand de tabac Philip
Morris ouvre son premier magasin au 22, rue Bond. A partir de 1854,
il fabrique ses propres cigarettes, qu'il met en vente à la même
adresse. Bond Street, dans le quartier londonien de Mayfair s'est
forgé une réputation de rue commerçante coûteuse avec des
boutiques élégantes proposant des marques exclusives, des bijoux,
de l'art et des antiquités dans les segments du prestige et du luxe.
Les parties s'accordent à reconnaître que Londres est connue du
public concerné en tant que capitale du Royaume-Uni et de
l'Angleterre (c. 3.2). En règle générale, les rectangles et les
lignes sont considérés comme des traits faiblement
individualisants, et appartiennent au domaine public. Le fait que ces
mêmes formes géométriques simples soient utilisées pour présenter
les produits du tabac n’y change rien. Il ne peut pas être
considéré que la marque jouit d’un caractère distinctif original
suffisant pour identifier les produits revendiqués, en raison du
clair contenu géographique descriptif qu'elle contient et du manque
d’originalité dans la représentation du signe (c. 3.4).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les règles
d’expérience (Erfahrungssatz)
en matière d’indications de provenance ne sont pas dépourvues de
fondement légal. Elles découlent, d’une part, du choix du
législateur de ne pas formuler positivement de critères de
détermination d’une indication de provenance à l’art. 47 al. 1
LPM et, d’autre part, de la définition négative des indications
de provenance de l’art. 47 al. 2 LPM. La conclusion qui en est
tirée, selon laquelle les dénominations géographiques connues
doivent être considérées comme des indications de provenance aussi
longtemps que d’autres circonstances ne viennent pas exclure cette
interprétation est conforme au concept normatif et à la ratio
legis de l'article 47
LPM (c. 4.2). La demanderesse considère que l’application des
règles d’expérience est insoutenable, car elles n’ont pas été
confirmées empiriquement. Dans la mesure où la demanderesse cherche
à invalider le recours des autorités judiciaires à « l’expérience
générale de la vie », elle ne peut être suivie (c. 4.3). La
demanderesse se plaint d’une violation du principe de la
répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ainsi que d’une
constatation incomplète des faits (art. 12 PA) et d’une violation
de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Selon
elle, le recours aux règles d’expérience libère, d’une part,
les autorités et les juges d’établir la preuve positive d'une
compréhension en tant que lieu de provenance par les destinataires
et, d'autre part, contraint la demanderesse à apporter la preuve
d’un fait négatif, ce qui constitue une « froide inversion »
du fardeau de la preuve (c. 4.4). La demanderesse néglige le fait
que les règles d’expérience critiquées concernent principalement
l'évaluation libre des indices, preuves indirectes et preuves à
prima facie,
et ne contiennent pas de règle sur la répartition de la charge de
la preuve. Les faits internes – tels que la compréhension et les
attentes présumées du public concerné – ne peuvent généralement
pas être prouvés directement, mais seulement indirectement au moyen
d’indices. Ces difficultés procédurales sont prises en compte
dans la procédure d'enregistrement, dans la mesure où il suffit,
grâce à l’exigence de preuve réduite, que le plaignant expose de
manière crédible une ou plusieurs raisons de douter de l'exactitude
des preuves recueillies par l’instance précédente lors de
l’examen de demandes d’enregistrement de marques ou de ses
conclusions. La demanderesse n’est ainsi tenue de fournir que des
indications objectivement compréhensibles qui, avec un degré de
probabilité suffisant (vraisemblance), permettent de conclure à
l'existence des faits qu’elle allègue. L’allégation de la
demanderesse selon laquelle la charge de la preuve est inversée est
donc infondée (c. 4.4.1). Selon la demanderesse, la maxime
inquisitoire énoncée à l'art. 12 PA exige que des éléments de
preuve soient également recueillis pour étayer les présomptions
qui sous-tendent la décision, si l'autorité n'a pas une
connaissance fiable de certains événements ou de leurs causes et
effets. La maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition de la
charge de la preuve. Selon la règle de la charge de la preuve de
l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public, les
conséquences d'un défaut de preuve sont à la charge de celui qui
tire ses droits d'un fait qui n'a pas été prouvé ou qui n'a pas
été justifié selon le niveau de preuve applicable. Le Tribunal
administratif fédéral examine si la juridiction inférieure a
recueilli et apprécié l'ensemble des éléments de preuve
raisonnablement disponibles, dans la mesure où ils ne concernent pas
des faits généralement notoires. Cet examen porte notamment sur les
éléments de preuve qui montrent que le public cible associe la
marque à une provenance géographique des produits et services. Cela
n’exclut pas la preuve d’une perception différente par le public
cible. Des données probantes appropriées peuvent à tout moment
compléter ou corriger les règles d’expérience utilisées. Cela
doit néanmoins être établi par la demanderesse, et elle supporte
les conséquences de l'absence de preuve. L'application erronée des
règles d’expérience est susceptible de contrôle judiciaire (c.
4.4.2). Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des
articles 29 al. 1 Cst., 12 PA et 8 CC s'avèrent infondés (c.
4.4.4). Selon la volonté expresse du législateur, les conceptions
de qualité spéciale ou de valeur ajoutée ne sont pas pertinentes
pour la détermination d'une attente du public cible quant à la
provenance des produits et services revendiqués (c. 4.5.1). Dans ATF
132 III 770 « Colorado (fig.) », le Tribunal fédéral a
examiné l'applicabilité des règles d’expérience indépendamment
du concept de qualité, et a depuis confirmé cette pratique dans une
jurisprudence constante. Il n’y a pas de raison sérieuse de
modifier cette pratique (c. 4.5.2). Il est vrai qu'il existe des
sites de production, de fabrication et de commerce moins chers que
Londres ou la Grande-Bretagne. Toutefois, aucune impossibilité
objective, au sens juridique du terme, au-delà de toute probabilité,
ne peut être tirée d'un argument d'efficience économique (c.
5.1.1). La demanderesse soutient sans succès, à défaut d’avancer
des arguments convaincants ou de produire des moyens de preuve que,
sur le plan symbolique, le signe représente un certain mode de vie
et une certaine attitude face à la vie (c. 5.2). De même, la
demanderesse allègue sans le prouver que « BOND ST. 22
LONDON » remplit sa fonction d’identification d’une
entreprise, puisqu’elle constitue une référence connue et
comprise à l’origine de l’entreprise, qui est une marque culte
de renommée mondiale (c. 5.3 et 5.3.1). Les moyens de preuve
produits ne permettent pas de prouver l’établissement d’un
secondary meaning
(c. 5.3.2). S’il est vrai que de nombreux produits du tabac sont
étiquetés avec des noms géographiques, l'hypothèse selon
laquelle, en conséquence de cela, les clients ciblés reconnaissent
une référence d’entreprise concrète dans le signe litigieux au
lieu d’une indication d’origine n’est pas convaincante. Cet
argument quantitatif suggère plutôt que l’origine géographique
joue un rôle particulier en relation avec les produits de la classe
34 (c. 5.4.1). La marque « BOND ST. 22 LONDRES (fig.) »
possède dans l’esprit du public concerné une signification claire
d'indication de provenance pour la fabrication et la distribution en
gros de produits du tabac, voire même de référence à la
provenance des matières premières. En tant qu'indication directe de
l'origine, la marque appartient donc au domaine public et n'est pas
enregistrable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la marque
combinée ne possède pas le niveau de stylisation suffisant pour
surmonter le caractère descriptif du signe (c. 7.1).En conséquence,
il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c et des
art. 47ss LPM (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

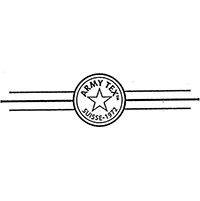
 », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «
», le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «  » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]
» n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]