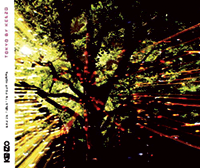sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Aussie Dual Personality » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Australie, anglais, dual, personality, produits cosmétiques, argot, recherche Internet, presse, indication de provenance, réputation, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.
Pour qu’un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une part non négligeable des consommateurs concernés (c. 2.6). Des produits de parfumerie et de cosmétique (classe 3) s’adressent aux adultes formant le grand public (c. 4). L’élément « AUSSIE » n’a qu’un seul sens envisageable : en argot anglais (slang [c. 2.3]), il signifie « australien » (Australier[in], australisch) (c. 2.5 et 5.1.1). Le fait que, dans une recherche sur Google, le terme « Aussie » donne beaucoup moins de résultats que le mot clé « Australien » ne signifie pas qu’il soit inconnu (c. 2.4 et 5.1.2). Étant donné que ce terme apparaît (dans divers domaines) dans la presse suisse et que les touristes suisses entretiennent des rapports privilégiés avec l’Australie, « AUSSIE » doit être considéré comme connu d’une part non négligeable des consommateurs concernés par les produits en cause (c. 5.1.2). Sont également connus les éléments anglais « DUAL » (doppelt, dual [c. 5.1.3]) et « PERSONALITY » (Persönlichkeit, personnalité [c. 5.1.4]). Dans le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY », les éléments « DUAL » et « PERSONALITY » sont mis en relation alors qu’une signification plutôt indépendante est réservée à l’élément « AUSSIE », de sorte que l’attente qu’il suscite quant à la provenance ne passe pas à l’arrière plan (c. 2.2 et 5.2). Une partie importante des consommateurs concernés risque dès lors de penser que les produits commercialisés sous le signe « AUSSIEDUAL PERSONALITY » proviennent d’Australie (c. 6.1). Le fait que l’Australie n’ait pas de réputation particulière pour ce genre de produits et que les consommateurs n’attendent pas de qualités particulières de ces produits n’exclut pas un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM ( c. 2.1 in fine et 6.1). Si elles sont différentes du signe en cause, les marques enregistrées à l’étranger ne peuvent pas jouer un rôle d’indice (c. 6.2). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM– et donc pas avec les autres motifs absolus d’exclusion de l’art. 2 LPM– que, dans un cas limite (nié en l’espèce), les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice (c. 3 et 6.2). En conclusion, le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2).