sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup
SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce,
instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production
de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison
de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un
fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi,
similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles,
similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la
spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75
al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF,
art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951
al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM,
art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1
lit. c CPC, art. 52 CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]

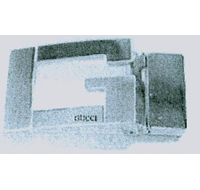
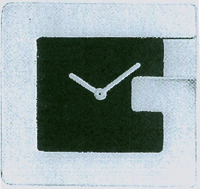
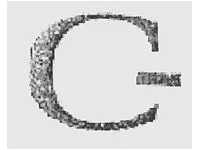
 », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «
», le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «  » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]
» n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]
