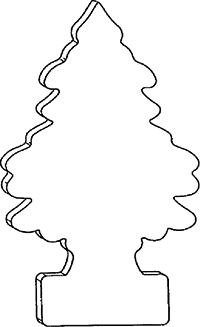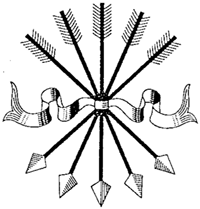Motifs
relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services,
similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore,
similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur
le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires
pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force
distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage
de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de
la marque, délai de grâce, action en
interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque,
intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque
défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité,
territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe,
dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet,
blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière,
lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al.
1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2
lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.
La
défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée
« Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11
pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une
filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous
ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis
2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une
société allemande qui distribue le même types de produits en
Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire
de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En
2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la
nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour
certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de
commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse
sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de
propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi
contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat
qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55
LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique
suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire
certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une
« interprétation extensive de la territorialité du droit
Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une
conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre,
contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait
d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur
Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit
suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la
Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication
des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire
à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde
entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer
l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique.
La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être
contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le
prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé
d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM
suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à
obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte
menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait
sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La
recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo
déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle
n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à
obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire
constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en
l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt
juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le
titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir
de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la
protection n’est accordée que pour autant que la marque soit
utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai
de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque
en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut
plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le
délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période
comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais
aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci
a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al.
2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation
(c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de
la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018,
elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1
LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son
droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière
soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été
définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité
du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser
pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à
la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne
protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les
marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées,
mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes
correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la
protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre
à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque
défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour
l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il
faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui
considère que l’abandon de la marque entraîne également une
perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de
cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est
défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à
nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en
l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue
pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque
est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de
manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse
pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un
abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de
commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la
défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En
lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que
l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un
motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM
(c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au
sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la
défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits
ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2).
La défenderesse revendique la protection pour des appareils et
équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que
l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à
ceux de la recourante. Même les armatures et équipements
d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage.
En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre.
Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont
la même finalité et sont destinés à des groupes de clients
similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le
marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories
des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits
qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient
identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle
utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen
aux luminaires, mais serait compris comme une indication se
rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités
ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle
n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en
ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation
d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents
commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence
du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe
pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le
coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé
les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait
selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c.
7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le
1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que
le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par
l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son
emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique
n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la
pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al.
2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de
1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers
l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art.
3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires
ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion
doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également
l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux
services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par
l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse
de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe
« Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à
titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas
ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde
essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un
service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour
des produits. Or, selon les constatations de la juridiction
inférieure, le « service » de la recourante consiste
essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage,
c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse
revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que
l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle
de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens
sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la
similitude entre les services, d'une part, et les marchandises,
d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien
habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont
typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un
ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que
le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3
al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut
faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la
recourante. La question de savoir si la vente de produits sur
Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la
marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes
peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose
l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance
précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à
juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus
dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles,
ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les
destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention
moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage
courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la
marque de la recourante, bien que composée d’éléments
descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit
être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette
force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant
notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998,
sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe
ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le
Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il
faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que
la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue,
et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des
signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle
leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que
leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des
voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence
dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au
regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la
juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens
lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné
comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se
réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de
l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs
significations différentes. Les éléments figuratifs des signes
respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le
tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la
recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en
tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque
de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de
nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison
qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant
compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont
utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die
Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères
conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de
confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion
de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une
appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante
créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal
fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public
ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes
« lumi », « mart » et « arte »,
qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de
l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même
les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer
l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La
question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse
ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la
marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la
réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il
existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments
« lumi » et « mart » est une expression du
fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance
précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de
confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune
violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque
de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en
reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art.
13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les
prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la
défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2
CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé
par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait
connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe
identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance
s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré
cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que
l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une
position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de
l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa
responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser
que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de
l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette
connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse
(c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine
www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère
toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale
de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les
visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand
www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas
clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas
critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à
ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements
effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une
atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la
péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques
de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes
distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas
particuliers, une péremption a été admise après des périodes
d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est
pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir
si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue
raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son
comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles
circonstances particulières étaient présentes déjà après une
période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le
tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de
droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la
recourante reproche à l’instance précédente d’avoir,
partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de
l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en
cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La
similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les
produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon
leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à
l’instance précédente une violation du droit fédéral
lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était
nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé,
c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que
les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la
protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM.
L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien
avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également
à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en
constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est
rejeté (c. 12). [SR]




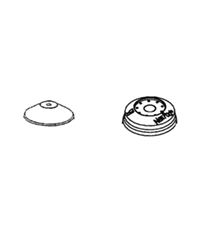





 utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque
utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque  enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe
enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe  est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque
est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque  ,
l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant
doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la
fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes
,
l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant
doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la
fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes
 — déposées après la marque
— déposées après la marque