Le mémoire du recourant (qui peut être compris comme un recours en matière civile) étant admissible (indépendamment de la valeur litigieuse [art. 74 al. 2 lit. b LTF]), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF) (c. 1). En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable (c. 2). Le recourant — à qui, dans l'arrêt attaqué, l'Obergericht BE n'a pas reconnu la qualité d'auteur (art. 6 LDA) de la photographie de chien utilisée par l'intimé — ne parvient pas à établir que l'Obergericht BE a appliqué des normes cantonales de procédure de manière contraire à la Constitution en considérant que les agrandissements photographiques avaient été déposés tardivement (c. 3.3.1). Ne peuvent pas être prises en considération les critiques purement appellatoires (art. 97 LTF, art. 105 LTF; c. 3.2 in fine) du recourant au sujet de l'appréciation des preuves faite par l'Obergericht BE (c. 3.3.2-3.3.3). Bien qu'il n'ait, probablement à tort, pas retenu le fait que deux témoins avaient reconnu le chien Q. sur la photographie litigieuse, l'Obergericht BE n'a pas établi les faits de façon manifestement inexacte (art. 9 Cst.), car il peut s'appuyer sur d'autres éléments du dossier, notamment sur les affirmations de deux autres témoins qui ont, eux, reconnu le chien R. sur la photographie litigieuse (c. 4.1). Le recourant ne parvient pas à démontrer que l'Obergericht BE a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant que la photographie utilisée par l'intimé n'était pas une contrefaçon de la photographie du recourant (c. 4.2). L'Obergericht BE n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il était l'auteur de la photographie litigieuse et en considérant, en application de l'art. 8 al. 1 LDA, que l'intimé en était l'auteur (c. 4.3).
Disposition
Cst. (RS 101)
Art. 9
- Art. 9
- Art. 8
-- al. 1
- Art. 6
- Art. 113
- Art. 105
- Art. 99
-- al. 2
- Art. 97
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
sic! 5/2011, p. 305-307, « Internet-Piraterie » ; medialex 2/2011, p. 113-114 (rés.) ; droits d’auteur, Internet, téléchargement, P2P, adresse IP, complicité, infraction par métier, erreur sur l’illicéité ; art. 9 Cst., art. 21 CP, art. 25 CP, art. 67 al. 2 LDA.
Il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.) de considérer, sur la base d'un ensemble d'indices (540 adresses e-mail enregistrées [sur 280 000] se terminant par .ch et nombreux accès au moyen d'adresses IP suisses, dont il n'y a aucune raison de penser qu'elles n'étaient pas utilisées pour du téléchargement [upload]), que le site www.Y.com a permis à des utilisateurs suisses de télédécharger (download) et de télécharger (upload) des œuvres protégées par la LDA (c. 3.1-3.4). Constitue un cas de complicité (art. 25 CP) de violation du droit d'auteur l'exploitation d'un site Internet qui rassemble des liens P2P (vers des œuvres protégées) et les met à disposition de ses utilisateurs; peu importe que l'utilisateur lui-même doive installer un logiciel P2P avant de pouvoir utiliser le site (c. 4-4.4). Le recourant a agi par métier (art. 67 al. 2 LDA) étant donné qu'il a consacré une partie considérable de son temps à l'exploitation du site www.Y.com, que les revenus — fluctuants, mais relativement réguliers — qu'il en a tirés dépassent largement ses coûts et que cette activité apparaît au moins comme une importante activité accessoire (c. 5-5.2). Une autre procédure pénale introduite contre lui ayant été classée en 2002 suite au retrait de la plainte, le recourant aurait dû savoir que son activité pouvait être punissable et il ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) (c. 6-6.4).
sic! 10/2008, p. 713-717, « SBB-Uhren IV » ;
droits d’auteur, contrat, CFF, transfert de droits d’auteur, principe de la confiance, théorie de la finalité, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 95 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 18
al. 1 CO, art. 9 al. 1 aLDA, art. 16 LDA ; cf. N 20 (arrêt du Handelsgericht AG dans
cette affaire).
La constatation de la volonté effective de transférer des droits d'auteur relève du fait et le TF ne peut la revoir que si elle est manifestement inexacte ou arbitraire, ou si elle repose sur une violation des règles de droit selon l'art. 95 LTF. Il n'y a pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. du seul fait qu'une autre solution aurait également pu entrer en ligne de compte, ou même qu'elle aurait pu paraître préférable. Il n'est pas arbitraire de déduire un transfert de droits d'auteur du fait que leur titulaire originaire ne se considérait pas comme investi de ces droits et qu'il ne les a pas fait valoir à l'encontre de leur utilisateur dont il connaissait l'activité. Les règles relatives au transfert des droits d'auteur de la nouvelle LDA correspondent à celles de l'ancienne LDA. Les droits d'utilisation sont cessibles selon l'art. 9 al. 1 aLDA et leur transfert peut intervenir de manière informelle, le cas échéant tacitement ou par actes concluants. Ce qui est déterminant pour juger de l'existence d'un transfert des droits d'auteur, c'est la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO. Lorsque celle-ci ne peut être établie, l'objet du contrat de transfert des droits d'auteur doit être déterminé en recourant au principe de la confiance, selon la théorie de la finalité. Le fait que le titulaire originaire de droits d'auteur n'ait pas eu conscience de ce qu'il en était investi n'empêche pas qu'il ait pu valablement transférer ces droits au sens de l'art. 16 LDA. Le transfert de droits d'auteur ne suppose en effet pas nécessairement la connaissance exacte de l'existence et de la portée des droits se rapportant à une œuvre. Il suffit que le cédant soit conscient, au moment du transfert, du fait que des droits pouvaient lui appartenir à titre originaire.
- Art. 18
-- al. 1
- Art. 9
- Art. 16
- Art. 9
-- al. 1
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 2
TF, 14 novembre 2008, 4A_367/2008 (d) (mes. prov.)
sic! 3/2009, p. 159-161, « Softwarelizenzvertrag III » ; JdT 2010 I 636 ; mesures provisionnelles, droit d’être entendu, motivation de la décision, droit étranger, contrat de licence, résiliation, arbitraire, préjudice, pesée d’intérêts ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., § 314 dBGB.
Un tribunal ne motive pas sa décision de manière inattendue et ne viole par conséquent pas le droit d'être entendue d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'il applique par analogie une disposition légale étrangère (en l'occurrence, le § 314 dBGB) que l'autorité de première instance avait elle-même directement appliquée (c. 3.1). L'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à un tribunal de se prononcer sur tous les arguments juridiques des parties (c. 3.2). En cas de contestation de la validité de la résiliation d'un contrat de licence, il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de prendre en considération le préjudice qui pourrait être causé non seulement à la requérante, mais également à l'intimée, et de procéder à un pesée d'intérêts (c. 4.1-4.3).
TF, 6 juillet 2010, 4A_57/2010 (d) (mes. prov.)
medialex 4/2010, p. 230 (rés.) ; mesures provisionnelles, recours, recours constitutionnel subsidiaire, irrecevabilité, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 113 LTF, art. 6 CC, art. 65 LDA, art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG.
Le recours en matière civile contre la décision (incidente) de refus de mesures provisionnelles (art. 65 LDA) du Kantonsgericht SG étant admissible, le TF n'entre pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1). Les griefs soulevés contre cette décision du Kantonsgericht SG pouvant être examinés par le Kassationsgericht SG dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (contre la décision du Kantonsgericht SG) (art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG; c. 2), le TF n'entre pas en matière sur le recours en matière civile contre la décision du Kantonsgericht SG (art. 75 al. 1 LTF) (c. 4.1), les griefs soulevés (violations de l'art. 9 Cst. [en lien avec l'art. 6 CC] et de l'art. 29 Cst.) n'étant au surplus pas suffisamment motivés (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; c. 3) (c. 4.2).
- d'auteur
- Art. 6
- Art. 29
- Art. 9
Droit cantonal
- ZPO/SG
-- Art. 239
-- Art. 237~ss
- Art. 65
- Art. 98
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 1
- Art. 113
TF, 30 novembre 2011, 4A_478/2011 (f) (mes. prov.)
sic! 6/2012, p. 412-413, « Risque de disparition de moyens de preuve » (Schlosser Ralph, Remarque) ; mesures provisionnelles, programme d’ordinateur, recours, motivation du recours, préjudice irréparable, bonne foi, injonctions sous menace des peines de l’art. 292 CP, preuve à futur, irrecevabilité, valeur litigieuse, connexité, concurrence déloyale, droit du travail, arbitraire dans la constatation des faits, motivation de la décision ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 6 LCD, art. 5 al. 1 CPC, art. 15 al. 2 CPC, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 lit. a CPC, art. 292 CP.
Vu la jurisprudence (ATF 134 I 83 [cf. N 439]) et en vertu du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), il ne peut pas être reproché aux recourantes de ne pas expliquer davantage en quoi consiste le préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) pouvant être causé par la décision — (incidente) sur mesures provisionnelles — attaquée. Ce n'est en effet que dans l'ATF 137 III 324 (cf. N 208) (publié au Recueil officiel après le dépôt du présent recours en matière civile) que le TF précise que, dans un recours au TF contre une telle décision, le recourant doit démontrer dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique (c. 1.1). S'agissant des injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP, les recourantes ne démontrent pas qu'elles sont exposées à un préjudice (de nature juridique) qu'une décision finale favorable ne pourrait pas faire disparaître entièrement (c. 1.1). Les questions de savoir s'il existe un risque qu'un moyen de preuve disparaisse et si ce risque justifie l'administration d'une preuve à futur (art. 158 CPC) touchent le bien-fondé de la requête et ne peuvent donc pas être tranchées au stade de la recevabilité du recours. Ce n'est qu'en cas d'admission du recours — qui concerne aussi bien des injonctions que la conservation de preuves — et de réforme (art. 107 al. 2 LTF) qu'il faut dire si le recours est partiellement irrecevable (c. 1.1 in fine). En raison de la connexité entre les différents fondements de la requête, la prétention fondée sur le droit du travail relève également (art. 15 al. 2 CPC) de l'instance cantonale unique appelée à statuer sur les actions fondées sur la LDA et la LCD (art. 5 al. 1 CPC) et le recours au TF n'est pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.2). En se basant en partie sur de simples suppositions, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que l'état de fait cantonal omet de manière arbitraire (art. 9 Cst.; c. 2.1.1) des faits importants propres à modifier la décision attaquée (c. 2.1.2) ou retient arbitrairement certains faits (c. 2.1.3). Il n'y a par ailleurs rien d'arbitraire à considérer avec circonspection les déclarations du représentant des recourantes et à admettre qu'elles ne peuvent pas fonder la vraisemblance exigée (c. 2.1.3-2.1.4). Le refus des mesures provisionnelles se justifie pour le seul motif que les recourantes ne sont pas parvenues à rendre vraisemblable que leurs droits étaient l'objet d'une atteinte ou risquaient de l'être (art. 261 al. 1 lit. a CPC), sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de la titularité des droits d'auteur (c. 2.1.5). La motivation de la décision attaquée est suffisante (art. 29 al. 2 Cst.; c. 2.2.1) puisqu'elle montre clairement que les mesures provisionnelles sont refusées en raison du fait que les recourantes ne rendent pas vraisemblables les faits (exploitation de façon indue du code-source de logiciels) permettant l'application de l'art. 6 LCD (c. 2.2.2). La cour cantonale a également suffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.) son refus d'ordonner des preuves à futur (art. 158 CPC) (c. 2.2.3).
- dans la constatation des faits
- déloyale
- d'auteur
Injonctions sous menace des peines de l'art. 292 CP
- à futur
- Art. 292
- Art. 261
-- al. 1 lit. a
- Art. 158
- Art. 15
-- al. 2
- Art. 5
-- al. 1
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 6
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
- Art. 107
-- al. 2
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
sic! 12/2011, p. 719-725, « Duft von gebrannten Mandeln » ; définition de la marque, odeur, amande grillée, signe olfactif, marque olfactive, goût, marque gustative, sécurité du droit, registre des marques, publicité, description de la marque, représentation graphique, recette de cuisine, signe nouveau, modification de la marque, droit d’être entendu, bonne foi, délai supplémentaire, décision étrangère, renvoi de l’affaire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 1 LPM, art. 30 al. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM, art. 16-17 OPM.
Le recourant ne peut pas faire valoir une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; c. 4.1), car il savait que l'IPI considérait que la description d'une marque olfactive au moyen d'une recette de cuisine ne constituait pas une représentation graphique au sens de l'art. 10 al. 1 OPM (prise de position de l'IPI du 14 août 2009) et il connaissait ainsi les fondements factuels et juridiques sur lesquels l'IPI allait baser la décision attaquée (c. 4.2). Le fait que le recourant ait déposé, avec ses observations du 17 février 2010, une nouvelle description de sa marque ne lui donne pas le droit de prendre position à nouveau, car cette nouvelle description ne constitue qu'une adaptation de la précédente (c. 4.2 et 5.2). Le recourant ne peut pas non plus faire valoir une violation du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; c. 5.1) car, même si l'IPI ne l'avait pas indiqué expressément, il devait être clair pour le recourant que sa prise de position du 17 février 2010 était la dernière (c. 5.2). Ce n'est qu'exceptionnellement que l'IPI impartit des délais supplémentaires (art. 16-17 OPM) (c. 5.2). L'art. 10 OPM, dont le but est de garantir la sécurité du droit, permet en particulier au registre des marques de remplir sa fonction de publicité (c. 6.2). Il n'existe pas encore de méthode permettant de représenter les odeurs et les goûts de manière compréhensible, durable et objective (c. 6.2.2). La description d'une odeur (en l'espèce: Duft von gebrannten Mandeln) est certes une représentation graphique, mais elle n'est pas suffisamment claire et objective (c. 6.3.1). Une recette de cuisine destinée à produire une odeur ne permet pas non plus de définir cette odeur avec la précision et l'objectivité nécessaires (c. 6.3.2). Il en va de même de la combinaison de la description d'une odeur et d'une recette de cuisine (c. 6.3.2). Quelques marques olfactives ont pu être enregistrées en Europe avant l'an 2000. Or, les décisions étrangères n'ont en principe pas d'effet en Suisse et, selon un arrêt « Sieckmann » de la CJCE de 2002 (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00), la description d'une odeur n'est pas suffisamment claire et objective (c. 7). L'affaire ne saurait être renvoyée à l'IPI pour nouvelle décision (sur un prétendu nouveau signe) (c. 8-8.2). Vu l'art. 30 al. 2 lit. a LPM, le recours est rejeté (c. 9).
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 30
-- al. 2 lit. a
- Art. 1
- Art. 16-17
- Art. 10
sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « AdRank » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, publicité, gestion, marketing, recherche scientifique, informatique, arbitraire, égalité de traitement, arbitraire dans la constatation des faits, cas limite, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 106 (arrêt du TAF dans cette affaire).
Les exigences des art. 5 ch. 1 AM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l'art. 2 lit. a LPM (c. 3). En lien avec des services dans les domaines de la publicité, de la gestion, du marketing, de la recherche scientifique et de l'informatique (classes 35 et 42), les consommateurs (en partie spécialisés et à qui un niveau d'anglais élevé peut être reconnu) perçoivent sans effort d'imagination particulier la désignation « AdRank » comme descriptive. En anglais, l'élément Ad renvoie en effet à « advertisement » (« Anzeige », « Inserat », « Annonce ») et l'élément « Rank » peut être traduit en allemand par « Reihe », « Linie » ou «Rang » (c. 4). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (c. 4.4). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est en l'espèce pas suffisamment motivé et est dès lors irrecevable. Il en va de même du grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), car le recours n'établit pas pour quelle raison il conviendrait de traiter de manière égale les services des classes 38 et 42 pour lesquels la désignation a été enregistrée et les autres services pour lesquels elle ne l'a pas été (c. 5). Étant donné que le TAF n'a pas fait de constatations au sujet de marques — enregistrées — similaires à la désignation « AdRank » et que la recourante ne fait pas valoir l'établissement manifestement inexact des faits (art. 105 al. 2 LTF), le TF n'a pas à entrer en matière, ce d'autant que la recourante ne fait pas non plus valoir le droit à l'égalité dans l'illégalité (c. 6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'enregistrement étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 7).
- Art. 5
-- ch. 1
- Art. 6quinquies
-- lit. B ch. 2
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 2
-- lit. a
- Art. 105
-- al. 2
- Art. 97
-- al. 1
sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « 5 am Tag », « 5 par jour », « 5 al giorno », « 5 a day » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chiffre, jour, produits pharmaceutiques, boissons, produits alimentaires, bébé, dosage, indication publicitaire, égalité de traitement, bonne foi, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.
Bien que le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) soit de nature formelle, sa violation (en l’occurrence, la violation de l’obligation de motiver) peut, à titre exceptionnel, être réparée en procédure de recours, étant donné qu’elle est de peu de gravité, que le TAF a un pouvoir de cognition aussi étendu que l’IPI et que la recourante a eu la possibilité d’exposer ses arguments devant le TAF (c. 3- 3.3). Afin de déterminer si les signes litigieux appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, à qui s’adresse la majorité des produits pharmaceutiques (classe 5) et boissons (classe 32) concernés (c. 4). Dans les quatre langues, les signes litigieux signifient « 5 am/pro Tag » (c. 5) et pas uniquement « 5 mal täglich » (c. 5.1). En lien avec des produits pharmaceutiques et des aliments pour bébé (classe 5), les signes litigieux sont compris comme des indications de dosage et sont ainsi descriptifs. En lien avec des boissons (classe 32), ils sont plutôt compris comme des indications publicitaires et appartiennent donc également au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.4). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec d’autres enregistrements – qui concernent au surplus des produits et services d’autres classes – dont elle est elle-même titulaire (c. 6.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque « apple a day », qui ne commence pas par un chiffre (c. 6.1). Enfin, en lien avec l’enregistrement des signes litigieux pour des fruits et légumes (classes 29 et 31), cas isolé que le TAF juge au surplus contraire au droit, elle ne peut pas se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) (c. 6.2).
sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Labspace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, laboratoire, space, gestion, immobilier, architecture, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.
Des services de gestion d’actifs immobiliers (classe 36), de construction divers (classe 37) et de conception architecturale et d’ingénierie (classe 42) ne s’adressent pas seulement aux consommateurs moyens, mais également à des spécialistes du domaine de l’immobilier (c. 3). En lien avec de tels services, le signe « LABSPACE » – formé des deux éléments (c. 4.1.1) anglais « lab » (avant tout : laboratoire) et « space » (espace, place) (c. 4) – ne peut avoir pour sens que « Laborraum » ou « Laborplatz » (c. 4.1.2) et est compris ainsi par les destinataires de ces services, même s’il n’est pas (comme usuellement) orthographié « lab space » (c. 4 et 4.2). La protection d’un signe est exclue, même si ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services compris dans les catégories revendiquées ; en l’espèce, du fait que les catégories de services (largement formulées) concernées peuvent toucher des laboratoires, le signe « LABSPACE » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour ces catégories de services dans leur ensemble (c. 4.3-4.4 et 7). En outre, en lien avec les services concernés et vu les intérêts des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 3 in fine), le signe « LABSPACE » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec la marque « LABSPACE » (dont elle est titulaire) enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42), car ces services n’ont aucun rapport avec l’immobilier ou l’architecture (c. 5.1). Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 5.1). En outre, même si la marque « LABSPACE » enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42) était illicite, elle ne constituerait qu’un cas illicite isolé qui ne permettrait pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement du signe « LABSPACE » pour les services en cause (c. 5.2). Enfin, le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement de la marque « LABSPACE » aux États-Unis – État qui plus est anglophone – ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 6).
sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Wild Bean Café » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, wild, bean, café, imprimés, emballage, produits en papier, contenu immatériel, boissons, vente, restauration, sous-catégorie de produits ou services, eau minérale, signe trompeur, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 13 et 22 ODFI-Eau.
C’est en lien avec les produits et/ou services concernés qu’il s’agit de déterminer si le signe « Wild Bean Café » (« Wildbohnen-Kaffee ») est compris comme une référence au café plutôt en tant que produit ou plutôt en tant que local (c. 3). Un signe peut s’avérer descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu intellectuel du produit ou du service (c. 4.1.1). « Wild Bean Café » est descriptif en lien avec le contenu intellectuel de supports, affiches, imprimés, publications et panneaux publicitaires (classe 16) (c. 4.1.2). Il n’est en revanche pas descriptif en lien avec des emballages en papier pour plats à emporter (classe 16), car de tels produits, même s’ils peuvent être imprimés, sont avant tout vendus pour leurs fonctionnalités (c. 4.1.2). « Wild Bean Café » n’est pas descriptif pour des potages (c. 4.2.1) et du thé (c. 4.2.2). « Wild Bean Café » est en revanche descriptif pour des « smoothies », « boissons à base de chocolat », « boissons à base de cacao », « préparations faites de céréales » et « boissons de fruits et jus de fruits » (c. 4.2.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de vente dans le domaine alimentaire (c. 4.3). Si un signe est descriptif pour un service, il l’est également pour la catégorie générale dans laquelle ce service est compris (c. 4.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de restauration (c. 4.4). « Wild Bean Café » est trompeur (art. 2 lit. c LPM) pour des eaux minérales, car les art. 13 et 22 ODFI-Eau interdisent l’adjonction d’arômes dans de tels produits (c. 5-5.3). Le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 6.1). Le simple fait d’avoir enregistré la marque « The Wild Bean Café » ne permet pas de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement de la marque « Wild Bean Café » (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (qui plus est issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).
- minérale
-- absolus
- trompeur
- appartenant au domaine public
- Art. 9
- Art. 2
-- lit. c
-- lit. a
- Art. 22
- Art. 13
sic! 9/2009, p. 613 (rés.), « Flasche mit Rillen (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, bouteille, Bols, rainures, emballage, boissons alcoolisées, provenance commerciale, élément bidimensionnel, élément fonctionnel, force distinctive, Afrique, Directives de l’IPI, dispositions transitoires, enregistrement international, Benelux, bonne foi, égalité de traitement, sécurité du droit ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.
L’enregistrement du signe tridimensionnel au sens strict « Flasche mit Rillen (3D) » est demandé pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) qui s’adressent au consommateur moyen (c. 4). Un tel signe doit s’écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine considéré ; il doit être perçu comme une indication de provenance commerciale et non pas simplement comme la forme du produit (c. 3 et 4). Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habitués à une grande diversité de formes d’emballages, ce qui élève le niveau de force distinctive exigé et rend plus difficile – mais pas impossible – la création d’une forme non banale (c. 4 in fine). L’étendue de la protection de l’enregistrement international ne peut pas être plus large que celle de l’enregistrement national de base. Il convient dès lors de se référer en l’espèce à l’enregistrement de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) sur lequel les inscriptions figurant sur la bouteille sont difficilement lisibles (c. 5). Est déterminante la date de la décision (et la pratique en vigueur à ce moment là) et non pas la date de dépôt du signe (et la pratique – en l’espèce moins stricte – en vigueur à ce moment-là) (c. 6-6.1). En cas de changement de pratique, la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), ce d’autant qu’elle n’a pas reçu d’assurances particulières de la part de l’IPI (c. 6.1). Est en l’espèce applicable la toute dernière pratique de l’IPI (moins stricte) – entrée en vigueur le 1er décembre 2007 – qui reprend la jurisprudence du TF selon laquelle il n’est plus exigé que les éléments bidimensionnels couvrent toute la surface d’un signe tridimensionnel pour pouvoir avoir une influence sur l’impression générale qui s’en dégage (c. 6.2). Les inscriptions « Bols » sur la capsule et « Lucas Bols » en relief sur la partie inférieure de la bouteille – au surplus difficilement lisibles – sont trop petites pour conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.1). Les rainures présentes sur le corps de la bouteille sont fonctionnelles, car elles permettent une meilleure prise en main (c. 7.2 in limine). Du fait qu’elles peuvent également être fonctionnelles ou au moins pratiques (par exemple si la bouteille est prise à deux mains), les rainures présentes sur la partie inférieure du goulot de la bouteille sont banales et ne sont pas, au sens de l’art. 2 lit. a LPM, propres à conférer une force distinctive au signe tridimensionnel (c. 7.2). Ces rainures ne peuvent enfin guère être perçues comme un ensemble de colliers portés en Afrique (c. 7.2 in fine). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 8.1) en lien avec deux enregistrements de forme de bouteille comme marque tridimensionnelle datant de 2001 et 2002, étant donné que l’IPI a adopté une pratique plus sévère à partir du 1er juillet 2005 et qu’il n’y a aucune raison que la sécurité du droit prime l’intérêt à l’application correcte du droit (c. 8.2). Le signe « Flasche mit Rillen (3D) » n’est enfin pas comparable avec la forme d’une bouteille qui présente des différences importantes au niveau de ses éléments bidimensionnels et qui avait de surcroit été enregistrée en application du principe de la bonne foi (c. 8.2 in fine).

ATAF 2010/31 ; sic! 1/2011, p. 34-39, « Kugelschreiber (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, marque de service, stylo, emballage, services, publicité, marketing, conseil, graphisme, impression, aptitude distinctive, force distinctive, forme techniquement nécessaire, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.
Pour pouvoir être protégé comme marque, un signe doit avoir — dans l'abstrait — une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1). Il doit en outre avoir — en lien avec des produits et/ou des services — une force distinctive (Unterscheidungskraft) (c. 2.2). Alors que l'art. 2 lit. a LPM vise tous les signes tridimensionnels, l'art. 2 lit. b LPM ne concerne que les signes tridimensionnels au sens strict (formes du produit lui-même ou de son emballage) (c. 2.3). Il existe des recoupements entre l'art. 2 lit. a LPM et l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). L'examen de l'appartenance au domaine public (art. 2 lit. a LPM) d'un signe tridimensionnel au sens strict repose sur des exigences plus élevées: pour être protégé comme marque, un tel signe doit se distinguer de manière frappante des formes usuelles du produit concerné et rester gravé à long terme dans le souvenir du consommateur (c. 2.3). Tant l'art. 2 lit. b LPM que les exigences plus élevées dans la mise en œuvre de l'art. 2 lit. a LPM s'appliquent aux marques tridimensionnelles de service qui se résument à la forme d'un produit. Il s'agit toutefois de tenir compte du fait que le rapport entre un service et la forme d'un produit n'est en général pas aussi évident que le rapport entre un produit et la forme de ce produit (c. 2.4). Les consommateurs de services de publicité en lien avec des stylos à bille (classes 35, 40 et 42), c'est-à-dire les entreprises de tous types, font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3). Est doté d'une aptitude distinctive (Unterscheidungseignung) (c. 2.1) un objet du quotidien tel qu'un stylo à bille (c. 4). En lien avec des services de distribution de moyens publicitaires (classe 35) et de personnalisation de matériel d'écriture (classe 40), la forme du stylo à bille en cause est techniquement nécessaire (art. 2 lit. b LPM) car, pour les consommateurs concernés, elle ne s'écarte pas suffisamment de ce qui est usuel et attendu (c. 5 et 6.1). Par ailleurs, en lien avec des services de publicité et de marketing (classe 35) et de conseil au sujet du graphisme et de l'impression sur du matériel d'écriture (classes 42 et 40), la forme de ce stylo à bille n'est pas dotée d'une force distinctive suffisante (c. 6.2-6.3). Bien que l'IPI lui ait, par courrier, assuré que la forme de ce stylo à bille pouvait être enregistrée comme marque pour des services de publicité (classe 35), la recourante ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) car, premièrement, à part la demande d'enregistrement, elle n'a pas pris de dispositions à son désavantage sur la base de cette assurance et, deuxièmement, son intérêt à l'enregistrement n'est pas suffisamment fort face à l'intérêt des autres fournisseurs de services de publicité à l'utilisation du stylo à bille comme moyen publicitaire (c. 7).
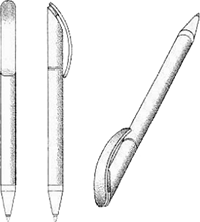
TF, 28 juin 2011, 4A_178/2011 (d) (mes. prov.)
ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso » ; motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, signe tridimensionnel, capsule, café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, Lego, expertise, expertise sommaire, preuve, mesures provisionnelles, procédure sommaire, décision incidente, arbitraire, droit d’être entendu, droit des brevets d’invention ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. b LPM, art. 254 CPC.
En vertu de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, le recours au TF contre des décisions incidentes n'est ouvert que si elles peuvent causer un préjudice de nature juridique difficilement réparable que même un jugement en faveur du recourant ne pourrait supprimer par la suite. Le recourant qui s'élève contre une décision de mesures provisionnelles doit désormais indiquer dans la motivation de son recours en quoi il est menacé dans le cas concret par un dommage de nature juridique difficilement réparable (c. 1.1). Dans le cadre de l'examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme enregistrée comme marque, la limitation du cercle des formes alternatives possibles aux capsules de café compatibles avec les machines « Nespresso » actuellement disponibles sur le marché résiste au grief d'arbitraire, même si le TF s'est jusqu'à présent refusé (en particulier dans sa jurisprudence Lego) à admettre le caractère techniquement nécessaire d'une forme uniquement en vertu de sa compatibilité avec un autre système préexistant (c. 2.2). Selon la jurisprudence du TF, une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM lorsque à peu près aucune forme alternative n'est à disposition des concurrents pour un produit de nature (technique) correspondante ou que le recours à cette forme alternative ne peut pas être exigé d'eux dans l'intérêt du bon fonctionnement de la concurrence parce qu'elle serait moins pratique, moins solide ou que sa réalisation s'accompagnerait de coûts de production plus élevés. Le fait de demander qu'une expertise sommaire soit ordonnée pour démontrer qu'il existe des formes de capsules alternatives utilisables dans les machines « Nespresso », qui soient aussi pratiques et solides que les capsules « Nespresso » et qui ne coûtent pas plus cher à la production, ne saurait être interprété en défaveur de la partie à l'origine de la demande (c. 3.2.2). Il est inadmissible et contraire au droit d'être entendu de refuser un moyen de preuve portant sur la question controversée de la compatibilité de formes alternatives et de baser ensuite un jugement uniquement sur les allégations contestées de l'autre partie. L'autorité de première instance, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour juger de l'importance technique de la forme conique des capsules de café, de même que de l'aptitude fonctionnelle des capsules d'une autre forme, n'aurait ainsi pas dû refuser l'expertise demandée qui était destinée à clarifier des questions techniques nécessaires à une compréhension indépendante de l'état de fait (c. 3.2.2). Lorsqu'il est nécessaire de répondre à des questions purement techniques qui sont déterminantes pour trancher le litige et que le juge ne dispose pas des connaissances professionnelles nécessaires pour le faire (que ce soit dans le domaine des brevets ou, comme en l'espèce, sur le plan de la fabrication des capsules de café), le recours à une expertise sommaire constitue un moyen de preuve admissible, même en procédure sommaire, en vertu en particulier de l'art. 254 al. 2 lit. b CPC (c. 3.2.2).
- Art. 254
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 2
-- lit. b
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
TF, 23 février 2009, 4A_567/2008 (d) (mes. prov.)
sic! 5/2009, p. 348-351, « Fairsicherungsberatung / fairsicherung » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, conseil, assurance, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, risque de confusion, nom de domaine, fairsicherung.ch, imposition comme marque, arbitraire, mesures provisionnelles ; art. 9 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 3 lit. d LCD.
Il n’est pas manifestement insoutenable (art. 9 Cst.) de considérer qu’il existe une différence claire entre le conseil dispensé par un assureur potentiel et le conseil en assurances dispensé par une entreprise indépendante (c. 4.1). Bien que la marque « Fairsicherungsberatung » ne soit pas dépourvue d’originalité, il n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) de ne lui reconnaître qu’une force distinctive faible (c. 4.3). Il peut être attendu une attention accrue du public concerné par la conclusion d’un contrat d’assurance (c. 4.4). Il est conforme à la Constitution d’exclure un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM entre les marques « Fairsicherungsberatung » et « fairsicherung » (c. 4.5). Le seul fait qu’un signe ait été utilisé pendant 13 ans, notamment comme nom de domaine, ne suffit pas à démontrer qu’il s’est imposé dans le public, c’est-à-dire qu’il est compris par une partie importante des destinataires commerciaux comme une indication individualisant une entreprise spécifique. Il n’est dès lors pas arbitraire (art. 9 Cst.) de considérer que ce signe n’a pas acquis de force distinctive au sens de l’art. 3 lit. d LCD (c. 5.1-5.2).
- Art. 9
- Art. 3
-- al. 1 lit. d
- Art. 13
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).
Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).
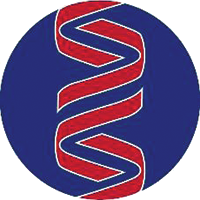
- Art. 8
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 11
- Art. 13
-- al. 1 lit. a
ATF 133 III 360 ; sic! 9/2007, p. 619-622, « Contratto di licenza » ; contrat portant sur la marque, contrat de licence, résiliation, contrat de travail ; art. 9 Cst., art. 2 CC, art. 271 al. 1 CO, art. 337 CO, art. 18 LPM.
Un contrat de licence ne peut pas être résilié avec effet immédiat selon les dispositions applicables au contrat de travail. Une résiliation non conforme au contrat ne saurait déployer ses effets que si elle est fondée sur de justes motifs et si elle n'est pas contraire aux règles sur la protection de la bonne foi, faute de quoi le rapport contractuel subsiste.
- Art. 2
- Art. 337
- Art. 271
-- al. 1
- Art. 9
- Art. 18
TF, 1er avril 2009, 4A_13/2009 (d) (mes. prov.)
Mesures provisionnelles, recours, droit constitutionnel, arbitraire dans la constatation des faits, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, consorité ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 2 LTF, art. 98 LTF, 106 al. 2 LTF.
Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer la violation du « Grundsatz [ es ] des Verbots von Verträgen zu Lasten Dritter », car il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel (c. 1.1-1.2). Les recourantes ne parviennent à démontrer (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; c. 1.1) ni que les faits ont été établis de façon arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 1.1) dans la procédure cantonale (c. 2.2) ni que leur droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) a été violé (c. 3.2). Les recourantes ne formant qu'une consorité (passive) simple avec K. ltd. (qui n'a d'ailleurs pas recouru contre les décisions cantonales), elles ne peuvent pas se prévaloir d'une violation du droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) de K. ltd. (c. 4).
- Art. 6
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 98
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 42
-- al. 2
TF, 25 octobre 2011, 4A_358/2011 (d) (mes. prov.)
Mesures provisionnelles, revirement de jurisprudence, recours, décision incidente, préjudice irréparable, preuve, bonne foi, restauration, bière, signes similaires, réputation, droit au nom, droits de la personnalité, droit d’être entendu, arbitraire, vraisemblance ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b CPC.
Dans le récent ATF 137 III 324 (cf. N 208), rendu après le dépôt du présent recours, le TF a remis en question sa jurisprudence (ATF 134 I 83) selon laquelle une décision incidente portant sur des mesures provisionnelles était susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) et pouvait sans autre faire l'objet d'un recours au TF. Le TF exige désormais du recourant qu'il démontre qu'une telle décision est, dans le cas concret, susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l'espèce, la recourante devant encore pouvoir se fier à l'ATF 134 I 83, la condition posée par l'art. 93 al. 1 lit. a LTF doit, conformément aux règles de la bonne foi, être considérée comme remplie (c. 1.1). La recourante exploite une brasserie et un restaurant ; elle a confié l'exploitation du restaurant à l'intimée. Dans sa décision de refus de mesures provisionnelles, l'Obergericht LU ne viole pas l'art. 9 Cst. en considérant que le concept de la recourante (une brasserie liée à un restaurant) n'est pas affecté par le fait que l'intimée n'utilise plus, en lien avec ses services de restauration, les signes utilisés par la recourante (pour sa bière, sa brasserie et son restaurant) (cf. Fig. 158a), mais un nouveau signe (cf. Fig. 158b) (qu'elle a déposé comme marque) très similaire à ceux de la recourante (c. 2.2). L'Obergericht LU ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. en considérant que l'intimée continue à vendre la bière de la recourante ; la bière est certes vendue en lien avec le nouveau signe de l'intimée, mais ce nouveau signe est très similaire à ceux de la recourante (c. 2.3). En estimant que les affirmations de la recourante au sujet du prétendu préjudice qu'elle subit (notamment une perte de réputation ainsi qu'une violation du droit au nom et du droit de la personnalité) sont trop peu concrètes, l'Obergericht LU ne viole pas le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 3.1) de la recourante (c. 3.3-3.6). L'Obergericht LU n'applique pas de façon arbitraire l'art. 261 al. 1 lit. b CPC en considérant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le comportement de l'intimée risque concrètement de lui causer un préjudice difficilement réparable (c. 4-4.1). Enfin, du fait que la recourante écoule sa bière presque exclusivement par l'intermédiaire de l'intimée et qu'elle n'est donc pas véritablement entrée sur le marché, il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne rend pas vraisemblable une perturbation de son marché (c. 4.2).

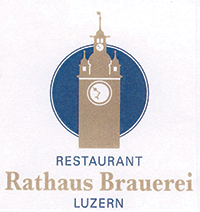
- au nom
- Art. 261
-- al. 1 lit. b
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
TF, 8 août 2011, 4A_59/2011 (d) (mes. prov.)
Irrecevabilité, recours, mesures provisionnelles, cause devenue sans objet et radiée du rôle, frais et dépens, droit constitutionnel, arbitraire, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF.
Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF prévoit que seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, même si la décision n'est attaquée que sur la question accessoire des frais et des dépens (c. 1). En l'espèce, le TF n'entre pas en matière, car le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) contre la décision attaquée (décision de radiation du rôle d'une procédure de recours — contre une décision d'octroi de mesures provisionnelles — devenue sans objet) n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1).
ATF 134 III 205 ; sic! 6/2008, p. 445-449, « Bagues » ; SJ 2009 I, p. 65 ; conditions de la protection du design, nouveauté, originalité, impression générale, combinaison, cadre de la comparaison ; art. 9 Cst., art. 2 LDes, art. 8 LDes, art. 21 LDes, art. 33 LDes.
La nouveauté d'un design n'est exclue que si des designs antérieurs identiques existent. Une impression générale de ressemblance n'est pas suffisante et des designs ne sont pas identiques lorsqu'ils se distinguent par des éléments qui ne peuvent pas être qualifiés de détails peu perceptibles. La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète de caractéristiques qui en elles-mêmes ne seraient pas forcément nouvelles. Lors de la détermination de l'originalité d'un design par sa comparaison avec un design préexistant, il faut se concentrer sur le produit dans son ensemble, en se référant au critère de l'impression générale telle qu'elle est perçue par le cercle de ses acheteurs potentiels. La comparaison entre différents designs ne doit pas se limiter aux produits du même genre uniquement (bague/bague, pendentif/pendentif, etc.), mais peut dépasser les limites du genre de produits et s'étendre à des objets qui ne se prêteraient pas à une substitution.
TF, 11 mai 2010, 4A_616/2009 (d) (mes. prov.)
Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, préjudice irréparable, motivation du recours, motivation de la décision, droit d’être entendu, arbitraire, droit à un procès équitable, interdiction de transfert, concurrence déloyale ; art. 9 Cst., art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 5 lit. a LCD, art. 136 LDIP ; cf. N 526 (arrêt du Kantonsgericht FR dans cette affaire).
Une décision (incidente) interdisant à la recourante, à titre de mesures provisionnelles, d’utiliser certaines inventions et procédés ou de mettre à disposition le savoir-faire correspondant peut faire l’objet d’un recours en matière civile, car elle est clairement susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.2). Si des griefs ne sont, comme en l’espèce (le recours se limitant à faire des renvois à des notes de plaidoirie), pas suffisamment motivés, le TF n’entre pas en matière (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.4-1.5). Il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les arguments de la recourante, de ne pas avoir motivé sa décision (c. 2-2.2) ou de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve de la recourante (c. 3-3.3) et d’avoir ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 2.1 et 3.1), son droit à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 3.2) ou son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; c. 4). La recourante ne démontre pas en quoi l’application de l’art. 5 lit. a LCD par l’autorité précédente (c. 5-5.3) et l’octroi de mesures provisionnelles (c. 6-6.3) seraient arbitraires. Il n’est par ailleurs pas arbitraire de considérer que la décision prévoyant que « [d ]er X. SA [intimée] wird [. . . ] verboten, [. . . ] den Streitgegenstand [. . . ] an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der W. GmbH [recourante] darüber zu verfügen » interdit également dans les faits – et non seulement juridiquement – de rendre la technologie accessible (c. 6.3). La recourante ne démontre pas en quoi, au regard de l’art. 136 LDIP, il est arbitraire d’appliquer le droit suisse (LCD) (c. 7-7.2).
- déloyale
- Art. 29
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 5
-- lit. a
- Art. 136
- Art. 93
- Art. 98
- Art. 106
-- al. 2
Assistance judiciaire, décision incidente, préjudice irréparable, avance de frais, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, chance de succès, non-évidence, analyse rétrospective, revendication, limitation de revendications, bonne foi, déni de justice ; art. 6 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 29 al. 1 et 3 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 24 al. 1 LBI, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 542
(arrêt du TF suite à une demande de révision du présent arrêt).
Est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) une décision (incidente) par laquelle l'assistance judiciaire est refusée et une avance de frais est demandée (c. 1.3). La décision du Kassationsgericht ZH est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) (c. 1.4). En revanche, au regard des griefs de la violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 CEDH, la décision du Handelsgericht ZH n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 1.4-1.5 et 8). La violation de droits fondamentaux n'est examinée par le TF que si le grief est suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.6 et 2.2). Dans le cadre de l'examen de la demande d'assistance judiciaire et des chances de succès de la cause principale (art. 29 al. 3 Cst.; c. 4.1), le Kassationsgericht ZH n'a pas procédé à une analyse rétrospective (interdite ; c. 3.1 in fine) de la non-évidence de l'invention (c. 4.2-4.3). Les chances de succès de la cause principale doivent être examinées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sans prendre en considération d'éventuelles modifications ultérieures de la demande principale par la limitation de revendications définissant l'invention (art. 24 al. 1 LBI) (c. 5.6). En n'informant pas d'office le recourant des possibilités de limiter sa demande principale, le Handelsgericht ZH n'a pas violé le principe de la bonne foi (c. 5.6). Le recourant ne motive pas suffisamment le grief selon lequel l'art. 29 al. 3 Cst. (c. 6.1) aurait été violé durant les 6 ans de procédure (c. 6.3-6.4). Du fait qu'il existe une décision, le grief de la violation du droit à un jugement de la cause dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable (c. 7).
- Art. 6
- Art. 29
-- al. 1
-- al. 3
- Art. 9
Droit cantonal
- ZPO/ZH
-- § 281~ss
- Art. 24
-- al. 1
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 1
sic! 9/2007, p. 660-661, « Reinigungs- und Polierstein » ; concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 42 al. 2 CO, art. 423 al. 1 CO ; cf. N 563 (arrêt similaire).
Détermination ex æquo et bono du gain réalisé dont il est réclamé la restitution sur la base de l'art. 423 al. 1 CO, avec une application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO lorsque les documents qui ont été produits pour déterminer le gain à confisquer sont incomplets ou peu fiables. Caractère non arbitraire d'une telle estimation.
Concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire; art. 9 Cst. ; cf. N 562 (arrêt similaire).
Le Kantonsgericht VS n’a pas fait preuve d’arbitraire en fixant ex æquo et bono le montant du gain réalisé par la recourante (c. 2.2.2 et 2.3.1-2.3.2).
TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (f) (mes. prov.)
sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie, Media Markt, café, capsule de café, machine à café, mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, qualité pour agir du preneur de licence, forme techniquement nécessaire, signe alternatif, arbitraire, imposition comme marque, expertise sommaire, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589- 593, « Nespresso »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310- 314, « Nespresso III »), N 662 (Handelsgericht SG, 21mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).
La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral est saisie d'un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après: Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après: Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après: ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé, dès septembre 2011, des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d'offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d'être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d'espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu'elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n'est pas indemnisable ou réparable par l'octroi de dommages-intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d'en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d'une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l'IPI ait procédé à l'enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu'il s'agirait d'une marque imposée ne dispense pas le juge d'examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L'imposition par l'usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM, mais pas s'il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 lit. b LPM sans qu'une imposition par l'usage n'entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d'en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l'échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l'absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu'elle constitue une forme alternative, il faut encore qu'elle n'entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l'esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection au sens de l'art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d'une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d'interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d'accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S'agissant d'une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d'élucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l'administration de cette preuve et sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux, est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (c. 2.4). [NT]
- Art. 9
- Art. 3
- Art. 2
- Art. 59
-- lit. d
- Art. 55
-- al. 4
-- al. 1 lit. b
-- al. 1 lit. a
- Art. 3
- Art. 2
-- lit. b
-- lit. a
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » ; liste des produits et des services, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, bonne foi, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 11 OPM ; cf. N 387 (vol. 2007-2011 ; TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).
La recourante ne conteste pas les critiques de l’autorité inférieure relatives à la liste des produits et services revendiqués pour les marques qu’elle a voulu faire enregistrer (manque de précision, erreur de classification et produits qualifiés de services), de sorte que celles-ci doivent être admises (c. 2). Si les critiques de l’instance inférieure affectant la liste des produits et services revendiqués pour la marque « [Doppelhelix] (fig.) » (refusée à l’enregistrement) sont justifiées, cela signifie que les deux autres marques de la recourante, dont l’enregistrement a été accepté pour la même liste, ont été enregistrées à tort. Par conséquent, ce n’est pas l’égalité de traitement que la recourante devrait invoquer, mais l’égalité dans l’illégalité, dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Selon la jurisprudence du TF, l’égalité de traitement ne peut être invoquée que par rapport à un tiers. La recourante ne saurait dès lors invoquer une violation de l’égalité de traitement entre la marque « [Doppelhelix] (fig.) », dont l’enregistrement a été refusé, et ses deux autres marques, acceptées à l’enregistrement (c. 3). Alors que la recourante savait, dès le 31 août 2009, que la liste des produits et services revendiquée pour la marque « [Doppelhelix] (fig.) » était traitée différemment par l’IPI de celles – identiques – revendiquées pour ses deux autres marques (enregistrées le 28 octobre 2009), elle a attendu le 10 décembre 2009 pour signaler la situation à l’IPI. En raison de l’écoulement du temps, la recourante ne saurait donc bénéficier de la protection de la bonne foi, ce d’autant qu’elle n’a jamais allégué avoir pris des dispositions désavantageuses du fait de la situation décrite (c. 4). C’est à la recourante de démontrer pourquoi la demande d’enregistrement de la marque « [Doppelhelix] (fig.) » n’aurait pas dû être traitée différemment de celle des deux autres marques qu’elle a déposées. Le fait qu’une erreur commise deux fois par l’IPI ne soit pas répétée une troisième fois n’est pas du tout constitutif d’arbitraire et s’inscrit dans l’intérêt public d’une application correcte du droit (c. 5). Le recours est rejeté (c. 8). [JD]
![[Doppelhelix] (fig.)](https://jurisprudence-pi.ch/files/images/Doppelhelix.png)
sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Glass Fiber Net » ; liste des produits et des services, motifs absolus d’exclusion, motifs formels d’exclusion, classification de Nice, classe de produits ou services, effet rétroactif, égalité de traitement, bonne foi, protection de la confiance, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition absolu ; AN, AN 1967, AN 1977, art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, Notes explicatives de classes de la 8e et de la 9e édition de la classification de Nice, art. 8 al. 1 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.
L’IPI souhaitait appliquer avec effet rétroactif la dixième édition de la classification de Nice à toutes les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle édition. Cette mesure ne répond ni à une nécessité d’ordre public ni à un intérêt public prépondérant et ne constitue pas un droit plus favorable pour les déposants. Par conséquent, il convient de rejeter l’effet rétroactif et d’appliquer la neuvième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 3.2). Le libellé de services informatiques « kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikenstleistungen) » présenté à l’enregistrement en classe 42, ne fait pas partie, en tant que tel, de la liste alphabétique des entrées de la neuvième édition de la classification de Nice. Il peut cependant être rapproché d’un libellé de services informatiques en classe 38 (c. 3.3.1). L’étude des « Notes explicatives des listes de classes de la huitième et de la neuvième édition de la classification de Nice » démontre par ailleurs que les services informatiques appartiennent à la classe 38 (c. 3.3.2-3.4). Étant donné ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté l’enregistrement sur la base de motifs de refus formels (c. 3.4). La recourante ne peut pas se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement sur la base de ses propres enregistrements de marques antérieurs (c. 4.3). Dans le cadre de l’échange d’écritures qui précède la décision de l’IPI, le déposant ne peut pas se prévaloir de la protection de la confiance en relation avec un renseignement, une promesse ou une assurance donnée par l’autorité (c. 5.3 et 5.5). De même, la recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi sur la base d’un enregistrement survenu un an auparavant, pour les mêmes services et sous l’empire de la même édition de la classification de Nice (c. 5.4- 5.5). L’expression en anglais « Glass Fiber Net » appartient au vocabulaire de base et le sens de cette expression peut être compris des spécialistes comme des consommateurs moyens (c. 9.1). Le signe « GLASS FIBER NET » est descriptif des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et donc privé de force distinctive (c. 10.1-10.5). De plus, le signe « GLASS FIBERNET » décrit une technologie omniprésente et doit, par conséquent, rester à la libre disposition de tous les acteurs du domaine (c. 11.1). [AC]
- absolu
Classe de produits ou services
-- faible
- des produits et des services
-- formels
-- absolus
- anglais
- Art. 6quinquies
-- lit. B ch. 2
- Art. 8
-- al. 1
- Art. 9
- Art. 2
-- lit. a
Notes explicatives des listes de classes de la 8ieme et de la 9ieme édition de la classification de Nice
- Art. 11
TF, 21 août 2013, 4A_160/2013 (d) (mes. prov.)
sic! 1/2014, p. 29-32, « Anti-babypille » ; violation d’un brevet, mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, formalisme excessif, arbitraire, procédé de fabrication, produit directement issu d’un procédé, contraceptif, drospirénone ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 30 Cst., art. 75 LTF, art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 93 al. 1 lit. b LTF, art. 8a al. 1 LBI, art. 265 CPC ; cf. N 756 (TFB, 21mars 2013, S2013_001).
Une décision sur mesures superprovisionnelles, supplantée par une décision de mesures provisionnelles finale, ne peut pas faire l'objet d'un recours, quand bien même elle serait réactualisée, en cas de révocation des mesures provisionnelles. Si le recours est admis contre la décision de mesures provisionnelles, l'autorité inférieure doit se déterminer immédiatement sur la demande de mesures superprovisionnelles. Si cela n'est pas possible, elle doit se déterminer sur le maintien, la modification ou la levée des mesures superprovisionnelles pour la durée de la procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. (c. 2.1). L'autorité inférieure ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsqu'elle exige que la demande en rectification d'un procès-verbal soit déposée sitôt que la partie a connaissance de l'erreur (c. 3.4). Il n'est a priori pas insoutenable de considérer que l'utilisation de l'une des deux substances essentielles qui composent le produit final constitue la reprise d'un produit directement issu d'un procédé de fabrication breveté (c. 5.1.2). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]
- Art. 265
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 9
- Art. 8a
-- al. 1
- Art. 93
-- al. 1 lit. b
-- al. 1 lit. a
- Art. 75
sic! 3/2014, p. 153-154, « Duftbäumchen » ; concurrence déloyale, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, sapin, arbre magique, désodorisant, recours en matière pénale, présomption d’innocence, dol, qualité pour agir du preneur de licence, action pénale, concours imparfait, publicité, campagne publicitaire, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits ; art. 9Cst., art. 32Cst., art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 61 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 23 al. 1 LCD, art. 23 al. 2 LCD, art. 10 CPP ; cf. N 435 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht ZH, 9 juillet 2010, HG080097 ; sic! 1/2011, p. 39-42, « Wunder- Baum »).
Le grief de violation des droits fondamentaux (y compris l'application arbitraire du droit fédéral et l'arbitraire dans la constatation des faits) doit être exposé de manière précise dans le recours contre la décision attaquée et étayé de manière substantielle. Autrement, il n'est pas entré en matière le concernant (c. 1). Il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que les adultes de notre pays connaissent la marque de l'arbre magique désodorisant, même s'ils n'ont pas une conception détaillée de sa forme (c. 1.2). Que la recourante se soit fait remettre un layout de la campagne publicitaire de Noël avec la forme, la grandeur, etc., de l'arbre magique n'y change rien. Il n'est pas juste que l'instance précédente ait déduit de la connaissance de cette marque dans le public la connaissance de celle-ci par la recourante. La Cour s'est basée, pour l'admettre, sur une appréciation des dépositions de la recourante dans la procédure d'instruction. Comme la recourante ne démontre pas que — et dans quelle mesure — l'appréciation des preuves de l'instance précédente, qui l'a amenée à retenir que la recourante connaissait le nom de l'arbre magique, de même que son utilisation et sa forme, serait insoutenable et violerait la présomption d'innocence, le recours ne satisfait pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (c. 1.2). Lorsqu'une violation du droit à la marque, selon l'art. 61 LPM, remplit aussi les conditions d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, il y a spécialité et l'état de faits spécifique au droit des marques l'emporte. Dans ce cas, il y a concours imparfait entre les dispositions pénales de la LPM et de la LCD. L'application complémentaire de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD à côté de la protection du droit des marques prend par contre tout son sens lorsqu'une protection ne peut être déduite de la LPM, ou en présence de circonstances qui ne sont pertinentes que sous l'angle de la concurrence déloyale. Le recours à une protection selon la LCD peut ainsi entrer en ligne de compte vu les conditions d'application différentes mises par la LCD et la LPM à l'ouverture de l'action pénale (c. 3.3). À la différence du reste du droit des signes distinctifs (marques, raisons de commerce et noms), le droit de la concurrence ne concerne pas seulement les cas où deux signes sont susceptibles d'être confondus. Il se rapporte bien plus au cas où un certain comportement est de nature à induire le public en erreur par la création d'un risque de confusion. Le droit de la concurrence protège les intérêts de toutes les parties prenantes à la concurrence et va au-delà de la protection offerte par les lois spéciales comme la LPM. En tant que preneuse de licence non exclusive, l'entreprise fabriquant les arbres magiques dans notre pays ne pouvait pas se prévaloir d'une violation du droit à la marque. Elle disposait par contre d'un droit à porter plainte au sens de l'art. 23 al. 2 LCD. Seule la protection de la LCD lui était ouverte. D'une part, la campagne publicitaire de la recourante a violé le droit à la marque du titulaire de celle-ci, en mettant en circulation, au sens de l'art. 61 al. 1 lit. b LPM des produits imitant cette marque (insérés dans les dépliants publicitaires concernés). D'autre part, elle a enfreint la LCD en créant un risque de confusion et en portant atteinte à la position sur le marché de la preneuse de licence qui était digne de protection (c. 3.4). Le recours est rejeté. [NT]
- Art. 10
- Art. 32
- Art. 9
- Art. 23
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 3
-- al. 1 lit. d
- Art. 61
-- al. 1 lit. b
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
- Art. 97
-- al. 1
sic! 11/2012, p. 727-730, « Vacherin Mont d’Or » ; appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, cahier des charges, égalité de traitement entre producteurs, principe de la porte ouverte, lait, ensilage ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 27 Cst., art. 14 al. 2 LAgr, art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.
Le cahier des charges peut contenir des exigences supplémentaires à celles de l'art. 7 Ordonnance sur les AOP et les IGP, par exemple pour des raisons techniques ou d'hygiène. Cependant, ces dispositions doivent respecter le droit supérieur et notamment les principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la liberté économique (art. 27 Cst.), le principe de la porte ouverte (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP) et celui du caractère volontaire (art. 14 al. 2 LAgr) (c. 2.5). Les dispositions du cahier des charges ne doivent ainsi pas être utilisées de façon discriminatoire (c. 2.5). Les dispositions qui ne servent pas les buts visés par l'ordonnance ne peuvent être appliquées et ne justifient aucune atteinte aux droits fondamentaux. Seules les dispositions du cahier des charges ayant pour but la protection des caractéristiques liées à la provenance géographique des AOP et des IGP peuvent justifier une atteinte aux droits fondamentaux (c. 2.7). La question de savoir si l'utilisation de l'ensilage peut engendrer un risque accru pour la santé et diminuer la qualité du fromage est du ressort des chimistes cantonaux, qui doivent déterminer l'ampleur dudit risque (c. 3.5). S'il demeure à un niveau acceptable et qu'il est gérable grâce, par exemple, à de nouvelles technologies, alors son utilisation peut être autorisée durant la période transitoire (jusqu'au 30 avril 2013), à condition qu'elle le soit pour tous les producteurs. Dans le cas contraire, elle doit être interdite à tous les producteurs. La limitation à une partie des producteurs uniquement de l'autorisation du recours à cette méthode viole notamment le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) (c. 3.6). Un régime différencié relatif à la livraison du lait constitue une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et viole le principe de la porte ouverte s'il n'a pas de réelle justification (art. 1 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP) (c. 4.4). Bien que l'exception permettant de livrer le lait une fois par jour plutôt que deux fois (comme le prévoit le cahier des charges) ne concerne qu'une très petite partie des producteurs, il n'est pas moins incontesté qu'elle donne lieu à un avantage (économique) non négligeable à ceux qui peuvent en bénéficier. Il en résulte une inégalité de traitement inacceptable (c. 4.6). [YH]
- Art. 27
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 14
-- al. 2
Ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12)
- Art. 1
-- al. 2
TF, 21 février 2014, 4A_594/2013 (f) (mes.prov.)
Mesures provisionnelles, marque verbale, service(s) publicitaires, service(s) de gestion d’affaires commerciales, travaux de bureau, raison de commerce, nom de domaine, instance cantonale unique, décision incidente, préjudice irréparable, préjudice difficilement réparable, dilution de la marque, recours en matière civile, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 261 al. 1 lit. b LTF, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 2 CPC.
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l’art. 93 al. 1 LTF, lorsque l’effet des mesures en cause est limité à la durée d’un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d’un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n’est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d’un accroissement de la durée et des frais de procédure, est insuffisant. Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à défaut, le recours est irrecevable. La jurisprudence actuelle n’admet plus qu’une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (c. 4), ceci que la décision attaquée accorde ou refuse les mesures provisionnelles requises (c. 5). La simple déclaration que l’usage abusif d’une marque par un tiers entraînerait sa dilution ne suffit pas à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d’un préjudice juridique irréparable. Alors que la défenderesse avait probablement exercé une activité dans le domaine de la publicité depuis son inscription au registre du commerce en 2005, le recourant n’est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n’a entrepris d’aller en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Il en découle que même dans l’éventualité où cette situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n’en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l’art. 261 al. 1 lit. b CPC. Le recours est rejeté. [NT]
- Art. 5
-- al. 2
-- al. 1 lit. a
- Art. 9
- Art. 261
-- al. 1 lit. b
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
Frais et dépens, frais de procédure, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, complètement de l’état de fait, rectification de l’état de fait, arbitraire dans la constatation des faits, répartition des frais de procédure, appréciation du juge, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 29 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 105 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).
Les décisions sur mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que lorsqu’elles relèvent d’une procédure autonome. Les mesures provisionnelles notifiées séparément pendant ou en dehors d’une procédure principale et qui ne sont accordées que pour la durée du procès ou à condition qu’une procédure au fond soit introduite constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’espèce, la décision qui déclare la requête de mesures provisionnelles comme étant partiellement sans objet et devant partiellement être rejetée doit être considérée comme finale (c. 1.1). Dans les recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) ; elle doit l’être avec précision (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut ainsi pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance précédente a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance précédente est contraire aux principes constitutionnels (c. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (c. 2.3.1 et 2.3.2). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (c. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée. [DK]
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 29
-- al. 1
- Art. 90
- Art. 93
- Art. 98
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 105
- Art. 74
-- al. 2 lit. e
sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]
- Art. 8
- Art. 2
- Art. 933
-- al. 1
- Art. 956
- Art. 951
-- al. 2
- Art. 52
- Art. 5
-- al. 1 lit. c
-- al. 1 lit. a
- Art. 9
- Art. 12
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2
- Art. 15
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
-- al. 1
- Art. 107
-- al. 1
- Art. 75
-- al. 2
-- al. 2 lit. a
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 99
-- al. 2
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
Procédure, concurrence déloyale, motivation du recours, réplique, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit de réplique inconditionnel, triplique, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, arrêt de renvoi, force obligatoire, force de chose jugée, force distinctive, imposition comme marque, complètement de l’état de fait, souliers, cuir, vêtements, chaussures ; art. 6 ch. 1 CEDH, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD, art. 229 CPC; cf. N 860 (TF, 4 décembre 2014, 4A_330/214 ; sic! 4/2015, p. 238-242, Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; JdT 2015 II 204).
Un recours contre une nouvelle décision cantonale rendue suite à un renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne peut porter sur aucun des arguments ayant déjà été expressément rejetés par le Tribunal fédéral dans son jugement sur recours ou n’ayant pas été examinés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours parce qu’ils n’avaient pas été soulevés par les parties, alors que celles-ci auraient dû et pu le faire (c. 1.2). Le recourant ne saurait utiliser son deuxième tour de parole (réplique) devant le Tribunal fédéral pour compléter ou améliorer son recours qui doit, en vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, être déposé et motivé de manière complète dans le délai de recours. La réplique ne permet que de donner des explications sur les allégations formulées par une autre partie à la procédure. Il est donc fait abstraction des allégations qui, dans la réplique déposée par le recourant, vont au-delà de cela (c. 1.3). En vertu de son devoir de motiver son recours selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se limiter à confirmer les arguments juridiques qu’il a déjà fait valoir devant l’instance cantonale, mais doit indiquer en quoi il considère comme juridiquement critiquables les considérants de l’autorité précédente. Ces griefs et leur motivation doivent figurer dans l’acte de recours lui-même et un simple renvoi à d’autres explications se trouvant dans d’autres documents ou actes de la procédure ne suffit pas. Le même devoir de motivation vaut pour la réponse à recours (c. 1.4). Le fait qu’une autre solution aurait aussi pu entrer en ligne de compte ou aurait même été préférable n’est pas constitutif d’arbitraire. Il faut au contraire que le jugement attaqué soit clairement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, qu’il viole de façon crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou qu’il heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Le fait que les conclusions tirées de l’état de fait ne correspondent pas à la représentation que s’en fait la partie touchée n’est pas constitutif d’arbitraire (c. 1.5). Le recourant qui, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas invoqué dans son premier recours au Tribunal fédéral contre le jugement de l’instance cantonale unique, que la « triplique » qu’il avait déposée dans le cadre de la procédure cantonale en aurait été écartée en violation du droit, ne peut plus faire valoir par la suite, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la prétendue violation de son droit d’être entendu qui en serait résultée (c. 1.6). C’est sans violer le droit fédéral que l’autorité précédente a retenu que le cercle déterminant pour trancher de la force distinctive (originaire et dérivée) du signe « THINK » ainsi que de l’existence d’un éventuel risque de confusion était celui des acheteurs de chaussures (c. 2.2-2.3). La détermination de la force distinctive du signe « THINK » du point de vue de la loi contre la concurrence déloyale doit également être arrêtée en fonction des acheteurs de chaussures. Il n’y a ainsi pas à faire de différence avec le cercle de destinataires pertinent du point de vue du droit des marques. Le caractère largement connu du signe « THINK » pour les chaussures que le recourant souligne une fois de plus à l’appui de ses prétentions fondées sur le droit de la concurrence, a déjà été examiné dans le cadre du premier recours devant le Tribunal fédéral qui n’a pas pu le prendre en compte faute de constatation correspondante des faits dans le jugement de l’autorité précédente. Dans son examen du risque de confusion au sens du droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré que le consommateur moyen de chaussures comprenait la combinaison des mots « THINKOUT DOORS » dans son ensemble comme une déclaration descriptive, respectivement laudative, dans la mesure où, faute de constatation de faits correspondante par l’autorité précédente, il ne pouvait être retenu que la marque « THINK » se serait imposée dans l’esprit du public par une utilisation publicitaire importante. Le caractère obligatoire de l’arrêt de renvoi empêche que soit à nouveau examiné dans le cadre de la procédure devant l’autorité précédente si le signe « THINK » était particulièrement connu dans le cercle des acquéreurs de chaussures du fait d’un long usage dans notre pays, respectivement si ce signe s’était particulièrement imprégné dans leur mémoire du fait de la publicité réalisée par le recourant. C’est ainsi en vain que ce dernier allègue dans son nouveau recours le haut degré de connaissance prétendu du signe « THINK ». La question de l’absence d’un risque de confusion au sens du droit des marques ayant déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, il ne saurait y être revenu en vertu de la force obligatoire de l’arrêt de renvoi (c. 3.1). En se limitant à alléguer dans son recours, sans plus de détail, que l’autorité précédente aurait tranché de manière erronée ses prétentions en interdiction fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, le recourant ne montre pas en quoi le jugement de l’autorité précédente violerait les art. 2, 3 lit. d et 3 lit. e LCD, en ne retenant ni risque de confusion, ni exploitation parasitaire de sa réputation. Le complètement de l’état de fait souhaité par le recourant impliquerait qu’une violation des dispositions correspondantes de la loi contre la concurrence déloyale soit établie au sens de l’art. 105 al. 2 LTF. Tel n’est pas le cas et le recours mal fondé est rejeté (c. 3.2-c. 4). [NT]

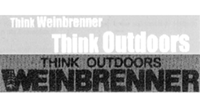
- Art. 6
-- ch. 1
- Art. 229
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 3
-- al. 1 lit. e
-- al. 1 lit. d
- Art. 2
- Art. 106
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 42
-- al. 1
- Art. 105
-- al. 2
Recours en matière civile, activité inventive, non-évidence, approche « problème-solution », complètement de l’état de fait, critique de l’état de fait, fardeau de l’allégation, arbitraire dans la constatation des faits, état de la technique ; art. 52 CBE, art. 56 CBE, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 53 al. 1 CPC.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente et ne peut s’en écarter que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. La critique de l’état de fait retenu est soumise au principe strict de l’allégation énoncé par l’art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un complètement de l’état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu’elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuves adéquats. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (c. 2.1 et réf.cit.). Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle, en vertu de l’art. 52 CBE. Selon l’art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par l’inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais uniquement l’écart mesurable entre le résultat de l’invention et l’état de la technique. Font partie de l’état de la technique toutes les données accessibles au public, à la date de dépôt ou de priorité. L’examen de l’activité inventive suppose que l’on considère l’état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque. Pour ce faire, on commencera, en règle générale, par rechercher le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l’invention. On comparera ensuite l’invention avec l’état de la technique pertinent afin de déterminer les différences structurelles et fonctionnelles et, sur cette base, le problème technique que l’invention cherche à résoudre. Enfin, on examinera les pas que l’homme de métier devait effectuer afin de parvenir, en partant de l’état de la technique, au même résultat que l’invention conformément au principe de l’approche « problème-solution » (c. 3.1.2 et réf.cit.). Toutes les données accessibles au public, y compris les documents particulièrement anciens, font partie de l’état de la technique. Ecarter un document de ceux que consulterait l’homme de métier en raison de son ancienneté reviendrait à priver les brevets ayant dépassé un certain âge de toute valeur dans le cadre de l’analyse de l’effet inventif. Une telle pratique ne saurait être déduite de l’art. 56 CBE. Le facteur temporel peut néanmoins jouer un rôle dans le cadre de l’analyse de l’activité inventive. L’exigence d’un besoin insatisfait depuis longtemps peut ainsi faire partie des indices suggérant une activité inventive digne de protection (c. 3.1.3). L’âge des documents n’est pas à lui seul décisif dans le cadre de la détermination de l’état de la technique. L’élément déterminant est plutôt l’obsolescence ou la désuétude d’une technique faisant l’objet d’un document ancien, ce qui exclut sa prise en considération par l’homme de métier (c. 3.1.4.2). [NT]
- Art. 56
- Art. 52
- Art. 53
-- al. 1
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
- Art. 97
-- al. 1
Harry Potter, préservatif, produits pornographiques, marque combinée, remise du gain, fourniture de renseignements, jugement partiel, action échelonnée, obligation de renseigner, intérêt digne de protection, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, appréciation des preuves, arbitraire, maxime des débats, participation à l’administration des preuves, droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 55 CPC, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 164 CPC ; cf. N415 (vol. 2007-2011 ; KGSZ, 17 août 2010, ZH 2008 19 ; sic ! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) ») ; N900 (TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 ; sic ! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II ») et N902 (TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014).
Selon l’art. 42 al. 2 CO, le dommage qui ne peut pas être exactement établi doit être déterminé par le Juge équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Hormis dans le cas rare de la prise en compte des principes abstraits déduits de l’expérience, cette détermination équitable du dommage se base sur une appréciation de l’état de fait et relève ainsi de la détermination des faits qui n’est revue par le TF qu’en cas d’arbitraire. Il incombe au Juge dans le cadre d’un exercice correct de sa liberté d’appréciation de faire la lumière sur les critères de décision dont il envisage de tenir compte, respectivement sur ceux pour lesquels il a besoin d’informations complémentaires. La latitude donnée au Juge de considérer le dommage comme établi sur la base d’une simple estimation n’a pas pour but d’exonérer le demandeur de manière générale du fardeau de la preuve, ni non plus de lui conférer la possibilité d’élever des prétentions en dommages et intérêts de n’importe quelle hauteur sans avoir à fournir de plus amples indications. Bien au contraire, l’application de cette disposition ne le dispense pas d’alléguer, dans toute la mesure possible et exigible, toutes les circonstances qui constituent un indice de l’existence d’un dommage et en permettent la détermination. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de son obligation d’étayer sa réclamation. Les circonstances alléguées doivent être de nature à justifier suffisamment l’existence d’un dommage, ainsi qu’à en rendre l’ordre de grandeur saisissable. Cela vaut aussi en cas de réclamation de la remise du gain en ce qui concerne les circonstances que la partie chargée du fardeau de la preuve souhaite invoquer concernant la réalisation d’un gain, respectivement sa diminution. Un établissement exact des faits ne doit cependant pas être exigé dans les cas où l’art. 42 al. 2 CO s’applique, dans la mesure où l’allégement du fardeau de la preuve consacré en faveur du demandeur par cette disposition comporte aussi une limitation du fardeau de l’allégation et de l’étayement des faits (« Substanziierung ») (c. 3.1). Du moment qu’en dépit de l’obligation qui découlait pour elle du jugement partiel précédent, la recourante refusait de communiquer à l’autre partie les informations nécessaires pour établir le montant du gain que cette dernière ne pouvait pas fournir, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en fixant le gain dans le cadre d’une application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO et en le déterminant en fonction de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire pour permettre de recourir à une telle application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO de se trouver en présence d’un refus injustifié de collaborer au sens de l’art. 164 CPC (c. 3.5). Le respect du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique que le tribunal entende, examine et prenne en compte dans son processus décisionnel les éléments avancés par celui que la décision atteint dans ses droits. Le jugement doit être motivé pour que les parties puissent se faire une idée des considérants du tribunal. La motivation doit mentionner de manière succincte les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles il fonde son jugement. Il n’est par contre pas nécessaire que la décision passe en revue de manière détaillée et réfute chacun des arguments soulevés par les parties. Il suffit que le jugement soit motivé de telle sorte qu’il puisse, le cas échéant, être contesté de manière adéquate. Le fait qu’une autre solution ait pu entrer en ligne de compte ou même être préférable n’est pas déjà constitutif d’arbitraire. Tel n’est le cas que lorsque le jugement attaqué est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, viole crassement une norme ou un principe de droit incontesté ou contrevient d’une manière choquante aux principes de la justice (c. 4.1). [NT]
- Art. 8
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 164
- Art. 59
-- al. 2 lit. a
- Art. 55
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
TF, 29 janvier 2019, 4A_435/2018, 4A_441/2018 (f)
Maxime des débats, procédure devant le TFB, activité inventive, approche « problème-solution », action en constatation de la nullité d’un brevet, action en constatation de l’illicéité de l’atteinte, action en interdiction, intérêt pour agir, intérêt digne de protection, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 55 al. 1 CPC.
La réelle et commune intention des parties quant à la portée d’un accord de transfert d’une demande de brevet, respectivement de l’invention correspondante et des droits s’y rapportant, relève non pas du domaine du droit, mais de celui des faits. Elle ne peut être revue par le TF que si elle se révèle manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire ; ce qui implique qu’il soit démontré dans le cadre du recours devant le TF que la constatation factuelle en question serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu ou encore heurterait de manière choquant le sentiment de la justice et de l’équité (c. 3.2). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties et non au Juge de rassembler les faits du procès. Il importe peu de savoir laquelle des parties a allégué les faits déterminants puisqu’il suffit que ceux-ci fassent partie du cadre du procès pour que le Juge puisse en tenir compte (c. 4.3.1). Il n’est pas contesté en l’espèce que tous les éléments de faits nécessaires à l’analyse de l’activité inventive déployée par l’inventeur ont été rassemblés par les parties. Le TFB n’a pas eu à suppléer ou suggérer des faits non allégués par les parties. La juridiction précédente était ainsi en mesure de procéder à l’analyse de l’activité inventive, une question de droit, ce qu’elle a fait en se fondant sur l’approche « problème-solution » consacrée par la jurisprudence. Il est sans importance à cet égard que la présence ou l’absence de caractéristiques litigieuses dans la présentation et/ou le brevet ait été alléguée par la défenderesse ou la demanderesse. En se fondant sur les faits rassemblés par les parties afin d’examiner une question de droit, la juridiction précédente n’a pas violé la maxime des débats (c. 4.3.2). L’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice et seule l’existence de circonstances exceptionnelles peut conduire à admettre un intérêt digne de protection à la constatation de droit bien qu’une action condamnatoire soit ouverte. Ne constitue pas de telles circonstances le fait qu’au moment de l’introduction de l’action ou de la modification de ses conclusions, aucune vente du produit litigieux n’ait été encore été réalisée. Cela ne justifie en rien un intérêt digne de protection à la constatation de la violation du brevet. Dans un tel cas, outre la possibilité d’intenter une action tendant à la divulgation d’informations, le titulaire du brevet peut, en particulier, intenter une action condamnatoire visant à interdire la commercialisation du produit litigieux (c. 6.1.2). Les deux recours sont rejetés. [NT]
- Art. 55
-- al. 1
- Art. 9
- Art. 106
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 2
Mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, droit d’être entendu, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit d’auteur, programme d’ordinateur, concurrence déloyale, droit des obligations, contrat, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 1 CO, art. 2 LDA, art. 5 LCD.
La demanderesse, alléguant l’utilisation et la transmission non autorisées de logiciels nouvellement développés, a demandé sans succès l’octroi de mesures provisionnelles. Un recours contre une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, lorsqu’elle constitue une décision incidente, n’est recevable que si lesdites mesures peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qu’une décision favorable ultérieure ne permettrait pas de faire disparaître. Les inconvénients de pur fait, tels que l’accroissement des frais de procédure ou la prolongation de celle-ci, ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable de ce point de vue (c. 1.2). En l’espèce, c’est à juste titre que la plaignante affirme être exposée à un préjudice qui dépasse l’inconvénient de pur fait. Par sa demande de mesures provisionnelles, elle cherche notamment à prévenir la divulgation de secrets à des tiers, qui ne pourrait être empêchée par un jugement au principal qui lui serait favorable. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres actes couverts par l’interdiction requise, le préjudice dont elle est concrètement menacée ne peut pas non plus être éliminé par une éventuelle décision future qui lui serait favorable, d’autant plus que les fonctions de programme du logiciel litigieux prétendument utilisées par le défendeur constituent les éléments d’un nouveau produit, pour lequel le chiffre d’affaire et le bénéfice sont inconnus. Il faut en outre partir du principe, avec la plaignante, que les motifs pour lesquels la clientèle pourrait être amenée à choisir des produits de la concurrence, élaborés en utilisant des composants logiciels protégés, sont peu susceptibles d'être démontrables. Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion de la partie défenderesse, il ne faut pas s'attendre à ce que le préjudice dont la plaignante est menacée puisse être réparé par le versement de dommages et intérêts, par une réparation du tort moral ou par la remise du gain (c. 1.3). Relativement aux mesures provisionnelles qu’elle a requis en se fondant sur le droit d’auteur, sur le droit de la concurrence déloyale et sur le droit des contrats, la demanderesse invoque une violation par l’autorité inférieure de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée à l’instance inférieure (c. 4). Quant à l’arbitraire, il ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais seulement du fait que la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit en outre pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (c. 5.1). Selon la demanderesse, l’autorité inférieure a violé de manière « flagrante et arbitraire » plusieurs dispositions de droit fédéral en considérant que, dans la demande de mesures provisionnelles, aucune violation du droit d’auteur n’a été rendue vraisemblable, au motif qu’elle n’a pas démontré les fonctions du programme qui auraient été copiées et la contribution personnelle créative de son employé. La demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de l’art. 9 Cst. : outre le fait qu'elle se fonde de manière irrecevable sur des éléments factuels relatifs au contexte technique de son logiciel et à l'effort de développement qui a été consenti, qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée, elle se contente de présenter son avis juridique sur la protection des programmes d'ordinateur et des parties de programmes ainsi que son avis selon lequel son logiciel est protégé par le droit d'auteur. Elle ne peut démontrer que les considérations de la décision attaquée, selon lesquelles elle n’a ni expliqué le contenu des fonctions prétendument copiées, ni fait de déclarations quant à la contribution créative de son employé, sont arbitraires. Elle affirme avoir montré le contenu des fonctions du programme copiées, mais, dans sa demande de mesures provisionnelles, elle ne révèle pas le code du programme, mais se contente d’une brève description de son objectif, avec des mots-clés individuels. Du point de vue de l'arbitraire, l'objection de la juridiction inférieure selon laquelle la demande de mesures provisionnelles n'était pas suffisamment motivée ne peut pas être contestée. La demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une application anticonstitutionnelle de l’art. 2 LDA en soulignant que l’instance inférieure a elle-même, dans une décision en matière de mesures super-provisionnelles, initialement assumé la protection par le droit d’auteur des composants logiciels en question, l’instance inférieure n’étant bien entendue pas liée par cette décision (c. 5.2). Concernant ses prétentions reposant sur le droit de la concurrence déloyale, la demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction de l’arbitraire. En alléguant une prétendue violation de l’art. 5 LCD, elle s’appuie sur des éléments de fait qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée. Elle n’est pas non plus en mesure de démontrer que l’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle les faits à l’origine de la demande n’ont pas été exposés de manière suffisamment étayée, est arbitraire (c. 5.3). La plaignante ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction d’arbitraire en ce qui concerne ses prétentions contractuelles (c. 5.4). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]
- Art. 1
- Art. 29
- Art. 9
- Art. 5
- Art. 2
- Art. 93
-- al. 1 lit. a
Action en constatation, action en constatation négative, intérêt digne de protection, action en exécution, action formatrice, opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, interprétation du contrat, principe de la confiance, principe de la bonne foi, droit d’être entendu, arbitraire, Von Roll, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 18 al. 1 CO, art. 3 LPM, art. 14 LPM, art. 31 al.1 LPM, art. 33 LPM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 88 CPC.
L’un des plus anciens groupes industriels de Suisse, le groupe Von Roll, s’est restructuré en 2003. Les contrats conclus au moment de la scission ont fait l’objet de plusieurs contentieux. L’un d’entre eux prévoyait notamment que la défenderesse avait le droit d’utiliser et/ou de faire protéger la dénomination sociale « vonRoll » avec les adjonctions « infratec », « hydro », « casting » et « itec », en tant que raison sociale et/ou en tant que marque. En 2017, la défenderesse a déposé quatre marques combinées contenant ces désignations. Après que la demanderesse ait fait opposition à ces enregistrements, la défenderesse a intenté avec succès devant le tribunal cantonal soleurois une action en constatation de droit contre elle. La demanderesse, qui recourt contre le jugement du tribunal cantonal, ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. ou de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. par l’instance précédente (c. 2.2 – 2.4). Elle fait aussi valoir que l’instance inférieure aurait estimé à tort que la défenderesse avait un intérêt à la constatation et qu’elle aurait violé, en entrant en matière sur le recours, les art. 59 al. 2 lit. a et 88 CPC, ainsi que l’art. 52 LPM (c. 3). L’action en constatation de droit vise à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Le demandeur doit établir un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Cet intérêt n’est pas nécessairement de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. Cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Toute incertitude n’est pas suffisante : il faut qu’on ne puisse plus attendre du demandeur qu’il en tolère le maintien, parce qu’elle l’entrave dans sa liberté de décision. Dans le cas d’une action en constatation négative, notamment, il faut également tenir compte des intérêts de la partie intimée, qui est contrainte d’entrer de manière prématurée dans une procédure. Cela enfreint la règle selon laquelle c’est en principe au créancier, et non au débiteur, de déterminer à quel moment il entend faire valoir son droit. Une procédure judiciaire précoce peut désavantager le créancier s’il est obligé de fournir des preuves avant qu’il ait la volonté et les moyens de le faire. En règle générale, l’intérêt à la constatation fait défaut lorsque le titulaire d’un droit dispose d’une action en exécution ou d’une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation. En ce sens, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à ces actions (c. 3.2). C’est à tort que la demanderesse nie l’intérêt à la constatation de la défenderesse, en faisant valoir que l’IPI peut examiner avec un plein pouvoir de cognition s’il existe un risque de confusion, et donc un motif d’exclusion, dans le cadre de la procédure d’opposition pendante en vertu des art. 31 al. 1 et 33 LPM. En réalité, sa cognition est strictement limitée, le conflit de signes devant être évalué tel qu’il ressort du registre. Par conséquent, dans une procédure d’opposition, l’intimé ne peut pas se défendre en faisant valoir que l’opposant ne tient pas compte des accords contractuels. La demanderesse ne peut pas non plus être suivie lorsque, dans le même contexte, elle estime qu’il est (matériellement) sans importance dans la présente procédure que la défenderesse soit habilitée à enregistrer les marques en cause sur la base de la relation contractuelle existant entre les parties. Si la demanderesse est contractuellement obligée de tolérer les enregistrements litigieux, elle ne peut pas invoquer son droit à la marque prioritaire pour les empêcher. Le titulaire de la marque ne peut faire valoir son droit exclusif à l'encontre de la partie contractante que si celle-ci viole le contrat (c. 3.3). L’argument de la demanderesse selon lequel, en vertu du principe de subsidiarité de l’action en constatation, la défenderesse aurait pu introduire une action en exécution pour mettre fin à la situation illicite ne peut pas non plus être suivi. Compte tenu des incertitudes découlant de la relation contractuelle spécifique entre les parties quant à l’admissibilité de l’usage respectif des signes, ainsi que des différents litiges juridiques survenus entre les parties ou entre les sociétés de leurs groupes, la défenderesse a un intérêt digne de protection à ce qu’il soit établi, au-delà de la procédure d’opposition en cours, que ses signes ne portent pas atteinte aux marques de la plaignante. L’incertitude existant dans la relation juridique entre les parties peut être levée par la décision judiciaire demandée, et on ne peut attendre de la défenderesse qu’elle tolère le maintien de cette incertitude (c. 3.4). La demanderesse reproche à l’instance précédente, en se basant sur l’art. 18 al.1 CO, une interprétation erronée des conventions passées entre les parties (c. 4). Compte tenu de la formulation et des circonstances concrètes de la conclusion des deux contrats en cause, la juridiction inférieure a considéré que les parties n’avaient pas eu l’intention, en utilisation la désignation « vonRoll » dans le second contrat, de restreindre l’orthographe de cet élément du signe. Ce faisant, elle a notamment tenu compte du comportement ultérieur de la demanderesse, qui a elle-même utilisé le signe verbal « vonRoll » dans cette orthographe. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations. Même si l’on n’admettait pas qu’il existait une concordance de volontés entre les parties, on ne pourrait reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte des principes d’interprétation pertinents du droit des contrats, conformément au principe de la confiance. Une partie ne peut en effet s’appuyer sur le fait que son cocontractant aurait dû comprendre une disposition contractuelle de bonne foi dans un certain sens que dans la mesure où elle a elle-même effectivement compris cette disposition de cette manière. Si la demanderesse n’a pas compris l’utilisation de l’orthographe « vonRoll » au moment de la conclusion du second contrat comme une restriction de l’utilisation autorisée du signe, elle ne peut attribuer, selon le principe de la bonne foi, un tel sens à cette disposition. En tout état de cause, compte tenu de la disposition contractuelle permettant expressément à la défenderesse d’enregistrer le signe « VON ROLL » avec certains ajouts en tant que « marque verbale et/ou figurative », la simple utilisation d’une orthographe différente dans la deuxième convention, qui ne sert en outre qu’à « confirmer, préciser et compléter » la première, ne saurait être comprise, même d’un point de vue objectif, comme une restriction de la forme d’usage autorisée sans autre indication particulière. Selon le principe de la bonne foi, il ne pouvait être déduit du simple fait de l'orthographe spécifique utilisée qu'une représentation graphique des éléments du mot, telle qu'elle était utilisée dans les marques déposées par la défenderesse, n'était pas contractuellement autorisée (c. 4.3.2). Compte tenu des accords passés entre les parties, la demanderesse ne peut pas s’opposer aux enregistrements effectués en se fondant, sur la base de l’art. 3 LPM, sur ses propres marques prioritaires « VON ROLL » et « VON ROLL ENERGY ». Elle ne dispose d’aucun droit de priorité fondé sur le droit des marques sur le logo déposé par la défenderesse, puisqu’elle admet elle-même que sa marque « VON ROLL » (fig.), incorporant ce logo, a été radiée, et que les marques opposantes sont des marques purement verbales. En conséquence, c’est à raison que l’instance précédente a considéré que, compte tenu des accords conclus entre les parties, les marques déposées par la défenderesse ne violent pas les marques verbales "VON ROLL" et "VON ROLL ENERGY" détenues par la requérante, et que celles-ci ne font pas obstacle à leur enregistrement (c. 4.4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]
- Art. 18
-- al. 1
- Art. 88
- Art. 59
-- al. 2 lit. a
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 33
- Art. 14
- Art. 31
-- al. 1
- Art. 3
- Art. 52
Etendue de la protection, interprétation de la revendication, revendication, description de l’invention, dessin, état de la technique, brevet européen, droit d’être entendu, arbitraire, mesures provisionnelles ; art. 69 CBE 2000, art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 98 LTF, art. 51 LBI.
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) exige que l’autorité entende effectivement les arguments des parties, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. En outre, elle doit motiver sa décision, en indiquant au moins brièvement les considérations essentielles sur lesquelles elle s'est fondée. Par contre, il ne confère pas aux parties le droit d’être entendues sur leur appréciation juridique des faits qu’elles ont introduit dans la procédure. Le droit d’être entendu n’implique pas non plus que le juge doive aviser les parties à l’avance des faits sur lesquels il entend fonder sa décision. Il existe toutefois une exception à ce principe, lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision sur un motif juridique dont les parties ne se sont pas prévalues et dont elles ne pouvaient raisonnablement supputer la pertinence (c. 4.1). L’arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution que celle retenue pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais uniquement du fait qu’une décision est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit manifestement insoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (c. 5.1). Les recourantes ne parviennent à démontrer aucune violation arbitraire de l’art. 51 LBI ou de l’art. 69 CBE 2000, selon lesquels l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, bien que les descriptions et les dessins soient aussi utilisés pour interpréter les revendications. Dans son appréciation de l'étendue de la protection du brevet en cause, l'instance inférieure est partie à juste titre du principe que la formulation des revendications constitue le point de départ de toute interprétation. Conformément aux normes précitées, elle a utilisé la description et les dessins. Comme les recourantes elles-mêmes l’admettent, la formulation de la caractéristique 6.1 de la revendication 1 du brevet européen en cause peut être interprétée de deux manières différentes. Contrairement à ce qu’elles affirment, une interprétation tenant compte de la description et des dessins n’a pas non plus permis d’aboutir à un résultat clair. L’instance précédente est seulement partie du principe que la description fournissait certaines indications étayant la compréhension des recourantes. Le fait qu’elle n’en soit pas restée là, mais qu’elle ait continué à examiner si la compréhension des recourantes était compatible avec une interprétation cohérente des revendications, en tenant compte des autres revendications (dépendantes), n’est pas arbitraire. Au contraire, les revendications dépendantes peuvent également fournir des indications pour la compréhension de la revendication interprétée. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les connaissances techniques générales constituent également un moyen d’interprétation. On ne peut reprocher à l’instance précédente d’avoir agi de manière arbitraire en examinant si l'interprétation de la revendication 1 proposée par les recourantes, qui permettait d'éviter une incohérence entre la revendication 1 et la revendication 4, était techniquement pertinente en donnant aux caractéristiques un sens leur permettant de remplir la fonction qui leur est destinée dans le cadre de l'invention. Le reproche selon lequel l'instance précédente aurait pour ainsi dire « chamboulé » les règles d’interprétation faisant foi est tout aussi infondé que celui selon lequel elle aurait méconnu de manière flagrante le principe d’interprétation reconnu selon lequel le titulaire du brevet supporte le risque d'une définition inexacte, incomplète ou contradictoire. Elles ne démontrent pas non plus le caractère arbitraire de l’interprétation de l’instance précédente de la caractéristique 6.1, pas plus qu’elles ne parviennent à prouver que diverses prémisses juridiques et factuelles sur lesquelles l’instance précédente aurait fondé son « interprétation erronée » seraient infondées. Dans le passage qu’elles critiquent, l’instance précédente fait simplement référence à l’interprétation de la revendication 1 proposée par les recourantes, qui éviterait l’incohérence entre les revendications 1 et 4. La question de savoir si les considérations de l'instance précédente concernant la délimitation des deux revendications sont correctes, ou s’il faut plutôt suivre l’avis des recourantes concernant leur interprétation ne peut être examinée librement dans le cadre d’un recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). En tout état de cause, les considérations qu’émettent les recourantes ne laissent pas apparaître que l’interprétation faite par l’instance précédente de la revendication 1, qui est également couverte par le texte de la revendication, soit manifestement incorrecte (c. 5.2). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]
- européen
- Art. 69
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
- Art. 51
- Art. 98
Contrat de distribution, escroquerie, concurrence déloyale, droit des marques, droit d’auteur, remise du gain, appréciation des preuves, arbitraire, allégation des parties, gestion d’affaires, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, remise du gain, atteinte combinée, concours de causes ; art. 9 Cst., art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 70 CP, art. 62 al. 2 LDA.
Selon l’art. 423 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 62 al. 2 LDA (de même que l’art. 55 al. 2 LPM et l’art. 9 al. 3 LCD), lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (c. 3.1). Cette disposition vise l’hypothèse de la gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi, le gérant intervenant illicitement dans les affaires du maître en agissant non pas dans l’intérêt de ce dernier mais dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. L’art. 423 CO a pour but essentiel d’éviter que le gérant, auteur de l’ingérence, ne profite de celle-ci et qu’il en conserve les profits. La remise du gain remplit ainsi aujourd’hui également une fonction préventive (ou punitive) et plus seulement une fonction de rééquilibrage. Pour que la règle de l’art. 423 CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées : 1) une atteinte illicite aux droits d’autrui, l’intervention du gérant ayant lieu sans cause et ne reposant ni sur un contrat, ni sur la loi. En matière de droit d’auteur, toute utilisation non autorisée des droits appartenant à des tiers est considérée comme une intervention illicite ; 2) le gérant intervenant sans droit dans les affaires d’autrui doit avoir la volonté de gérer celle-ci exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt ; 3) la mauvaise foi du gérant est nécessaire qui est donnée s’il sait ou doit savoir qu’il s’immisce dans la sphère d’autrui sans avoir de motif pour le faire (c. 3.1.1). Si ces conditions sont remplies, le gérant est tenu de restituer au maître le profit (illégitime) qu’il a réalisé, soit tout avantage pécuniaire résultant de l’ingérence qui réside dans la différence entre le patrimoine effectif de l’auteur de la violation et la valeur qu’aurait ce patrimoine en l’absence de toute violation. Le profit doit être en lien de causalité avec l’atteinte illicite incriminée. Il incombe au maître de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’atteinte illicite à ses biens juridiques et les profits nets réalisés par le gérant. A cet égard, une vraisemblance prépondérante suffit (c. 3.1.2). On est en présence d’une « atteinte combinée » ou d’un « concours de causes » lorsque le profit réalisé par le gérant résulte aussi bien de l’atteinte aux biens juridiquement protégés d’un tiers (le maître) que de l’activité licite menée par le gérant lui-même (know-how, qualité de ses services, recours à une campagne de marketing particulièrement réussie, réseau de distribution performant, etc.). La restitution (au maître) ne peut alors porter que sur la partie du profit qui découle de l’atteinte, par le gérant, aux biens juridiquement protégés du maître. Ce concours de causes a été envisagé par le législateur puisque celui-ci a explicitement exprimé sa volonté de laisser le Juge apprécier librement (parmi les divers facteurs ayant permis au gérant de réaliser un gain) la mesure dans laquelle celui-ci résulte de l’atteinte illicite aux biens du maître. Lorsque le gérant ayant porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du maître a également commis une infraction pénale (in casu : une escroquerie) au détriment d’une tierce personne, la part du profit qui en découle (soit le produit de l’infraction) ne devra pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement au dépens du consommateur (lésé), donne naissance à un (nouveau) fondement juridique (distinct de celui à l’origine de la remise de gain) permettant exclusivement à ce lésé de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause (c. 3.1.3). Dans la mesure où la restitution porte sur l’enrichissement net du gérant, le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés. Une évaluation par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO n’est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au Juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de faits qui constituent des indices de l’existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indication plus précise, des prétentions en remise de gain de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le Juge doit refuser la réparation (c. 3.1.4). In casu, en amenant par une construction astucieuse, ses clients à lui payer des montants surfacturés, le défendeur a en réalité adopté un comportement constitutif d’escroquerie. Celui-ci lui a permis de s’enrichir illégitimement au dépens des clients lésés, donnant ainsi naissance à un (nouveau) fondement juridique (distinct de celui applicable pour la remise du gain). L’enrichissement du défendeur découle de la mise en scène, constitutive d’une infraction pénale, que celui-ci a élaborée au préjudice de ses clients. Lésés par les agissements du défendeur, ce sont ses clients qui, sur le plan civil, sont légitimés à demander la restitution de l’indu au défendeur qui s’est enrichi illégitimement (art. 62ss CO ; cf. éventuellement aussi l’art. 70 CP sur la confiscation de valeurs patrimoniales). La défenderesse ne saurait dès lors prétendre au paiement d’un montant dont un tiers (le client lésé) est le seul créancier et qui repose sur un fondement différent de celui qui sous-tend l’art. 423 CO (c. 3.2.1). Le recours est rejeté. [NT]
- Art. 8
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 423
- Art. 62
- Art. 70
- Art. 9
- Art. 62
« Tarif A Fernsehen (Swissperform) » ; recours en matière de droit public, tarifs des sociétés de gestion, équité du tarif, synchronisation, droits voisins, phonogramme disponible sur le marché, vidéogramme disponible sur le marché, support disponible sur le marché, effet rétroactif, règle du ballet, augmentation de redevance, augmentation du tarif ; art. 9 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 46 LDA, art. 59 LDA, art. 60 al. 1 lit. c LDA, art. 74 al. 2 LDA, art. 83 al. 2 LDA.
Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (c. 1.1). Le TF applique le droit d’office mais, au regard du devoir de motivation et de critique, il n’examine que les violations du droit exposées dans le recours, à moins que d’autres manques juridiques soient évidents (c. 2.1). Au surplus, le TF est lié par l’état de fait sauf s’il est manifestement faux ou incomplet sur des points décisifs. Cela doit être démontré en détail par le recours, car le grief repose sur l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire selon l’art. 9 Cst (c. 2.2.1). La règle du ballet, comme la règle pro rata temporis, découle de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA. Elle veut que le pourcentage de redevance soit réduit lorsque d’autres biens immatériels sont utilisés en même temps que ceux faisant l’objet du tarif. L’ampleur de la réduction doit être déterminée de cas en cas (c. 5.4.1 et 5.4.2). La règle du ballet peut s’appliquer lorsque des supports sonores sont synchronisés avec des images. En effet, les supports sonores faisant l’objet du tarif peuvent alors être utilisés avec d’autres oeuvres ou prestations protégées, pour lesquelles une indemnité est également due (c. 5.4.3). Il n’est pas nécessaire que la gestion des droits sur ces autres éléments soit également soumise à la surveillance de la Confédération (c. 5.4.4). Mais en l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de chiffrer la réduction à opérer en application de la règle du ballet. Cela devra être fait à l’occasion de prochaines négociations tarifaires (c. 5.4.5). Les augmentations abruptes de redevances à charge des utilisateurs doivent si possible être évitées. Un changement dans le système de calcul peut conduire à des augmentations tarifaires plus importantes si celles-ci sont dues à une modification des bases de calcul justifiée objectivement. Les augmentations peuvent d’ailleurs être un indice que les redevances antérieures étaient trop basses (c. 6.5.1). La CAF avait décidé d’un plafonnement de la redevance, qui a été supprimé par le TAF. Ce faisant, celui-ci n’a pas suffisamment tenu compte du pouvoir d’appréciation de la CAF. Selon elle, les augmentations tarifaires abruptes doivent être évitées, en particulier lorsque le tarif précédent reposait sur des bases de calcul non suffisamment éclaircies et que le nouveau système a des conséquences imprévisibles (c. 6.5.2). Des indications précises sur les effets du nouveau tarif manquent aussi en l’espèce. Il est donc admissible que la CAF ait plafonné l’augmentation. Le fait que cela désavantage une catégorie de membres de SWISSPERFORM ne peut pas être pris en compte, car la répartition des redevances est une affaire interne à la société de gestion (c. 6.5.4). Puisque les tarifs doivent être négociés entre les parties intéressées, ces dernières peuvent s’écarter des principes prévus à l’art. 60 LDA. Si elles le font sans valeur de précédent, cela ne justifie pas la suppression du plafonnement de l’augmentation tarifaire (c. 6.5.5). Le TF s’est prononcé pour la dernière fois sur l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif dans l’affaire 2C_685/2016 = ATF 143 II 617 ss (c. 7.2). La présente espèce ne concerne pas un effet rétroactif véritable : le tarif a été approuvé pour la première fois le 4 novembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Il s’agit en revanche de corriger la situation due à l’effet suspensif ou aux mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de recours. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, le recours n’a pas d’office un effet suspensif. L’obligation de paiement vaut donc dès l’entrée en vigueur du tarif et ne doit pas être contournée par une ordonnance d’effet suspensif (c. 7.4.1). Cela découle aussi de l’art. 83 al. 2 LDA, qui exprime un principe général à observer, par interprétation téléologique, lorsqu’il faut examiner l’admissibilité d’un effet rétroactif dans un cas particulier (c. 7.4.2). Cette disposition repose sur l’idée que des aspects de nature formelle ne doivent pas influencer l’obligation matérielle de rémunération (c. 7.4.3). Le problème est identique lorsque de nombreuses voies de droit prolongent la procédure : les utilisateurs ne doivent pas pouvoir utiliser gratuitement les droits que la loi leur donne. Lorsque les utilisations passées ne peuvent pas être rémunérées par un supplément sur la redevance courante, une entrée en vigueur rétroactive du tarif ne doit pas être exclue (c. 7.4.4). [VS]
- Art. 9
- Art. 83
-- al. 2
- Art. 59
- Art. 74
-- al. 2
- Art. 60
-- al. 1 lit. c
- Art. 46
- Art. 106
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 1
sic! 10/2020, p. 559 (rés.) « Eurojackpot (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, élément verbal, élément figuratif, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe banal, produits d’imprimerie, loterie, jeu de hasard, jeu, cercle des destinataires pertinent, public adulte, spécialiste, degré d’attention faible, degré d’attention accru, impression d’ensemble, égalité de traitement, bonne foi, recours partiellement admis, couleur ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

|
|---|
« EUROJACKPOT (fig.) » |
Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) » |
|
Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 16 : Produits de l'imprimerie en rapport avec les loteries et leur réalisation, à savoir revues, journaux.
Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); jeux électriques et électroniques, à l'exception de dispositifs accessoires conçus pour être utilisés avec un téléviseur.
Classe 35 : Services de conseils organisationnels et/ou économiques pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.
Classe 36 : Services de conseillers financiers pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.
Classe 41: Organisation et réalisation de loteries et autres jeux d'argent et de hasard; distribution de billets de loterie et autres documents de participation en rapport avec des loteries et autres jeux d'argent et de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard par le biais de canaux de télécommunication, à savoir par Internet; organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, notamment d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de compétitions culturelles (recte: activités culturelles).
Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le domaine des ordinateurs pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard. |
|
Cercle des destinataires pertinent Les produits et services revendiqués s’adressent en premier lieu aux consommateurs de plus de 18 ans participant à des loteries ainsi qu’aux spécialistes des jeux d’argent ou de chance ainsi que de l’organisation de ceux-ci. Les jouets en classe 28 peuvent aussi s’adresser aux personnes non-majeures, mais ceux-ci font également l’objet de fortes restrictions liées à l’âge des utilisateurs (c. 4.2). Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible, ou accru pour les spécialistes (c. 4.3). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM |
|
Conclusion L’enregistrement est refusé dans la mesure où le signe appartient au domaine public et est trompeur (état de fait B). À la suite de la limitation relative à la provenance des produits et services revendiqués, l’instance précédente admet l’enregistrement d’une partie des produits et services revendiqués, mais maintient son refus en relation avec ceux pour lesquels le signe revendiqué est descriptif (état de fait C). Le réexamen d’une demande d’extension de la protection à la suisse d’un signe déjà proposé à l’enregistrement ne viole pas les règles de procédure suisses (c. 1.2). La recourante ne conteste pas le caractère descriptif du signe qu’elle revendique sur le plan typographique. Il est en effet clair que les destinataires comprendront le signe revendiqué comme « gain en euro » ou « jeu d’argent européen ». Si une telle perception est évidente pour la majorité des produits et services, elle ne l’est pas pour « l’organisation d’activités culturelles » en classe 41 (c. 5.3). Les éléments graphiques, la police de type « LED », l’effet brillant, 3D, ou les jeux de lumière (trop liés aux projecteurs dirigés sur le gagnant et donc également descriptifs dans une certaine mesure) sont trop habituels pour influencer la perception des consommateurs (c. 5.4.2). La présentation graphique ainsi que les couleurs sont trop faibles pour effacer le caractère descriptif des mots utilisés (c. 5.4.3). Le signe ne dispose pas de force distinctive et doit être refusé à l’enregistrement (c. 5.5). La recourante se plaint d’une violation de l’égalité de traitement, mais ne présente que des marques dont elle est titulaire (c. 6.2). Elle invoque ensuite la bonne foi (c. 8.1). Les marques font l’objet d’un examen dynamique et peuvent être, une fois enregistrées, radiée du registre. Les marques déposées par la recourante sont trop anciennes, ne requièrent pas les mêmes couleurs où sont revendiqués pour des produits et services différents. La recourante ne peut pas se fonder légitimement sur ces enregistrements et ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions préjudiciables sur cette base (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est admis pour les services d’ « organisation d’activités culturelles » pour lesquels la signification du signe revendiqué n’est pas descriptive, mais est rejeté pour le reste (c. 9). [YB] |
sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
|---|---|
« FIN BEC » |
FIN BEC (fig.) |
|
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 33 : Weine. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne. |
| Contenu de la décision | |
|---|---|
Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 33 : Weine. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3). |
Identité/similarité des produits et services |
Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2). |
Similarité des signes |
Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
--
Force distinctive de la marque
opposante et champ de protection Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5). |
Divers |
La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB] |
sic! 10/2020, p. 520 (rés.) « DesignWorld (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, transfert d’une demande d’enregistrement de marque, vocabulaire de base anglais, design, world, égalité de traitement, recours rejeté, décision étrangère ; art. 9 Cst. art. 2 lit. a LPM.

|
|---|
« DesignWorld. (fig.) » |
Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) » |
|
Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 20 : Möbel ;
Classe 24 : Heimtextilien ;
Classe 35 : Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien. |
|
Cercle des destinataires pertinent Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de la décoration d’intérieur et aux intermédiaires (c. 4). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
|
Conclusion Une marque dont l’enregistrement est demandé peut être transférée comme une marque déjà enregistrée (c. 1.2). Bien qu’il n’ait pas de signification propre, le signe revendiqué sera aisément scindé en « DESIGN » et « WORLD ». Tant les mots « design » que « World » appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris tels quels par les destinataires (c. 5.2). En lien avec les produits et services revendiqués, l’élément « DESIGN » est ainsi descriptif, comme l’élément « WORLD » qui fera référence au lieu où sont proposés les produits et services (c. 5.3). Les éléments graphiques sont banals et n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe (c. 6-6.3). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Elle se base cependant sur des marques trop anciennes ou destinées à d’autres produits et services et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une pratique illégale constante (c. 7.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 8-8.2). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement du signe « DESIGNWORLD. (fig.) ». Le recours est rejeté. [YB] |
- public
-- absolus
- rejeté
- banal
- appartenant au domaine public
- d'une demande d'enregistrement de marque
- anglais
-- world
-- design
sic! 10/2020, p. 560 (rés.) « primeGear » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe laudatif, spécialiste du traitement et des revêtements de surface, spécialiste des outils d’engrenage, outil, vocabulaire de base anglais, prime, gear, égalité de traitement, recours rejeté, ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.
« primeGear » |
|---|
Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear » |
|
Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 40 : Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien ; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen. |
|
Cercle des destinataires pertinent Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes du traitement et des revêtements de surface, ainsi qu’aux spécialistes des outils d’engrenage (c. 3). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
|
Conclusion Le signe « primeGear » n’a pas de signification propre mais peut être aisément scindé en « prime » et « Gear » (c. 5.1). Tant les mots « prime », signifiant comme nom « excellent », « important », ou comme verbe « appliquer une sous-couche », que « gear » signifiant « allure », « boite à vitesse » ou « roue dentée » ou « équipement » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2-5.3). L’élément « prime » est placé tel un adjectif devant le substantif « Gear ». C’est donc la signification de « prime » en tant qu’adjectif qui sera perçue par les consommateurs. Que le substantif « gear » soit compris comme « équipement », « boite à vitesse » ou « roue dentée », son association avec l’élément « prime » sera perçue comme indiquant que la prestation sera effectuée avec des outils de grande qualité (c. 5.3). Le signe revendiqué n’a en conséquence pas de force distinctive en lien avec les services revendiqués (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement mais ne parvient pas à produire un enregistrement comparable (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7). [YB] |
- verbale
-- absolus
- rejeté
- laudatif
- banal
- appartenant au domaine public
- du traitement et des revêtements de surface
- anglais
-- gear
-- prime
Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

|
|---|
« Gourmet (fig.) » |
Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) » |
|
Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 31 : Aliments pour animaux. |
|
Cercle des destinataires pertinent Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
|
Conclusion Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB] |
Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.
« FILMARRAY » |
|---|
Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY » |
|
Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies." Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."
Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."
Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche." |
|
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
|
Conclusion C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB] |
Anglais (langue), voir langue étrangère
- accru
-- anglais
- verbale
-- absolus
- rejeté
- banal
- appartenant au domaine public
- médical
- anglais
-- film
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 2
-- lit. a
- Art. 23
- Art. 32
-- al. 2
Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM
L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante, et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves, de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine et dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]
- sérieux
- Art. 9
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
- Art. 52
-- al. 2
- Art. 48
-- al. 1 lit. c
Sic! 9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ; Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N 1311.
L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable, dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage, au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]
- sérieux
- Art. 9
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
- Art. 52
-- al. 2
- Art. 48
-- al. 1 lit. c
sic! 4/2022, p. 163-166, « Flüssigkeitsstrahl » ; concurrence déloyale, mise en demeure, dénigrement, brevet, juge de formation technique, étendue de la protection, revendication, interprétation de la revendication, interprétation d’un brevet, homme de métier, état de la technique liquide, connaissances techniques, doctrine des équivalents, imitation, droit d’être entendu, arbitraire, courrier, courrier électronique, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 69 al. 1 CBE 2000, art. 51 al. 2 LBI, art. 51 al. 3 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 3 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 2 LCD.
La demanderesse, titulaire d’un brevet concernant un procédé de production d’un jet de liquide en vue de l’usinage d’une pièce, reproche à l’intimée une violation de son brevet. En février 2018, elle a adressé deux courriers de mise en demeure à des partenaires commerciaux de la défenderesse, les menaçant de poursuites civiles et pénales pour leur participation, en se fondant uniquement sur une demande de brevet de la défenderesse, sans savoir quels produits cette dernière produisait et vendait en réalité. En mai 2020, durant la procédure en contrefaçon de brevet qu’elle avait ouverte contre l’intimée, la demanderesse a adressé un courriel d’avertissement à une autre de ses partenaires commerciales, alors même que le juge spécialisé avait rendu, en mai 2020, un avis concluant à la non-violation. L’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications (art. 51 al. 2 LBI et art. 69 al. 1 CBE 2000). Les instructions techniques décrites dans les revendications doivent être interprétées de la manière dont l’homme du métier les comprend. Le point de départ de toute interprétation est leur texte. La description et les dessins doivent aussi être pris en compte (art. 51 al. 3 LBI et art. 69 al. 1 2ème phrase CBE 2000). Les connaissances techniques générales constituent également un moyen d’interprétation en tant qu’état de la technique liquide. La description et les dessins ne servent qu'à interpréter la revendication dans la mesure où le texte n'est pas clair, mais et non à la compléter. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l'objet de l'invention dans la revendication, et supporte le risque d'une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire (c. 2.1). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) exige que l'autorité entende effectivement les arguments des parties, les examine et en tienne compte dans sa décision. Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Elle n'est pas tenue de se déterminer en détails sur chacun des points soulevés par les parties, ni de réfuter expressément chaque argument. Elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision. La motivation doit toutefois être rédigée de manière à ce que les personnes concernées puissent se rendre compte de la portée de la décision et la porter en toute connaissance de cause devant l'instance supérieure. Dans ce sens, il faut au moins mentionner brièvement les considérations qui ont conduit l’autorité à prendre sa décision. Le droit d'être entendu comprend aussi le droit de la partie concernée de s’exprimer dans une procédure susceptible de modifier sa situation juridique, ainsi que de fournir, en temps utile et dans la forme prescrite, des preuves pertinentes (c. 3.1.1). Selon la jurisprudence, l’arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais seulement du fait que la décision attaquée est manifestement insoutenable, clairement en contradiction avec la situation effective, qu'elle viole de manière flagrante une norme ou un principe juridique incontesté ou qu'elle contrevient de manière choquante à l'idée de justice. En outre, le Tribunal fédéral n'annule une décision que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (c. 3.1.2). L'instance précédente a fondé son appréciation de l'utilisation de l’invention brevetée (par imitation au sens de l’art. 66 lit. a LBI) sur la doctrine des équivalents, développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui recourt aux éléments de l’équivalence de la fonction, de l’évidence et de l’équivalence. Elle est arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas en l’espèce d’imitation de l’invention brevetée (c. 3.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’instance précédente n’a pas tenu compte de ses allégations et des moyens de preuve présentés. Il n’y a pas en l’espèce de violation du droit d’être entendu (c. 3.3). Le reproche d’arbitraire est lui aussi infondé, et la conclusion de l’instance précédente selon laquelle il n’y a pas d’utilisation de l’invention brevetée par des moyens équivalents est maintenue (c. 3.4). Même si des mises en demeures peuvent être fréquentes dans certains secteurs, il n’en reste pas moins qu’une accusation injustifiée de violation d’un droit de propriété intellectuelle peut constituer un dénigrement au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a LCD (c. 6.2). L’avertissement injustifié doit être distingué de la défense justifiée contre les violations des droits de propriété intellectuelle. L’enregistrement d’un brevet autorise son titulaire à le défendre contre les violations commises par des tiers, et l’application de la LCD ne doit pas limiter les possibilités d’action de celui qui, de bonne foi, veut faire valoir ses droits réels ou supposés. A cet égard, il ne faut pas considérer comme une violation du principe de la bonne foi le fait qu'au moment de l'avertissement, l'incertitude régnait encore quant à l'existence ou à la violation du brevet invoqué, puis que la nullité ou la non-violation a été constatée lors du procès qui a suivi. Le titulaire du brevet agit toutefois de manière déloyale lorsqu'il sait qu'il n'y a pas de contrefaçon ou qu'il doit au moins avoir des doutes sérieux quant à la véracité de l’accusation de contrefaçon. Il convient de noter que l’admissibilité des avertissements adressés à des tiers doit être soumise à des exigences plus strictes que celle des avertissements adressés aux auteurs directs de violations (c. 6.3). C’est à juste titre que l’instance précédente s’est fondée sur le fait que la recourante a donné l’impression, dans ses lettres de février 2018, de connaître la technologie prétendument contrefaisante de manière suffisamment précise pour qu’une appréciation en droit des brevets soit possible, alors qu’elle ne se fondait en réalité que sur la demande de brevet de la défenderesse. Compte tenu des circonstances de fait, c’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la demanderesse devait avoir des doutes sérieux quand à l’exactitude de son accusation de violation de son brevet. Les courriers adressés en 2018 à des partenaires commerciaux de la défenderesse, qui présentaient clairement un caractère de mise en demeure en raison de leur référence aux sanctions civiles et pénales encourues en raison d’éventuels actes de participation, ne constituaient pas, selon les règles de la bonne foi, une mesure de défense justifiée pour la protection du brevet. C’est d’autre part à juste titre que l’instance précédente a considéré que la demanderesse devait avoir des doutes sérieux quant à son allégation de violation de son brevet au moment de l’envoi de son courriel, en mai 2020, dans lequel elle menaçait un autre partenaire commercial de la défenderesse sans mentionner l’avis du juge expert (c. 6.4). L’instance précédente a considéré que les lettres et le courriel violaient l’art. 3 lit. a LCD, et que les intimées étaient en droit, en vertu de l’art. 9 al. 2 LCD, d’exiger une clarification vis-à-vis de tous les destinataires (c. 7.1), impliquant l’obligation de les informer de l’issue de la procédure, et d’en obtenir copie. Cette sanction n’est pas disproportionnée (c. 7.3). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]
- Art. 69
-- al. 1
- Art. 29
- Art. 9
- Art. 66
-- lit. a
- Art. 51
-- al. 3
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. a
- Art. 9
-- al. 2
sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.
« LOCKIT » |
|---|
Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT » |
|
Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT » |
|
Liste des produits et services revendiqués Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux. |
|
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2). |
|
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
|
Conclusion Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB] |
Pachmann, Bachmann, avocat, activité d’avocat, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, contenu sémantique, usage à titre de marque, violation du droit d’être entendu, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, arbitraire, maxime des débats, risque de confusion, droit au nom ; art. 9 Cst., art. 9 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 29 CC, art. 55 CPC, art. 150 al. 1 CPC, art. 951 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. c LCD.
La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (c. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent par possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (c. 3.2 et c. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (c. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (c. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (c. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]