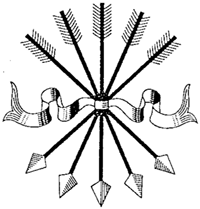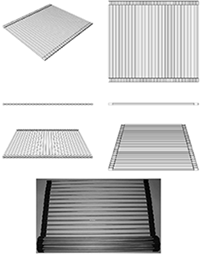Concurrence
déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force
distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise
par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce,
imposition par l’usage, dilution de la force distinctive,
similarité des produits ou services, similarité des signes,
similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur
le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique,
priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur
moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique
suffisant, action défensive, péremption, abus de droit,
surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet,
nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop,
recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1
lit. d LCD, art. 9 LCD.
La
défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement
active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe
« Lumimart », des magasins spécialisés dans
l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources
lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique
en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La
défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998,
avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2)
dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La
recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite
les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise
le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En
2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de
faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des
lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de
domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des
signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD
(c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale
imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en
œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est
accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de
géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide
de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances
techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété
intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités
territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant
avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence
d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La
demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse
ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la
territorialité du droit suisse », comme le prétend la
recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la
simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne
constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes
distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de
la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par
exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs
suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire
à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde
entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer
l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique.
La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être
contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le
prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La
création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la
concurrence déloyale que si le signe imité présente une force
distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou
dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance
précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart »
et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs,
car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen
francophone et italophone comme se rapportant au marché de
l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force
distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse
présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en
raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces
considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2).
Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une
partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il
désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c.
7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une
question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans
un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal
fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF.
En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été
dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2).
L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart »
et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force
distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux
logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire
faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la
position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses
importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique
(c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette
appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche
ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère
distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que
la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont
imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans
lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En
droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne
s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit
dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du
caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée
la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton.
S’il est établi que le signe est compris par une partie
considérable des destinataires en Suisse comme une référence à
une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires
considérables, la protection concerne également l’ensemble de la
Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le
logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il
n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine
admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même
immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2)
était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement
influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son
tour imposé sur le marché. La recourante considère également que
le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre
2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur
le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en
mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même
dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés
depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution.
Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue
d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours
comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait
qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel
n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les
signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison
d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise
les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs
(notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si
fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas
le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que
l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée
sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création
d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect
(c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un
risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux
parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de
luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en
cause donnent l’impression de provenir d’entreprises
économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs
sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un
lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2).
L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les
produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont
proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs
mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie
superposés : la recourante n’est présente sur le marché
suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de
succursale. La défenderesse vend également ses produits par le
biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente
physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail.
Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments
verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont
la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et
sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs
séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan
sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant
au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public
concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les
signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour
l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs
significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué
principalement sur la base du caractère distinctif acquis par
l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à
raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés
par la recourante étaient trop similaires à ceux de la
défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à
appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à
l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des
logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des
signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante,
qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en
tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme
illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a
considéré que la similarité des signes entraîne un risque de
confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe
depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable,
peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité
d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est
pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que
la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe
« Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut
aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que
les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le
marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que
l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de
manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en
utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par
conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La
recourante considère que les actions de la défenderesse sont
périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11).
La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en
raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2
CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions
défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également
être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il
convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la
concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD,
protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les
intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non
faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et,
en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de
signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée
uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être
examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2
al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est
manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant
ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il
ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence
requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une
longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne
foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par
le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses
droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi
à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne
s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1).
L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il
est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent
atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il
est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû
avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur
de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le
contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa
responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il
doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant
connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien
entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la
concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a
considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale
de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les
visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés
vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son
tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations
ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le
commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas
partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous
les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas
d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante,
qui fait référence aux « possibilités et moyens
considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le
marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était
en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse
connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du
signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au
vu de « l'usage encore plus intensif » du signe
« Luminarte » à partir de 2013, une période de trois
ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1).
La période de tolérance après laquelle la péremption doit être
admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La
jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue
entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption
a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans.
Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La
question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction
pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le
concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut
être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de
telles circonstances particulières étaient présentes déjà après
une période de trois ans et demi. En particulier, il est important
que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier
la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence
ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de
confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de
l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas
d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2).
La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les
prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à
l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à
juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante
a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte »,
« luminarte.de », « luminarte.ch » et
« Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un
risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée.
Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours
est rejeté (c. 13). [SR]


 utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque
utilisé ne diverge pas essentiellement de la marque  enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe
enregistrée de sorte que, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, l'usage du signe  est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque
est quant à lui également assimilé à l'utilisation de la marque  ,
l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant
doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la
fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes
,
l'usage de cette marque (ou de l'une de ses variantes) par le requérant
doit être assimilé, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, à l'usage par la
fabricante (c. 6.6-6.6.3.7). Par l'usage des signes
 — déposées après la marque
— déposées après la marque