À la différence de l'action en exécution (art. 62 LDA), l'action en constatation (art. 61 LDA) n'est pas susceptible d'être touchée par la péremption (art. 2 CC). Toutefois, selon les circonstances, l'intérêt légitime à la constatation exigé par l'art. 61 LDA (qui implique une incertitude — sur un droit ou sur les relations juridiques des parties découlant du droit d'auteur — susceptible d'être éliminée par une constatation judiciaire) peut être nié en cas de retard à agir (c. 3.2). En l'espèce, le recourant a un intérêt légitime à la constatation de sa qualité d'auteur du « Guide orange » (manuel d'intervention pratique destiné aux sapeurs-pompiers). Il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir agi pendant les 27 années durant lesquelles les relations entre les parties ont été harmonieuses. Par ailleurs, en raison de l'incessibilité des droits moraux, l'intérêt d'une personne physique à faire constater qu'elle est l'auteur d'une œuvre ne saurait disparaître par l'écoulement du temps (c. 3.3). La reconnaissance judiciaire de la qualité d'auteur d'une œuvre ne préjuge toutefois pas de la cession préalable par l'auteur, dans le cadre par exemple du contrat de travail qui lie les parties, de droits moraux transmissibles ou de droits patrimoniaux (c. 3.3). La disposition originale de la matière (par fiches d'intervention comprenant, pour chaque produit, en tout cas une étiquette chimique, le numéro ONU, une échelle des dangers, une description du produit et de ses dangers, différentes rubriques indiquant aux intervenants comment agir au mieux selon les situations, ainsi qu'une indication des constantes) rend le « Guide orange » individuel et en fait une œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA (c. 4.2). Est coauteur celui qui concourt de manière effective à la détermination définitive de l'œuvre ou à sa réalisation. Sa contribution peut résider dans la forme ou dans la structure du contenu, pour autant qu'elle revête l'individualité nécessaire. En l'espèce, le recourant est coauteur du « Guide orange », car il ne s'est pas limité à exécuter les instructions de son employeur (c. 4.3).
Disposition
CC (RS 210)
ATF 133 III 360 ; sic! 9/2007, p. 619-622, « Contratto di licenza » ; contrat portant sur la marque, contrat de licence, résiliation, contrat de travail ; art. 9 Cst., art. 2 CC, art. 271 al. 1 CO, art. 337 CO, art. 18 LPM.
Un contrat de licence ne peut pas être résilié avec effet immédiat selon les dispositions applicables au contrat de travail. Une résiliation non conforme au contrat ne saurait déployer ses effets que si elle est fondée sur de justes motifs et si elle n'est pas contraire aux règles sur la protection de la bonne foi, faute de quoi le rapport contractuel subsiste.
- Art. 2
- Art. 337
- Art. 271
-- al. 1
- Art. 9
- Art. 18
sic! 10/2013, p. 612- 620, « Comparis ; Comparis.ch / www.comparez.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de domaine, contenu d’un site Internet, comparez.ch, risque de confusion nié, exploitation de la réputation, similarité des produits ou services, similarité des signes, domaine de deuxième niveau, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, principe de la spécialité, concurrence déloyale ; art. 2 CC, art. 29 CC, art. 3 LPM, art. 15 LPM, art. 3 LCD.
Sauf en présence d’une marque notoire au sens de l’art. 15 LPM, l’examen du contenu du site Internet est nécessaire pour déterminer le risque de confusion entre un nom de domaine et une marque, vu le principe de la spécialité qui s’applique en droit des marques. Même dans les autres domaines juridiques, il paraît difficile de faire abstraction du contenu du site, dès lors que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances (c. 4.2.2). Si le public est provisoirement induit en erreur, mais que la méprise peut être corrigée en raison des circonstances – donc aussi en raison du contenu du site – il n’y a pas de risque de confusion, mais éventuellement une exploitation de la réputation d’autrui (c. 4.2.3). Celle-ci implique que l’on utilise un signe comme nom de domaine pour profiter de la renommée d’un tiers et diriger les internautes vers son propre site Internet. Il s’agit d’une notion pertinente en concurrence déloyale, en droit au nom et pour les marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.4). En l’espèce, les services commercialisés par les parties sont semblables (c. 4.3.3.2). Pour apprécier la similitude des signes, c’est avant tout le domaine de deuxième niveau qui est déterminant (c. 4.3.3.3.3). En l’espèce, l’élément « compar », qui est commun au nom de domaine litigieux et aux marques protégées, relève du domaine public (c. 4.3.3.3.2). Les internautes savent que le moindre détail a son importance en matière de nom de domaine. Lorsqu’un signe est utilisé exclusivement comme nom de domaine sur Internet, de petites différences par rapport à la marque protégée suffisent à exclure la similitude (c. 4.3.3.3.3). La prononciation des mots « comparez » et « comparis » n’est pas identique (c. 4.3.3.3.5). Le faible caractère distinctif d’une marque peut être accru par la publicité et l’usage de cette marque.Mais cela ne va pas jusqu’à empêcher un tiers d’utiliser des éléments de la marque appartenant au domaine public (c. 4.3.3.4.2). De même, le droit de la concurrence déloyale ne permet pas d’interdire l’utilisation d’une désignation relevant du domaine public selon le droit des marques (c. 4.4.1). Le seul fait d’employer la désignation usuelle « comparez » ne suffit pas à démontrer une exploitation de la réputation d’autrui au sens du droit de la concurrence déloyale (c. 4.4.2.3). [VS]
sic! 9/2014, p. 560-562, « Netzstecker » ; action en dommages-intérêts, action en remise du gain, licence exclusive, remise du gain, mauvaise foi, violation d’un brevet, fardeau de la preuve, vraisemblance, pouvoir d’appréciation, frais ; art. 2 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 423 CO, art. 73 LBI.
Le lésé au bénéfice d’une licence exclusive peut agir en dommages-intérêts aux conditions qui prévalent en droit des obligations ou, alternativement, en remise du gain, selon les dispositions applicables en matière de gestion d’affaires sans mandat (art. 423 CO) (c. 4.2). Le gain consiste alors en la différence entre le patrimoine effectif du contrefacteur et la valeur de ce même patrimoine s’il n’avait pas commercialisé les contrefaçons (en l’espèce des prises d’alimentation électrique (Netzstecker). Le revenu net étant déterminant, il convient de déduire les coûts engagés par le contrefacteur. La jurisprudence soumet de surcroît l’action en remise de gain à la condition de la mauvaise foi du contrefacteur. Agit notamment de mauvaise foi celui qui savait, devait savoir ou pouvait savoir qu’il agissait de manière contraire au droit (art. 2 CC). Cette condition est remplie si le contrefacteur maintient son activité litigieuse suite à la réception d’un courrier de mise en demeure l’informant qu’il agit de manière contraire au droit. Il en va de même lorsqu’un commerçant spécialisé dans les appareils high-tech commande, sans effectuer de recherches préalables, un produit potentiellement protégé, dans un pays dont il est connu qu’il n’offre pas une protection adéquate des droits immatériels (c. 4.3). Le fardeau de la preuve du gain manqué est supporté par le lésé. L’art. 42 al. 2 CO s’applique par analogie à l’action en remise du gain lorsqu’il n’est pas possible d’établir le gain manqué de manière exacte. Il suffit au lésé de rendre sa prétention plausible sur le fond et sur son étendue. Il n’est pas nécessaire que des factures détaillées soient produites. La remise du gain est au surplus conditionnée à la violation d’un droit. Il faut alors déterminer dans quelle mesure le droit violé est à l’origine de la décision d’achat ou si d’autres circonstances ont joué un rôle prépondérant dans ce cadre. La réponse à cette question relève du pouvoir d’appréciation du juge (c. 4.3). Les frais d’avocat et d’agent de brevets engagés par le lésé avant le procès en vue de contrôler l’existence d’une violation d’un brevet ou de faire notifier des courriers de demeure à la partie adverse constituent des frais en lien direct avec le procès. Leur remboursement peut être exigé par le lésé (c. 4.5). [FE]
sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]
- Art. 8
- Art. 2
- Art. 933
-- al. 1
- Art. 956
- Art. 951
-- al. 2
- Art. 52
- Art. 5
-- al. 1 lit. c
-- al. 1 lit. a
- Art. 9
- Art. 12
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2
- Art. 15
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
-- al. 1
- Art. 107
-- al. 1
- Art. 75
-- al. 2
-- al. 2 lit. a
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 99
-- al. 2
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.
Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]
- Art. 27
-- al. 2
- Art. 28
-- al. 2
- Art. 2
- Art. 12
-- al. 3
- Art. 11
-- al. 2
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 2
TFB, 6 décembre 2016, S2016_004 (d) (mes. prov.)
Action en interdiction, mesures provisionnelles, imitation, doctrine des équivalents, fonction objective, solution équivalente, limitation d'une revendication, Prosectuion History Estoppel, bonne foi, principe de la confiance ; art. 69 CBE ; art. 66 a LBI ; art. 2 CC
Afin de déterminer si l’on se trouve en présence d’une imitation illicite d’une invention brevetée, il convient d’appliquer la doctrine des équivalents. Se posent alors trois questions : 1. Les caractéristiques substituées remplissent-elles la même fonction objective (même effet) ? On se fondera ici sur les principaux effets innovants découlant du brevet. 2. Les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont-elles rendues évidentes à l’homme du métier par l’enseignement du brevet (accessibilité) ? Ce n’est pas l’état de la technique, mais le brevet litigieux qui constitue le point de départ pour répondre à cette question. 3. Enfin, l’homme de métier, en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, aurait-il considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente ? (c. 4.5.2, c. 4.6.1.). Même si la Suisse, comme d’autres pays européens d’ailleurs, ne connaît pas la Prosecution History Estoppel, l’historique de la procédure du dépôt du brevet peut et doit même être prise en considération en particulier si une revendication a été limitée par le déposant afin d’obtenir le brevet. En application du principe de confiance énoncé à l’art. 2 CC, le titulaire du brevet est lié par les limitations qu’il a faites à son brevet dans le cadre de la procédure d’octroi. Il ne peut pas, par la suite, contourner ces limitations par la voie de la doctrine des équivalents (c. 4.5.3). [DK]
« VW-LAND TOGGENBURG », usage à titre de marque, droits conférés par la marque, risque de confusion indirect, publicité, enseigne, péremption ; art. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.
L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’une marque d’interdire à des tiers l’utilisation d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, et en particulier de l’apposer sur des papiers d’affaires ainsi que de l’utiliser à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans les affaires. L’art. 3 al. 1 LPM exclut de la protection les signes plus récents en particulier lorsqu’ils sont si similaires à une marque antérieure qu’il en résulte un risque de confusion. Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. C’est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux liens entre leurs titulaires. Le commerçant qui utilise la marque d’un tiers pour offrir des produits originaux de cette marque ou pour faire de la publicité pour des travaux ou des services se rapportant à de tels articles ne viole pas le droit des marques si sa publicité se réfère clairement à ce qu’il offre en propre. Chacun peut utiliser les indications décrivant sa propre offre de produits ou de services, même si des marques de tiers sont ainsi touchées. Les titulaires de marques ne peuvent pas prescrire aux revendeurs de leurs produits originaux ou à ceux qui fournissent des prestations en lien avec ceux-ci comment les mettre en circulation, ni comment en faire la publicité. Toutefois, la publicité générale de la marque qui, sans lien avec un assortiment de produits déterminés ou de services concrets, porte sur l’apparence et la renommée de la marque elle-même auprès du public en général demeure réservée au titulaire de la marque. La publicité recourant à la marque d’un tiers trouve également ses limites lorsqu’elle éveille auprès du public l’impression erronée de l’existence de liens particuliers entre le titulaire de la marque et celui qui s’y réfère pour promouvoir l’offre qui lui est propre (c. 2.2.1). Dans le cas particulier, l’indication « VW-LAND TOGGENBURG » désigne le garage exploité par la recourante. Le signe revêt une fonction distinctive dans la mesure où il individualise les locaux commerciaux de la recourante qu’il distingue des autres garages. Il y a ainsi un usage concurrent (« Mitgebrauch ») à titre distinctif de la marque VW de la demanderesse. L’utilisation conjointe (« Mitverwendung ») d’un signe comme enseigne, respectivement pour désigner une activité commerciale, tombe aussi sous le coup du droit exclusif conféré par la marque à son titulaire selon l’art. 13 al. 2 lit. e LPM. Peu importe que la désignation « VW » soit une information utilisée de manière descriptive par la recourante pour donner des indications sur son offre. La mention « VW-LAND TOGGENBURG » éveille auprès du public l’impression erronée qu’une relation particulière existerait entre le titulaire de la marque et l’exploitant du garage. Le public n’y voit pas l’offre large de certains produits de marque mais la désignation d’une entreprise du titulaire de la marque ou en tout cas présentant certains liens avec celui-ci (c. 2.2.2). Il y a péremption du droit d’agir et la mise en œuvre d’un droit est abusive lorsqu’elle contredit un comportement antérieur et déçoit les attentes légitimes ainsi suscitées. En l’espèce, l’action en interdiction ouverte par l’intimée n’est pas en contradiction avec sa passivité antérieure. En effet, tant que la recourante a été la représentante et la fournisseuse de services agréé d’une des demanderesses (soit pendant plus de 10 ans) elle était contractuellement autorisée à utiliser la marque concernée. Elle n’a donc pas porté atteinte à cette marque et aucune attente légitime n’a pu être éveillée chez elle concernant une autorisation de continuer l’utilisation de la marque après la fin du contrat. Seule n’est ainsi à prendre en compte pour déterminer s’il y aurait péremption du droit d’agir, la durée pendant laquelle le signe « VW-LAND TOGGENBURG » a été utilisé entre la fin des relations contractuelles entre les parties à mi-2014 et le dépôt de la demande début octobre 2016. La recourante a pendant cette période fait l’objet de plusieurs mises en demeure écrites de la part d’une des demanderesses (en particulier en août 2014 et en mai 2015), il n’y a donc pas péremption du droit d’agir au sens de l’art. 2 CC (c. 2.3). [NT]
-- indirect
Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.
La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]
Action, voir ég. cumul d’actions
- moyen
- moyen
- de grâce
-- faible
- verbale
- combinée
-- relatifs
- rejeté
- Art. 2
- Art. 12
-- al. 1
- Art. 55
-- al. 1 lit. a
- Art. 13
-- al. 2 lit. e
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 52
- Art. 11
-- al. 1
sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Sherlock + Sherlock’s » ; Demande de radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, abus de droit, qualité pour agir, légitimation active, swissness, usage de la marque, preuve du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve ; art. 2 CC, art. 35a LPM
La recourante conteste la demande de radiation concernant les marques N°517'858 « SHERLOCK’S », et N°461’529 « SHERLOCK » effectuée par l’intimée au motif que celle-ci commet un abus de droit dans la mesure où elle a pour seul objectif d’agir contre les marques de la recourante mais ne prévoit pas d’utiliser elle-même les marques ainsi radiées (état de fait A et B). Bien que l’abus de droit n’ait été invoqué que lors du recours, les documents déposés par la recourante qui se rapportent à des faits produits avant l’admission des demandes de radiation doivent être pris en compte (c. 2.2). Comme l’abus de droit invoqué concerne la légitimation de l’intimée et qu’il s’agit d’une condition procédurale, le TAF doit l’examiner dans la procédure de recours et entendre les arguments de la recourante (c. 2.3). La demande de radiation pour défaut d’usage de l’art. 35a LPM est entrée en vigueur avec le paquet Swissness et a pour but de permettre une procédure plus simple et moins coûteuse que l’alternative qu’est la procédure civile (c. 3.2). Une marque n’est protégée que si elle est utilisée (c. 3.3). C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance du non-usage d’une marque. Le titulaire peut contester les éléments rendant vraisemblable le non-usage, démontrer qu’il utilise bien sa marque ou faire valoir des motifs légitimes (c. 3.4). La recourante considère que l’intimée commet un abus de droit dans la mesure où aucun intérêt à agir ne légitime sa demande de radiation (c. 4.1). L’intimée a respecté les prescriptions de forme et payé les frais afférents à sa demande de radiation (c. 5). La demande, ouverte à « toute personne », est fondée sur l’intérêt public à la bonne tenue du registre. De plus, la protection s’éteint non pas dès la radiation, mais dès que la marque n’est pas utilisée. Cette ouverture est limitée par la difficulté pour le demandeur de rendre vraisemblable le non-usage, mais est justifiée par l’insécurité juridique générée lorsqu’une marque est enregistrée mais pas utilisée (c. 5.1). Cette obligation de motivation doit prévenir les abus de droit (c. 5.2). C’est donc à raison que l’instance précédente a admis à l’intimée un intérêt à agir (c. 5.3). La demande peut cependant être abusive nonobstant l’intérêt public à la tenue du registre. Le TAF a ainsi considéré que l’abus de droit ne peut être invoqué dans une procédure d’opposition que contre les arguments disponibles dans cette procédure par exemple si la titulaire de la marque attaquée est responsable du non-usage de la marque opposante (c. 6.1). L’intérêt pour agir qui peut exceptionnellement faire défaut dans une procédure d’opposition, par exemple lorsque le demandeur ne peut ou ne doit pas utiliser le signe en question. Cette pratique ne se fonde pas sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 CC, mais sur la nécessité d’un intérêt privé à la protection juridique dans la procédure civile qui n’existe pas dans la procédure administrative de radiation fondée sur l’intérêt public à la tenue du registre (c. 6.2). Le fait que l’intimée soit un « troll » des marques n’impacte pas sa légitimité pour agir (c. 7.1). La recourante n’a pas déposé de preuves supplémentaires destinées à rendre l’usage de ses marques vraisemblable (c. 7.2). L’intimée a demandé la radiation de deux marques et rendu vraisemblable leur non-usage. C’est à raison que l’instance précédente a admis la demande de radiation. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]
- active
HG AG, 7 novembre 2007, HOR.2006.3 (d)
sic! 10/2008, p. 707- 713, « SBB-UhrenIII » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, œuvre, œuvre des arts appliqués, horlogerie, CFF, individualité, élément fonctionnel, design, conditions de la protection du design, œuvre dérivée, péremption, bonne foi, prescription ; art. 2 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 60 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA.
Cf. N 21 (arrêt du TF dans cette affaire).
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 60
- Art. 423
- Art. 62
- Art. 41
- Art. 2
-- al. 2 lit. f
sic! 9/2007, p. 635-638, « Bugatti » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, péremption, bonne foi, réputation, notoriété, marque notoirement connue ; art. 2 al. 2 CC, art. 12 LPM, art. 15 LPM.
En ce qui concerne les conditions de la péremption du droit d'agir, à côté de l'écoulement d'une longue période d'inaction, il est nécessaire que le défendeur se soit constitué une situation digne de protection pour que le demandeur soit déchu de la possibilité de faire valoir ses droits. La notion de marque de haute renommée doit correspondre au but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger ces marques contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celles-ci et la mise en danger de leur caractère distinctif. On est en présence d'une marque de haute renommée lorsque la force publicitaire de la marque facilite la vente d'autres produits que ceux pour lesquels elle était destinée à l'origine et lorsqu'elle est connue en dehors du seul cercle des acheteurs potentiels des produits originaires. La notoriété d'une marque ne doit pas être confondue avec sa haute renommée, qui n'est pas donnée du simple fait qu'une marque est connue d'un large public, mais qui nécessite que cette dernière bénéficie en plus d'une image généralement positive auprès du public.
KG ZG, 29 mai 2008, A3 2008 39 (d)
sic! 1/2009, p. 39-42, « Resonanzetikette III » ; action, action en remise du gain, violation d’un brevet, preuve, estimation, péremption, prescription, délai, registre des brevets, faute, dol, mauvaise foi, diligence, intérêts ; art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 60 al. 2 CO, art. 73 CO, art. 423 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP.
Il n'est pas possible d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie afin de procéder à une estimation lorsque, faute d'une comptabilité en règle, l'entreprise, gérante (art. 423 CO), n'est pas en mesure de prouver les coûts de revient qu'elle allègue (c. 3.3). L'action en délivrance du gain n'est pas périmée (art. 2 al. 2 CC) en raison du fait qu'elle n'est déposée, vu la complexité de la situation, que deux ans après la connaissance de la violation du brevet, ce d'autant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le lésé entendait ainsi profiter économiquement de la violation du brevet (c. 4.4). L'action qui découle de la violation intentionnelle d'un brevet est soumise au délai de prescription pénal de 5 ans (art. 60 al. 2 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP). La seule présomption légale de la connaissance du contenu du registre des brevets européens ne suffit pas à établir l'existence d'une violation intentionnelle (dol ou dol éventuel) (c. 5.3). Afin de prétendre à la restitution du gain, le lésé doit prouver la mauvaise foi ou la faute du gérant (art. 423 CO, art. 8 CC). Viole son devoir de diligence et est de mauvaise foi la personne qui, avant de fabriquer et de commercialiser un produit (dans un domaine très spécialisé), néglige de s'assurer qu'une telle activité ne viole pas les brevets de tiers (c. 7.3). En cas de restitution du gain, un intérêt compensatoire de 5 % (art. 73 CO) est dû à partir du moment où le fait dommageable a eu des effets financiers (c. 8.1).
- Art. 8
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 73
- Art. 60
-- al. 2
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 423
- Art. 70
-- al. 3
- Art. 81
Action, action en fourniture de renseignements, violation d’un brevet, cause à caractère pécuniaire, droit international privé, droit étranger, arbitraire, décision étrangère, contrat, prescription, délai, abus de droit ; art. 96 lit. b LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 18 LDIP, art. 117 al. 2 et 3 LDIP, art. 148 LDIP, § 199 al. 1 dBGB.
En vertu des art. 117 al. 2 et 3 et 148 LDIP, le droit allemand est applicable à la demande de renseignements litigieuse (c. 2). D'après l'art. 96 lit. b LTF, dans une affaire pécuniaire, un recours ne peut être formé que pour application arbitraire (c. 2.2) du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (c. 2.1). Les recourantes ont été condamnées en Allemagne, dans le cadre d'un jugement constatant la violation d'un brevet, à fournir à B. des renseignements portant sur la commercialisation de cartouches d'encre (c. A). Ne constitue pas une application arbitraire du § 199 al. 1 dBGB le fait de considérer que le délai de prescription (de 3 ans) — auquel est soumis le droit à des renseignements (au sujet d'informations auxquelles les recourantes n'avaient pas accès dans le cadre de leurs rapports contractuels avec l'intimée) litigieux (c. 3) — a commencé à courir le 31 décembre 2003, c'est-à-dire à la fin de l'année durant laquelle le jugement allemand a été rendu et durant laquelle les recourantes ont donc eu connaissance du fondement de leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée. N'y change rien le fait que B. n'ait (par écrit), que le 25 février 2008, invité les recourantes à faire valoir leur droit à des renseignements à l'encontre de l'intimée (c. 3.1-3.2). En application de l'art. 18 LDIP et vu que la cause présente un lien suffisant avec la Suisse, c'est conformément au droit suisse (art. 2 al. 2 CC) que doit être jugée la question de savoir si l'exception de prescription est soulevée de manière abusive par l'intimée (c. 4.1). En l'occurrence, le comportement de l'intimée n'est pas constitutif d'un abus de droit (c. 4.2).
- Art. 2
-- al. 2
Droit allemand
- dBGB
-- § 199 al. 1
- Art. 148
- Art. 117
-- al. 3
-- al. 2
- Art. 18
- Art. 96
-- lit. b
sic! 11/2008, p. 820-823, « Radiatoren » ; péremption, violation d’un brevet, radiateur, abus de droit, bonne foi, arbitraire, délai ; art. 2 al. 2 CC, art. 72 LBI.
Le principe de la bonne foi dans les affaires implique que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle le fasse valoir dès qu'il a connaissance du fait qu'une atteinte lui est portée et qu'il n'attende pas jusqu'au moment où il est devenu inadmissible d'exiger de l'auteur de la violation qu'il en supporte les conséquences. Toutefois, comme seul l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé, une péremption du droit d'agir ne doit pas être admise à la légère (c. 3). L'exigence, connue en droit des marques et selon laquelle l'auteur de la violation du droit de propriété intellectuelle doit avoir acquis une situation digne de protection, n'est pas transposable sans autre à la violation des autres droits de propriété intellectuelle. En matière de brevet d'invention, il convient, pour que les conséquences soient totalement insupportables pour l'auteur de la violation, qu'il ait pris, de bonne foi, des mesures qui ne soient pas facilement réversibles, comme c'est généralement le cas des dispositions prises pour produire ou pour vendre des biens; il faut au surplus que l'atteinte ait été tolérée pendant longtemps (près de dix ans en l'espèce [c. 4.4]) (c. 3.1). Le titulaire du brevet avait de bonnes raisons de penser que les radiateurs du défendeur violaient son brevet puisqu'ils faisaient eux-mêmes l'objet d'un brevet suisse dont il aurait pu demander la traduction à son agent de brevet (c. 4.2) et que deux spécimens s'étaient trouvés en sa possession (c. 4.4). Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que le titulaire du brevet pouvait prendre des mesures pour vérifier s'il y avait violation de son brevet (c. 4.3). Il n'est pas arbitraire non plus d'admettre la bonne foi du défendeur qui pouvait penser que la forme d'exécution de ses produits ne tombait pas dans le champ d'application du brevet (c. 4.5).
ATF 139 III 424 ; sic! 2/2014, p. 81- 84, « M-Watch II » ; usage de la marque, marque verbale, marque combinée, montre, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, action en radiation d’une marque, recours en matière civile, établissement des faits, complètement de l’état de fait, force distinctive faible, impression générale, radiation d’une marque, droit à la délivrance d’une marque, péremption, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ; art. 5 lit. C ch. 2 CUP, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 11 al. 1 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 35 lit. c LPM, art. 52 LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP, art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP ; cf. N 410 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht AG, 14 juin 2011, HSU.2010.128 ; sic! 1/2012, p. 36-42, « M-Watch » ; affaire similaire devant le Tribunal de commerce argovien).
La marque doit être utilisée comme elle est enregistrée puisque ce n'est qu'ainsi qu'elle aura le caractère distinctif qui correspond à sa fonction. Une utilisation dans une forme ne différant pas fondamentalement de celle du signe enregistré suffit toutefois, au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, ce qui permet au titulaire un usage dynamique de sa marque tenant en particulier compte de l'évolution des exigences du marché et de la concurrence. Il convient cependant que l'élément central de la marque qui lui donne son caractère distinctif soit conservé. Ce qui n'est le cas que si le public considère que le signe utilisé dégage, malgré ses différences, une même impression d'ensemble que le signe enregistré, et reconnaît donc la même marque dans la forme qui est utilisée. Il faut ainsi se demander si le public voit un seul et même signe dans la marque enregistrée et celle qui est utilisée, et si les éléments modifiés, qu'il s'agisse d'ajouts ou de suppressions, ne sont dotés d'aucun caractère distinctif propre. Les exigences en matière d'identité de signe dans l'élément central de la marque sont dans ce cas plus strictes que lorsqu'il est jugé du risque de confusion entre deux signes (c. 2.2.2). Il n'y a pas de principe général selon lequel une marque combinée enregistrée serait utilisée de manière suffisante pour maintenir le droit à la marque lorsque son titulaire n'utilise que l'élément verbal doté de force distinctive. Il convient au contraire d'examiner ce qu'il en est dans chaque cas particulier en tenant compte des circonstances concrètes. Dans la marque enregistrée «  », le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «
», le cercle vide entre la lettre « M » et le mot « WATCH », qui est abandonné dans l'utilisation faite de la marque, ne constitue pas un simple élément figuratif accessoire sans influence sur l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Au contraire, la marque combinée «  » est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque «
» est influencée par la présence de ce cercle vide entre ses deux éléments verbaux qui sont en eux-mêmes à peine distinctifs, puisqu'en tant que signe de l'alphabet seul non imposé par l'usage et en tant que désignation descriptive des produits revendiqués, ils appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il en résulte que l'élément graphique supprimé dans la version utilisée du signe est déterminant pour l'impression d'ensemble de la marque, et que son abandon la modifie de manière significative. L'utilisation du signe « M-WATCH » n'est donc pas suffisante pour valider la marque «  » au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse «
» au sens de l'art. 11 al. 2 LPM (c. 2.3.1). Du moment que les éléments verbaux « M » et « WATCH » sont à peine distinctifs et appartiennent au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM, l'élément graphique du cercle vide qui les relie joue un rôle prépondérant comme élément distinctif de la marque. Il en résulte que même des modifications légères de cet élément central de la marque peuvent modifier le caractère distinctif de celle-ci. Le remplacement de ce cercle vide par un cercle plein comprenant une croix suisse «  » n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]
» n'est ainsi pas une modification mineure de la forme enregistrée de la marque. Au contraire, cette modification change la force distinctive de l'ensemble du signe, de sorte que le public ne voit plus la même marque dans le signe qui est utilisé. Ce d'autant que la croix suisse bénéficie, en relation avec les montres notamment, d'un impact particulier dans l'esprit du public en terme de garantie de qualité qui est aussi de nature à influencer le caractère distinctif. De plus, de la manière dont elle est utilisée, cette croix suisse, qui se fond graphiquement dans la marque elle-même, n'est pas perçue comme une indication indépendante de la marque ou comme un simple ornement. L'utilisation ainsi faite de la croix suisse n'est pas purement décorative, et le fait que la LPAP en exclue l'enregistrement comme marque (art. 1 al. 1 ch. 1 LPAP et art. 2 al. 1 ch. 1 LPAP) ne doit pas avoir pour effet de permettre de valider le signe différent qui a, lui, fait l'objet d'un enregistrement comme marque (c. 2.3.2). L'utilisation de la marque « M-WATCH MONDAINE » sur les bracelets de différentes montres intervient en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée, selon l'art. 11 al. 1 LPM. La relation fonctionnelle nécessaire exigée peut en effet intervenir aussi autrement que par l'apposition de la marque sur l'objet vendu, du moment que le public comprend l'utilisation comme une indication concrète de la provenance du produit. Il importe que l'utilisation faite de la marque permette aux consommateurs d'y voir un moyen de différenciation des produits ou services concernés. La marque atteint ce but lorsqu'elle peut être rapportée à certains produits ou services, ce qui est le cas en l'espèce. L'apposition sur les bracelets de montre du signe « M-WATCH MONDAINE » est rapportée par l'acquéreur des montres aux montres-bracelets elles-mêmes qui forment un tout avec leur bracelet (c. 2.4). L'action en radiation d'une marque déposée sans droit par un partenaire commercial du véritable ayant droit selon l'art. 4 LPM entre en ligne de compte aussi lorsque le rapport contractuel entre les parties n'a pas été formalisé mais résulte d'une collaboration entre elles de longue durée (c. 3.2.1-3.2.3). Le droit d'agir en constatation de la nullité d'une telle marque enregistrée sans droit ne se périme pas au sens de l'art. 2 al. 2 CC pendant la durée de la collaboration entre les parties (c. 3.1 et 3.2 en particulier c. 3.2.2). [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
Complètement de l'état de fait
-- d'une marque
- en faveur d'un utilisateur autorisé
-- faible
- générale
- verbale
- combinée
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 11
-- al. 1
- Art. 5
-- lit. C ch. 2
- Art. 1
-- al. 1 ch. 1
- Art. 2
-- al. 1 ch. 1
- Art. 12
-- al. 1
- Art. 4
- Art. 35
-- lit. c
- Art. 52
- Art. 11
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 2
-- lit. a
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 99
-- al. 1
- Art. 97
-- al. 1
TF, 23 février 2012, 4A_429/2011 et 4A_435/2011 (d)
sic! 7-8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II » ; marque défensive, motifs absolus d’exclusion, usage de la marque, usage partiel, preuve, vraisemblance, terme générique, classification de Nice, catégorie générale de produits ou services, obligation de motiver ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 2 LPM ; cf. N 433 (vol. 2007-2011 ; ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo »).
L’absence d’intention d’utiliser la marque entraîne sa nullité, même si le délai de carence de l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas arrivé à échéance (c. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’absence d’intention d’utiliser la marque. S’agissant d’un fait négatif et interne qui ne peut pas être prouvé de manière positive, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit si la partie adverse n’a pas documenté ou au moins expliqué en quoi l’enregistrement contesté participe d’une stratégie non abusive (« fairness ») en matière de marque (c. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (c. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays ou l’activité du déposant est prohibée ne peut avoir pour objectif que d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier sans que cela s’accompagne de l’intention d’en faire usage (c. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués, et non uniquement pour ceux correspondant à l’activité principale du déposant (c. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (c. 5.4). Lorsqu’un signe est enregistré sous un terme générique de la classification de Nice, mais qu’il n’est utilisé que pour certains des produits ou services revendiqués sous ce terme générique, il s’agit d’un usage partiel. Un tel usage partiel ne vaut pour l’ensemble des produits ou services désignés sous un terme générique de la classification de Nice que si les destinataires pertinents considèrent ces produits comme un assortiment logique pour un fabricant de la branche concernée, ou si ces produits sont typiquement utilisés pour désigner l’ensemble des produits couverts par le terme générique concerné (c. 9.1). En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les produits ou services pour lesquels le signe « Yello » a été utilisé sont différents des autres produits ou services regroupés sous le terme générique déposé. En effet, faute d’avoir pu constater l’existence d’un usage partiel, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner si un tel usage s’étendait également aux autres produits ou services couverts par les termes génériques sous lesquels le signe a été enregistré. Elle n’a donc pas enfreint l’obligation de motiver découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (c. 9.3). Les deux recours sont rejetés (c. 10). [JD]
- Art. 8
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 12
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 11
-- al. 2
- Art. 2
-- lit. d
sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.
La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]
Action, voir ég. cumul d’actions
- en fourniture de renseignements
-- faible
- partiel
-- allemand
-- italien
-- relatifs
-- États-Unis
-- Tessin
-- Italie
-- admis
- libre
- sérieux
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 14
-- al. 1
- Art. 12
-- al. 1
- Art. 55
-- al. 1
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
-- al. 1
-- al. 3
- Art. 2
-- lit. a
TF, 28 décembre 2020, 4A_267/2020 (d)
Concurrence déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce, imposition par l’usage, dilution de la force distinctive, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, action défensive, péremption, abus de droit, surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 LCD.
La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]
Action, voir ég. cumul d’actions
- déloyale
- moyen
-- originaire
-- faible
- rejeté
-- indirect
- verbal
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. d
- Art. 9
- Art. 105
-- al. 2
Aviation, combustibles, carburant, Avia, raison sociale, risque de confusion, nom de domaine, swissaviaconsult.ch, péremption, principe de la spécialité, signe fantaisiste, force distinctive, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 951 CO.
Les actions défensives en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflits entre raisons de commerce. Selon l’art. 2 al. 2 CC en effet, un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. L’abus de droit réside dans le fait que l’ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l’inaction prolongée suscite l’apparence d’une tolérance, que contredit l’action en justice intentée des années plus tard. La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 3.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l’art. 2 al. 2 CC qui suppose une certaine élasticité. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant en règle générale entre 4 et 8 ans (c. 3.2). S’agissant de la position digne de protection, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages sérieux qui résulteraient pour l’auteur de la violation de l’abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard. Le préjudice économique que subirait l’auteur de la violation s’il devait cesser l’utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux. L’existence d’un chiffre d’affaires important n’est toutefois en soi pas suffisant, mais l’auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d’affaires et l’utilisation du signe litigieux. Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif : ce sera le cas lorsque l’utilisation du signe litigieux a, pour l’auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (c. 3.3). Depuis sa constitution, la défenderesse a développé ses activités dans le domaine de l’aviation et elle a noué des collaborations fructueuses avec des partenaires, soit environ 20 magasins de réparation et des fournisseurs de pièces détachées pour les avions. C’est grâce aux deux associés de la société défenderesse qui ont su profiter de leurs relations personnelles que celle-ci a acquis une position sur le marché. Il n’est pas établi qu’un changement de raison sociale, et en particulier l’abandon de l’élément « Avia » entraînerait de sérieux inconvénients pour la défenderesse puisque dans le domaine hautement spécialisé de l’aéronautique, les contrats se concluent en fonction des compétences personnelles des gérants ou des employés et que le nom de la société est secondaire (c. 3.4). Ainsi, si la passivité des demanderesses pendant 5 ans et demi (depuis l’inscription au registre du commerce) pourrait remplir la première condition de la péremption, la seconde condition (position digne de protection) n’est elle pas remplie (c. 3.5). En vertu de l’art. 951 CO, la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (c. 4.2). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d’une entreprise (l’auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l’ayant droit) – confusion dite directe – ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées mais qu’elles donnent l’impression erronée qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées – confusion dite indirecte –. Le principe de la spécialité qui prévaut en droit des marques ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Le champ de protection de la raison de commerce peut ainsi également couvrir les signes utilisés par d’autres entreprises qui offrent d’autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence. Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 4.2.1). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public concerné, celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises sont actives. Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale. Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d’un risque de confusion. Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mette particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante (vu les grandes possibilités de choix qui sont à disposition), à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d’un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s’être imposé par l’usage du signe dans le commerce (c. 4.2.2). L’examen d’un éventuel besoin absolu de libre disposition n’a de sens qu’en présence d’une désignation générique susceptible d’acquérir une force distinctive suite à un usage intensif (imposition dans le commerce). Or, le signe litigieux « Avia » revêt un caractère fantaisiste (donc une force distinctive) ce qui exclut toute discussion quant à un éventuel besoin absolu de libre disposition (c. 4.4.4). Le risque de confusion est une question de droit et il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves visant à établir d’éventuelles confusions effectives (réelles) (c. 4.4.6). Le signe « Avia » est doté d’une force distinctive originaire et il existe un risque de confusion entre les raisons sociales des parties (c. 4.4.7). Le nom « Avia » est notoire auprès du public suisse et l’utilisation de ce terme dans les raisons sociales fondent un risque de confusion indirecte très marqué (c. 5.1.2). Si, d’un point de vue technique, le nom de domaine n’est qu’un instrument qui a pour fonction d’identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l’usager d’Internet il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l’exploite, la chose ou les prestations qui s’y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire aux tiers non autorisés l’usage de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable possible. Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d’un titulaire et le nom de domaine d’une autre personne, il faut tenir compte de l’adresse Internet qui permet d’accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C’est uniquement cette adresse qui éveille l’intérêt du public et lui donne l’espoir d’obtenir des informations conformes à l’association d’idées évoquées par le nom de domaine. Partant, il n’importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (c. 6.1). In casu, dans le nom de domaine « swissaviaconsult.ch », la signification des mots « swiss » et « consult » étant évidente, le public concerné reconnaît sans aucune difficulté le mot « avia » entre les deux signes. Les considérations faites sur le risque de confusion existant entre les raisons de commerce peuvent sans autre être reprises en rapport avec le nom de domaine (c. 6.2). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu sans contester le fond de la décision n’a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (c. 7.1). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]
- sociale
sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.
Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]
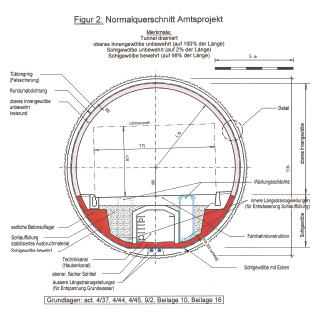
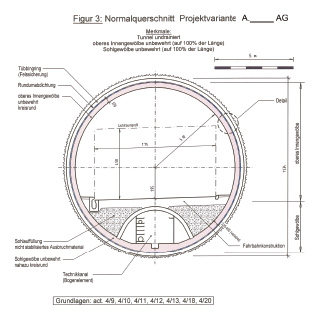
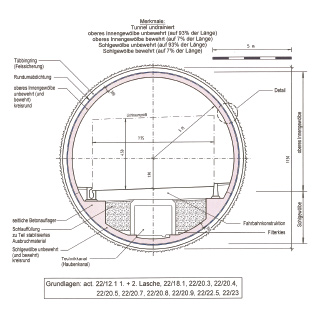
sic! 9/2012, p. 566-569, « fixateur interne » ; droit à la délivrance du brevet, invention de service, fonction publique, université, base légale, action en constatation de la nullité d’un brevet, action en cession du droit au brevet, secret de fabrication ou d’affaires, coinventeur, péremption, droit à la délivrance du brevet, usurpation, mauvaise foi ; art. 3 al. 1 CC, art. 8 CC, art. 332 CO, art. 3 LBI, art. 26 al. 1 lit. d LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 31 al. 1 LBI, art. 31 al. 2 LBI.
Il n'existait, en 1988 (moment de la réalisation de l'invention litigieuse), dans le canton de Berne, aucune règle de droit positif concernant les inventions de service réalisées au sein de la fonction publique, les bases légales correspondantes n'ayant été créées que dans le courant des années 1990. L'Université de Berne (respectivement le canton de Berne avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'Université de 1996 qui l'a dotée d'une certaine autonomie) n'a ainsi acquis aucun droit au brevet sur l'invention à la réalisation de laquelle un de ses professeurs, employé à plein temps, avait participé à l'époque, puisqu'il ne s'agissait pas d'une invention de service. Selon l'art. 29 al. 1 LBI, l'ayant droit peut agir en cession ou en constatation de la nullité d'un brevet si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n'avait pas droit au brevet au sens de l'art. 3 LBI (c. 8.3). La demande en cession doit être introduite sous peine de péremption dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé de l'invention (art. 31 al. 1 LBI), sauf si elle dirigée contre un défendeur de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI). Le défendeur est de mauvaise foi s'il savait ou s'il aurait dû savoir en faisant preuve du soin nécessaire (art. 3 al. 2 CC) qu'il n'était pas le seul ayant droit au brevet. Le déposant est de mauvaise foi s'il a pris connaissance de l'invention d'une manière contraire au droit, par exemple en surprenant des secrets de fabrication ou en incitant des tiers à violer un contrat ou en utilisant de manière indue des informations qui lui avaient été confiées. La bonne foi n'est pas non plus donnée lorsque le déposant savait ou aurait dû admettre, d'après les circonstances, que l'inventeur s'apprêtait à déposer une demande de brevet sur l'invention (c. 9.1). Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le coinventeur, administrateur de la société qui a déposé le brevet, avait pris licitement connaissance de l'invention dans le cadre de sa collaboration avec le professeur de l'Université de Berne pour la réaliser. Comme la bonne foi est présumée en vertu de l'art. 3 al. 1 CC, c'est à celui qui agit en cession du brevet après le délai de deux ans de l'art. 31 al. 1 LBI d'établir la mauvaise foi du déposant (c. 9.2). In casu, le TFB expose, après s'être livré à un examen attentif de l'état des pratiques au sein des différentes hautes écoles suisses dans les années 1980, qu'il ne pouvait pas être généralement admis que les hautes écoles entendaient être investies des droits de propriété intellectuelle sur les inventions de leurs employés au moment où l'invention considérée a été effectuée, et que tel n'était en tout cas pas la pratique de l'Université de Berne. Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n'a pas été retenue, même s'il savait que l'employé de la haute école y travaillait à plein temps au moment de sa participation à la réalisation de l'invention et qu'il avait eu recours à l'infrastructure de l'Université de Berne pour le faire. L'art. 26 al. 1 lit. b LBI ne pose pas les mêmes exigences de mauvaise foi et de délai pour agir que l'art. 31 LBI. Toutefois, l'action en constatation de la nullité du brevet prévue par l'art. 26 al. 1 lit. d LBI suppose que le demandeur soit l'unique ayant droit à la délivrance du brevet. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, deux ou plusieurs inventeurs ont participé à la réalisation de l'invention (c. 11). [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
Ayant droit à la délivrance du brevet
- légale
-- du brevet
- publique
- Art. 3
-- al. 1
- Art. 8
- Art. 332
- Art. 31
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 29
-- al. 1
- Art. 3
- Art. 26
-- al. 1 lit. d
sic! 7-8/2013, p. 445-461, « Tunnels d’Arrissoules » ; œuvre, droit d’auteur, tunnel, œuvre du génie civil, projet, partie d’œuvre, œuvre d’architecture, individualité, liberté de création, protection des idées, contenu scientifique, calcul, plan, offre, enseignement technique, responsabilité de la collectivité publique pour ses agents, acte illicite, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui, remise du gain, mauvaise foi, gestion d’affaires, faute, enrichissement illégitime ; art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD.
Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d'auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu'il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel ; ce qui n'a pas été admis en l'espèce (c. IV.3-5). Les œuvres d'architecture, au sens de l'art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l'espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d'intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s'ils satisfont aux conditions de protection du droit d'auteur (c. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d'autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l'ouvrage). La liberté de création de l'architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu'elles présentent un degré d'individualité, même réduit (c. IV.3.5.2). Les œuvres d'un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, lois de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l'arrière-plan. Dès qu'une forme d'exécution est imposée par les contingences techniques et qu'il n'existe pas d'alternative dépourvue d'impact sur l'effet image technique recherché, la réalisation ne présente pas d'individualité et appartient au domaine public. C'est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d'individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d'espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l'auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l'auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (c. IV.3.5.3). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n'est pas protégé par le droit d'auteur. Il peut l'être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d'auteur (c. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d'un tunnel pour laisser les eaux s'infiltrer dans la montagne n'est pas protégée par la LCD (c. IV.7.3). Par contre, la reprise et l'utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l'autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l'appel d'offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d'offres (c. IV.7.4). Tel n'est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (c. IV.7.5). La remise du gain selon l'art. 423 CO suppose la mauvaise foi du gérant (c. IV.14.4). La bonne foi est présumée. Toutefois, en vertu de l'art. 3 al. 2 CC, ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui qui, en déployant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, n'aurait pas pu être de bonne foi (c. IV.14.5). Le fait de renoncer à vérifier si un acte est susceptible de violer les droits de tiers, lorsqu'on a des raisons de penser que tel pourrait être le cas, est constitutif de mauvaise foi (c. IV.14.9.1). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal n'a retenu ni la mauvaise foi (en raison d'une attention insuffisante), ni la faute du défendeur (c. IV.14.10). Du moment qu'il ne peut être reproché au défendeur ni un manque d'attention, ni un défaut de surveillance, il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de ses obligations de vérification et de surveillance au sens du droit de la concurrence, ce qui ne laisse pas place à une action en restitution de l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO (c. IV.15). [NT]
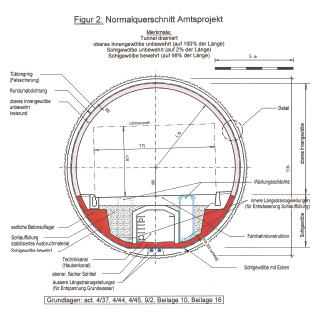
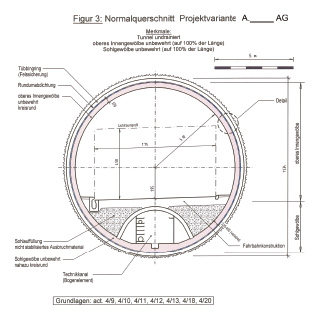
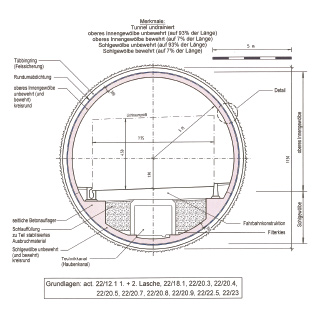
- Art. 4
- Art. 3
- Art. 55
- Art. 423
- Art. 62
- Art. 41
- Art. 11
- Art. 9
- Art. 5
-- lit. b
-- lit. a
- Art. 2
sic! 10/2013, p. 600-605, « Roter Vari » ; droits d’auteur, contrat de durée, clause d’exclusivité, résiliation, juste motif de résiliation d’un contrat, pouvoir d’appréciation, pesée d’intérêts, transfert de droits d’auteur, droits moraux, interprétation du contrat, vari rouge ; art. 4 CC, art. 1 CO, art. 18 CO, art. 11 al. 2 LDA.
Un contrat de durée peut être résilié de manière anticipée pour de justes motifs qui rendent l'exécution du contrat intolérable pour une partie. De tels justes motifs doivent être admis en cas de violations particulièrement graves du contrat, mais aussi en cas de violations moins importantes qui se répètent malgré des avertissements ou des mises en demeure, de sorte que la partie lésée puisse admettre que l'autre partie en commettra d'autres. L'existence de tels justes motifs relèvent du pouvoir d'appréciation du juge au sens de l'art. 4 CC, si bien que le TF revoit la décision librement, mais avec une certaine retenue (c 4.2). Dans un contrat où l'auteur cède ses droits à son partenaire et renonce à faire valoir ses droits moraux, on peut admettre que le but d'une clause d'exclusivité, par laquelle cet auteur se réserve le droit de procéder lui-même à des modifications de l'œuvre, est purement économique et vise à se procurer des mandats supplémentaires. Par conséquent, la violation de cette clause n'est pas un juste motif permettant la résiliation du contrat si l'auteur fait valoir que la poursuite des relations contractuelles est intolérable pour lui en raison d'une atteinte à sa réputation professionnelle (c. 5.2). Lorsqu'il recherche l'existence d'un juste motif, le juge peut mettre en balance les différents intérêts en présence. Il est permis d'exiger d'une partie qu'elle agisse en exécution du contrat plutôt qu'elle ne résilie ce dernier, si les inconvénients que causerait la résiliation sont plus importants que ceux découlant de la poursuite des rapports contractuels (c. 5.4). Dans la pesée des intérêts, le juge doit également prendre en compte les conséquences que la résiliation aurait pour un tiers, si les parties au contrat savaient que celui-ci était conclu dans l'intérêt de ce tiers (c. 5.5). Puisque l'auteur a cédé ses droits à son cocontractant, il ne peut pas fonder l'existence de justes motifs sur des violations de ses droits d'auteur (c. 5.6). De plus, on peut exiger de lui qu'il exerce la résiliation en dernier recours, et qu'il soumette auparavant au juge les litiges portant sur l'interprétation d'une clause contractuelle d'importance secondaire (c. 5.7). Un comportement dérogeant au texte du contrat n'est pas forcément déterminant pour l'interprétation de celui-ci, puisqu'il peut s'agir d'une tolérance à bien plaire (c. 6.2.1). Le recours est rejeté. [VS]

ATF 138 III 304 ; sic! 10/2012, p. 632-640, « Swatch / Icewatch » ; JdT 2013 II 175 ; contrat portant sur la marque, procédure d’opposition, Swatch, Icewatch, Ice-Watch, accord de coexistence, contrat de coexistence en matière de marque, opposition, retrait d’une opposition à l’enregistrement, juste motif de résiliation d’un contrat, contrat de durée, offre de résiliation d’un contrat, actes concluants, droit formateur ; art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC.
L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch AG de retirer ses opposition, respectivement de ne pas en former à l’enregistrement de la marque « Ice-Watch », conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch AG et le déposant, puis résiliée par Swatch AG, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injonction) – que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit – que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative « Ice-Watch » par la défenderesse au recours. Swatch AG s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (c. 5.1-5.4). Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée et, en particulier, à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (c. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (c. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (c. 7.1). Des violations du contrat de peu d’importance, mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (c. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique innommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (c. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (c. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (c. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (c. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (c. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (c. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 (cf. N 418, vol. 2007-2011) concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (c. 10-11). [NT]
- Art. 4
- Art. 8
- Art. 22
-- ch. 4
- Art. 115
- Art. 107
- Art. 18
- Art. 343
-- al. 1 lit. a
- Art. 337
-- al. 1
- Art. 236
-- al. 2
aCL (RS 0.275.12, texte abrogé)
- Art. 16
-- ch. 4
« Blocage de sites internet illicites » ; action en cessation, blocage de sites internet, fournisseur d’accès, responsabilité du fournisseur d’accès, solidarité, acte illicite, acte de participation, causalité adéquate, intérêt digne de protection, droit d’auteur, précision des conclusions, usage privé, piraterie ; art. 8 WCT, art. 42 al. 2 LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 4 CC, art. 28 CC, art. 50 CO, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 24a LDA, art. 62 al. 1 LDA, art. 62 al. 3 LDA, art. 110 LDIP.
La recourante a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision. Son recours en matière civile est donc recevable, sous réserve qu’il soit suffisamment motivé (c. 1.1). Le droit d’auteur ne connait pas de disposition comme l’art. 66 lit. d LBI ou l’art. 9 al. 1 LDes qui traiterait des actes de participation. L’art. 50 CO ne règle pas seulement la responsabilité solidaire pour la réparation d’un dommage, mais il constitue la base légale de la responsabilité civile des participants. Cette disposition peut être invoquée non seulement en cas d’action réparatoire, mais aussi en cas d’action en cessation. Les normes particulières du droit de la personnalité – art. 28 al. 1 CC – ou des droits réels ne sont pas applicables en droit d’auteur. Comme l’action en dommages-intérêts, l’action en cessation suppose une violation du droit d’auteur et un rapport de causalité adéquate entre la contribution du participant attaqué et cette violation (c. 2.2.1). Les clients de l’intimée, auxquels celle-ci confère l’accès à Internet, n’accomplissent aucune violation du droit d’auteur en consommant des films : l’exception d’usage privé est applicable, même si ces films ont été mis à disposition illicitement. Il ne peut donc pas y avoir de responsabilité de l’intimée pour un acte de participation (c.2.2.2). La protection de la LDA s’étend aussi aux actes commis à l’étranger mais produisant leurs effets en Suisse (c. 2.2.3). La question est de savoir si l’intimée, qui fournit l’accès à Internet, répond selon l’art. 50 al. 1 CO pour une participation à la mise à disposition illicite des films. Le rapport de causalité adéquate doit être apprécié dans chaque cas particulier selon les règles du droit et de l’équité au sens de l’art. 4 CC. Il implique donc un jugement de valeur. Pour qu’une participation soit adéquate, il faut un rapport suffisamment étroit avec l’acte illicite (c. 2.3.1). La prestation de l’intimée se limite à fournir un accès automatisé à Internet. Elle n’offre pas à ses clients des contenus déterminés. Les copies temporaires qu’implique son activité sont licites d’après l’art. 24a LDA. La déclaration commune concernant l’art. 8 WCT exclut que la fourniture d'installations techniques constitue un acte principal de communication au public ; elle n’empêche toutefois pas une responsabilité pour participation secondaire. En l’espèce, les auteurs principaux des violations ne sont pas clients de l’intimée et n’ont aucune relation avec elle. L’acte de mise à disposition est accompli déjà lorsque les films sont placés sur Internet de sorte à pouvoir être appelés aussi depuis la Suisse. L’intimée ne contribue pas concrètement à cet acte. Admettre le contraire sur la base de l’art. 50 al. 1 CO conduirait à retenir une responsabilité de tous les fournisseurs d’accès en Suisse, pour toutes les violations du droit d’auteur commises sur le réseau mondial. Une telle responsabilité « systémique », impliquant des devoirs de contrôle et d’abstention sous la forme de mesures techniques de blocage d’accès, serait incompatible avec les principes de la responsabilité pour acte de participation. Il n’y a donc aucun rapport de causalité adéquat avec les violations, justifiant une action en cessation. Une implication des fournisseurs d’accès dans la lutte contre le piratage nécessiterait une intervention du législateur (c. 2.3.2). [VS]
- Art. 4
- Art. 28
- Art. 50
- Art. 24a
- Art. 19
-- al. 1 lit. a
- Art. 62
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 110
- Art. 76
-- al. 1 lit. b
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 8
Action en constatation de la nullité d’une marque, action en radiation d’une marque, usage de la marque, juste motif de non-usage de la marque, fardeau de la preuve, vraisemblance, preuve du défaut d’usage, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.
Après l’écoulement du délai légal de grâce de 5 ans, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle a effectivement été utilisée en relation avec les produits et services revendiqués (voir art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LPM). Cette exigence d’usage correspond à la fonction commerciale de la marque et doit également empêcher que des marques soient enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non-usage, l’action en radiation est donnée en l’absence de juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Si le défaut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire de la marque doit apporter la preuve de l’usage, respectivement de l’existence de justes motifs l’ayant empêché (art. 12 al. 3 LPM). En l’espèce, le Tribunal de commerce a considéré que le défaut d’usage constaté était dû à de justes motifs, à savoir une procédure parallèle opposant les parties, dans laquelle la recourante contestait la validité d’une des marques également en cause dans la présente procédure et cherchait à en faire interdire l’utilisation à l’intimée pour les montres, les lunettes (y compris de soleil), ainsi que d’autres marchandises encore (c. 2). Le respect du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas que le Tribunal se détermine sur chacun des griefs soulevés par les parties et les réfute un à un expressément. La Cour peut au contraire limiter son examen à ceux des points importants pour la décision (c. 2.2). Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas fondamentalement en question le fait que l’introduction d’une action en constatation de la nullité et en interdiction puisse constituer un juste motif de non-utilisation de la marque concernée. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas que sa demande intentée dans la procédure parallèle serait dépourvue de chances de succès, il n’est pas démontré ni évident qu’il ne s’agirait pas d’une menace que l’intimée devrait raisonnablement prendre en compte. Dans ces circonstances, le fait de considérer, à l’instar de l’autorité précédente, qu’il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle utilise la marque pendant la durée de la procédure parallèle pendante, ne viole pas le droit fédéral. Le point de savoir si un juste motif existe au sens de l’art. 4 CC relève d’une question d’appréciation dans l’examen de laquelle le TF ne s’immisce qu’avec retenue. Le reproche de la recourante que l’autorité précédente aurait violé l’art. 12 al. 1 LPM est mal fondé (c. 2.3). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]
- Art. 4
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 12
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 11
-- al. 1
TF, 6 juillet 2010, 4A_57/2010 (d) (mes. prov.)
medialex 4/2010, p. 230 (rés.) ; mesures provisionnelles, recours, recours constitutionnel subsidiaire, irrecevabilité, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 75 al. 1 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 113 LTF, art. 6 CC, art. 65 LDA, art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG.
Le recours en matière civile contre la décision (incidente) de refus de mesures provisionnelles (art. 65 LDA) du Kantonsgericht SG étant admissible, le TF n'entre pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) (c. 1). Les griefs soulevés contre cette décision du Kantonsgericht SG pouvant être examinés par le Kassationsgericht SG dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (contre la décision du Kantonsgericht SG) (art. 237 ss ZPO/SG, art. 239 ZPO/SG; c. 2), le TF n'entre pas en matière sur le recours en matière civile contre la décision du Kantonsgericht SG (art. 75 al. 1 LTF) (c. 4.1), les griefs soulevés (violations de l'art. 9 Cst. [en lien avec l'art. 6 CC] et de l'art. 29 Cst.) n'étant au surplus pas suffisamment motivés (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF; c. 3) (c. 4.2).
- d'auteur
- Art. 6
- Art. 29
- Art. 9
Droit cantonal
- ZPO/SG
-- Art. 239
-- Art. 237~ss
- Art. 65
- Art. 98
- Art. 106
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 1
- Art. 113
medialex 1/2011, p. 57 (rés.), « Bob-Marley-Fotografie » ; droits d’auteur, contrat, contrat de travail, transfert de droits d’auteur, œuvre photographique, Bob Marley, interprétation du contrat, principe de la confiance, délai de recours, conclusion, motivation de la décision, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 42 al. 1 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 6 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 8 CC, art. 18 al. 1 CO, § 281 ss ZPO/ZH ; cf. N 23 (arrêt de l’Obergericht ZH dans cette affaire).
Selon l'art. 100 al. 6 LTF, si la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale (en l'espèce, le Kassationsgericht ZH) pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision de cette autorité (c. 1). La recevabilité du recours en matière civile (moyen réformatoire ; art. 107 al. 2 LTF) est déjà douteuse du fait que le recourant, sans prendre de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) matérielles et justifier pourquoi le TF ne pourrait pas statuer lui-même, se limite à demander l'annulation de l'arrêt de l'Obergericht ZH et le renvoi à cette autorité (c. 2). Le recours contre une décision basée sur une motivation principale et une motivation subsidiaire (indépendantes l'une de l'autre) est irrecevable s'il ne s'en prend pas de manière suffisante à la motivation subsidiaire (c. 3). Au regard des griefs de la constatation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu et de l'application arbitraire de dispositions cantonales de procédure, l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH, n'est pas une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), car ces griefs pouvaient être examinés par le Kassationsgericht ZH dans le cadre d'un Nichtigkeitsbeschwerde (§ 281 ss ZPO/ZH) (c. 4.1). Dès lors, en lien avec l'état de fait, seul le grief de la violation de l'art. 8 CC peut être invoqué devant le TF contre l'arrêt attaqué, rendu par l'Obergericht ZH (c. 4.2). Ce n'est que lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut pas être établie qu'il convient d'interpréter le contrat à l'aide du principe de la confiance; en l'espèce, une telle interprétation du contrat est superflue (c. 5). Le recours à l'art. 8 CC ne permet pas au recourant de contester qu'il a cédé à Y. AG l'ensemble de ses droits d'exploitation sur la photographie litigieuse en la remettant, sans réserve, aux archives de Y. AG (c. 6).
- Art. 8
- Art. 18
-- al. 1
Droit cantonal
- ZPO/ZH
-- § 281~ss
- Art. 107
-- al. 2
- Art. 100
-- al. 6
- Art. 75
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 1
sic! 9/2009, p. 621-625, « Afri-Cola » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Afrique, cola, signe combiné, indication de provenance, égalité de traitement, établissement des faits, preuve, fardeau de la preuve, obligation de collaborer, droit d’être entendu ; art. 12 et 13 PA, art. 8 CC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 221 (arrêt du TF dans cette affaire).
Une indication géographique est exclue de la protection comme marque si elle suscite, parmi les cercles des destinataires concernés, une attente quant à la provenance géographique des produits ou services qu'elle désigne. Tel n'est pas le cas si le lieu auquel le signe fait référence n'est pas connu en Suisse, a un caractère fantaisiste de par son contenu symbolique, n'est pas approprié à la production, à la fabrication ou à la commercialisation, désigne un type de produits, s'est imposé dans le commerce comme le nom d'une entreprise ou a dégénéré en une désignation générique. La présence dans une marque complexe d'autres éléments que le nom géographique lui-même peut déboucher sur une impression d'ensemble qui exclut toute attente quant à la provenance du produit ou du service. Il convient de se référer aux circonstances particulières de chaque cas d'espèce pour déterminer si une telle attente existe bien et si le signe est susceptible de tromper le public. La riche jurisprudence en la matière n'est ainsi pas généralement transposable et les cas déjà jugés n'ont qu'une importance limitée. La situation de fait doit être clarifiée dans chaque cas particulier et les faits pertinents établis par des moyens de preuve proportionnés et raisonnables, avec le concours du déposant. L'établissement d'office des faits est un devoir de l'autorité administrative (art. 12 PA) indépendant du fardeau de la preuve qui incombe au déposant. L'obligation de collaborer à l'établissement des faits incombe aussi aux parties à la procédure (art. 13 PA) et n'influence pas l'étendue de leur fardeau de la preuve. En cas de doute, le déposant supporte les conséquences d'un fait demeuré non établi ou rendu non suffisamment vraisemblable dont il voudrait déduire des droits. L'autorité doit rechercher tous les moyens de preuve se rapportant à la signification et à une éventuelle attente d'une provenance géographique et considérer ceux présentés par les parties dont elle doit respecter le droit d'être entendues.
- Art. 8
- Art. 47
- Art. 2
-- lit. c
- Art. 13
- Art. 12
sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.
Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).
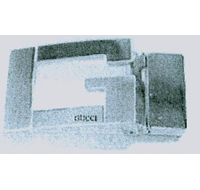
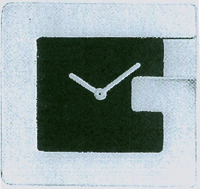
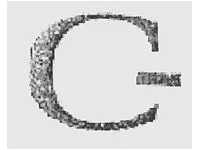
- Art. 8
- Art. 12
- Art. 3
-- al. 2 lit. b
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
- Art. 99
-- al. 1
sic! 9/2009, p. 607-609, « Produits cosmétiques » ; action, action en interdiction, action en prévention de trouble, action en cessation, intérêt pour agir, risque de récidive, présomption, fardeau de la preuve, preuve ; art. 8 CC, art. 55 al. 1 lit. a et b LPM, art. 9 al. 1 lit. a LCD.
Un intérêt suffisant existe pour justifier une action en interdiction de trouble lorsque le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. Le danger de répétition est présumé si le défendeur a déjà commis de telles violations et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits. Cette présomption est réfragable et ne vaut que pour le risque d'une répétition future des actes incriminés. Elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies. Celui qui entend faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque qui perdure n'agit pas en prévention de trouble au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, mais en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 55 al. 1 lit. b LPM. C'est dès lors à lui d'établir, en vertu de l'art. 8 CC, que les produits censés contrefaire sa marque ont été fabriqués par les défendeurs et que les défendeurs sont bien les auteurs de l'atteinte.
- Art. 8
- Art. 9
-- al. 1 lit. a
- Art. 55
-- al. 1 lit. b
-- al. 1 lit. a
sic! 9/2008, p. 643-647, « Alendronsäure II » ; certificat complémentaire de protection, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection ; art. 56 CBE 2000, art. 8 CC, art. 24 LBI, art. 1 al. 2 LBI, art. 26 LBI, art. 27 LBI, art. 74 LBI, art. 140d al. 1 LBI, art. 140k al. 1 lit. d et e LBI.
Constatation de la validité d'un certificat complémentaire de protection (CCP) et relation entre le procès en nullité de ce CCP et la question de savoir si le brevet d'origine qui doit être limité vise encore le produit pour lequel le CCP a été octroyé.
Action, voir ég. cumul d’actions
-- de la nullité d'un certificat complémentaire de protection
- Art. 56
- Art. 8
- Art. 140k
-- al. 1 lit. e
-- al. 1 lit. d
- Art. 140d
-- al. 1
- Art. 74
- Art. 27
- Art. 24
- Art. 26
- Art. 1
-- al. 2
sic! 5/2007, p. 382-383, « Aktivlegitimation der Unterlizenznehmerin » ; JdT 2007 I 162 ; action, qualité pour agir, qualité pour agir du preneur de licence, contrat ; art. 55 al. 1 OJ, art. 63 al. 2 OJ, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 34 LBI, art. 72 LBI.
Qualité pour agir du sous-preneur de licence admise lorsqu'elle découle d'une clause contractuelle et que les conditions contractuelles mises à la délégation de la qualité pour agir sont remplies et établies.
- Art. 8
- Art. 18
- Art. 72
- Art. 34
- Art. 63
-- al. 2
- Art. 55
-- al. 1
KG ZG, 29 mai 2008, A3 2008 39 (d)
sic! 1/2009, p. 39-42, « Resonanzetikette III » ; action, action en remise du gain, violation d’un brevet, preuve, estimation, péremption, prescription, délai, registre des brevets, faute, dol, mauvaise foi, diligence, intérêts ; art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 60 al. 2 CO, art. 73 CO, art. 423 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP.
Il n'est pas possible d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie afin de procéder à une estimation lorsque, faute d'une comptabilité en règle, l'entreprise, gérante (art. 423 CO), n'est pas en mesure de prouver les coûts de revient qu'elle allègue (c. 3.3). L'action en délivrance du gain n'est pas périmée (art. 2 al. 2 CC) en raison du fait qu'elle n'est déposée, vu la complexité de la situation, que deux ans après la connaissance de la violation du brevet, ce d'autant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le lésé entendait ainsi profiter économiquement de la violation du brevet (c. 4.4). L'action qui découle de la violation intentionnelle d'un brevet est soumise au délai de prescription pénal de 5 ans (art. 60 al. 2 CO, art. 81 LBI, art. 70 al. 3 aCP). La seule présomption légale de la connaissance du contenu du registre des brevets européens ne suffit pas à établir l'existence d'une violation intentionnelle (dol ou dol éventuel) (c. 5.3). Afin de prétendre à la restitution du gain, le lésé doit prouver la mauvaise foi ou la faute du gérant (art. 423 CO, art. 8 CC). Viole son devoir de diligence et est de mauvaise foi la personne qui, avant de fabriquer et de commercialiser un produit (dans un domaine très spécialisé), néglige de s'assurer qu'une telle activité ne viole pas les brevets de tiers (c. 7.3). En cas de restitution du gain, un intérêt compensatoire de 5 % (art. 73 CO) est dû à partir du moment où le fait dommageable a eu des effets financiers (c. 8.1).
- Art. 8
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 73
- Art. 60
-- al. 2
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 423
- Art. 70
-- al. 3
- Art. 81
AG BS, 20 juin 2013, ZB.2012.54 (d)
« Basel Tattoo » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun Ka, règle du ballet, spectacle, chorégraphie, fanfare, musique (fonction subordonnée ou d’accompagnement), interprétation du contrat, Basel Tattoo, interprétation des tarifs, tarif contraignant pour les tribunaux, cartel, approbation des tarifs ; art. 8 CC, art. 3 al. 2 LCart, art. 2 al. 2 lit. h LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA ; cf. N 607 (Zivilgericht BS, 27 juin 2012, P.2010.238).
Selon la règle dite du ballet, le pourcentage de redevance pour les droits d'auteur sur la musique est réduit de moitié lorsque celle-ci est exécutée en accompagnement d'une autre œuvre ou pour soutenir cette dernière. D'après le tarif commun Ka de SUISA et Swissperform, cette réduction implique que l'autre œuvre soit protégée par le droit d'auteur, et que la musique ait une fonction subordonnée ou d'accompagnement (c. 4.1). Vu l'art. 59 al. 3 LDA, il n'est pas admissible que les tribunaux remettent en cause le caractère équitable de cette réglementation tarifaire. Les prétentions fondées sur la propriété intellectuelle ne sont soumises que de manière limitée à la loi sur les cartels (art. 3 al. 2 LCart.). De même, le besoin de protéger la partie la plus faible, reconnu en droit contractuel, ne vaut pas pour les tarifs de droits d'auteur soumis à une procédure d'approbation officielle compliquée, si bien que les règles d'interprétation des conditions générales contractuelles ne sont pas applicables (c. 4.2). D'après l'art. 8 CC, c'est au débiteur de la redevance de prouver qu'il a droit à la réduction découlant de la règle du ballet (c. 4.3). Pour savoir si cette règle s'applique, ce n'est pas le rôle de la musique par rapport à l'ensemble du spectacle qui est déterminant, mais plutôt sa fonction subordonnée ou d'accompagnement (par rapport à d'autres œuvres protégées) dans chacun des numéros du spectacle (c. 4.4). La prestation du metteur en scène relève normalement des droits voisins, et non du droit d'auteur, si bien qu'elle n'est pas pertinente pour déterminer si la musique a une fonction subordonnée ou d'accompagnement. Au contraire, les mouvements des fanfares, dans un spectacle « Tattoo », peuvent être une chorégraphie au sens de l'art. 2 al. 2 lit. h LDA, même si les fanfares ne dansent pas ; ils peuvent donc entraîner l'application de la règle du ballet. En revanche, en l'espèce, la protection du droit d'auteur ne peut pas être retenue pour l'éclairage et les costumes. Quant aux commentaires du modérateur, même s'ils étaient protégés par le droit d'auteur, ils n'auraient pas une fonction de rang supérieur par rapport à la musique (c. 4.6). En application des critères susmentionnés, la règle du ballet n'est applicable qu'à un nombre limité de numéros figurant dans les spectacles à juger en l'espèce (c. 4.7.3). [VS]
- d'auteur
- fonction subordonnée ou d'accompagnement
- contraignant pour les tribunaux
Tarifs des sociétés de gestion
- communs
-- Ka
- Art. 8
- Art. 3
-- al. 2
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 2
-- al. 2 lit. h
sic! 12/2012, p. 811-813, « Lego IV (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, forme géométrique simple, Lego, forme techniquement nécessaire, coûts de fabrication, signe alternatif, expertise, fardeau de la preuve, droit d’être entendu, compatibilité, secret de fabrication ou d’affaires ; art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM.
Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d'un examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme tridimensionnelle, au sens de l'art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d'une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu'il soit vérifié s'il existait des formes alternatives (tant compatibles qu'incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s'éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d'outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l'étaient pas (29 à 54 %). L'expertise avait permis de poser qu'au vu de la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu'à 50 % pour celles qui ne l'étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d'une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s'accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l'art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (c. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu'elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu'elles s'accompagnent de coûts de production plus élevés (c. 3.1). Comme le monopole lié à l'obtention d'une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s'accompagnent d'aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l'égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (c. 3.2). Lorsqu'elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d'affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l'expert chargé de la réalisation d'une expertise dans le cadre de l'administration des preuves, ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu si les indications qu'elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l'administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (c. 4.3.2). [NT]
ATF 138 III 304 ; sic! 10/2012, p. 632-640, « Swatch / Icewatch » ; JdT 2013 II 175 ; contrat portant sur la marque, procédure d’opposition, Swatch, Icewatch, Ice-Watch, accord de coexistence, contrat de coexistence en matière de marque, opposition, retrait d’une opposition à l’enregistrement, juste motif de résiliation d’un contrat, contrat de durée, offre de résiliation d’un contrat, actes concluants, droit formateur ; art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC.
L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch AG de retirer ses opposition, respectivement de ne pas en former à l’enregistrement de la marque « Ice-Watch », conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch AG et le déposant, puis résiliée par Swatch AG, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injonction) – que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit – que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative « Ice-Watch » par la défenderesse au recours. Swatch AG s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (c. 5.1-5.4). Le but poursuivi par les accords de coexistence, qui visent à mettre fin de manière définitive et durable à un conflit avéré ou en tout cas possible, implique qu’ils ne devraient pas être résiliables. Toutefois, ces contrats sont soumis aux mêmes règles de résiliation que les autres contrats de durée et, en particulier, à celles concernant leur résiliation pour justes motifs (c. 6). En présence d’un juste motif qui ne permet plus d’exiger d’une des parties la continuation du contrat, cette dernière doit pouvoir y mettre fin avec effet immédiat, même s’il s’agit d’un contrat de durée. La résiliation pour justes motifs peut intervenir sans même qu’un délai soit fixé à la partie en faute pour y remédier, respectivement pour exécuter correctement le contrat au sens de l’art. 107 CO (c. 7). L’admission ou non de l’existence d’un juste motif relève du pouvoir d’appréciation du tribunal au sens de l’art. 4 CC (c. 7.1). Des violations du contrat de peu d’importance, mais intervenant de manière répétée, doivent être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles constituent ou non un juste motif de mettre fin au contrat (c. 7.2-7.4.1). Un contrat de coexistence en matière de marque est un contrat synallagmatique innommé qui constitue un compromis et qui profite en général aux deux parties, et notamment aussi au titulaire de la première marque enregistrée auquel il permet de préserver son signe sans avoir à le mettre en péril en intentant une action à l’issue peut-être incertaine (c. 7.4.2). Il a aussi pour but de limiter les risques de confusion entre deux signes semblables ou identiques (c. 7.4.4), et n’est pas assimilable à un contrat de licence de marque puisque dans le cadre d’un contrat de coexistence, chacune des parties conserve son propre droit à la marque et exploite sa propre marque (c. 11). Ce n’est pas tant le nombre de violations du contrat que leur intensité qui est déterminant pour établir s’il y a ou non de justes motifs de résiliation (c. 7.4.5). La résiliation inefficace d’un contrat faute de juste motif ne peut déboucher sur la fin du contrat que si elle est comprise comme une offre de résiliation du contrat (au sens de l’art. 115 CO) suivie d’une acceptation. Un contrat mettant fin à une convention préexistante au sens de l’art. 115 CO peut être conclu par actes concluants. Cela suppose que le comportement de celui qui doit accepter l’offre de résiliation exprime la volonté de renoncer à être lié par la convention. Il doit ainsi être reconnaissable que cette partie a la volonté de renoncer aux prétentions qu’elle tire du contrat. Cela ne doit pas être admis à la légère et il est nécessaire qu’on soit en présence d’une manifestation claire de volonté de renoncer définitivement à ces droits (c. 8.1). Un silence d’à peine un mois entre le moment de la réception d’un courrier de résiliation inattendu et l’envoi d’un courrier de réponse contestant formellement cette résiliation, ne saurait valoir acceptation. Les règles que la jurisprudence a posées en application de l’art. 107 CO, selon lesquelles le débiteur doit immédiatement réagir lorsque le délai qui lui a été fixé pour s’exécuter est trop court, ne sont pas applicables aux délais admissibles pour réagir à une résiliation de contrat (c. 8.2-8.3.1). En droit suisse, le principe est que les contrats doivent être respectés. L’exercice d’un droit formateur que constitue la résiliation du contrat ne peut, en cas de résiliation anticipée du contrat et à l’exclusion des cas réglés par la loi, produire d’effets que si elle est intervenue de manière justifiée. Autrement, elle est inefficace et les obligations contractuelles de chacune des parties demeurent. En particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la relation contractuelle entre les parties ne suppose pas la réalisation par chacune d’elles d’une quantité de prestations positives (dont l’exécution matérielle deviendrait difficile en cas de rupture du rapport de confiance) mais uniquement un devoir de tolérance et d’abstention réciproque. Dans un tel cas, la sécurité du droit exige plutôt qu’une résiliation injustifiée d’un contrat de coexistence ne permette pas à la partie qui en est l’auteur d’échapper à ses obligations de durée. Il n’y a ainsi pas de raison d’admettre, en dérogation au principe posé par l’ATF 133 III 360 (cf. N 418, vol. 2007-2011) concernant la résiliation d’un contrat de licence, l’efficacité de la résiliation contestée également en l’absence de justes motifs (c. 10-11). [NT]
- Art. 4
- Art. 8
- Art. 22
-- ch. 4
- Art. 115
- Art. 107
- Art. 18
- Art. 343
-- al. 1 lit. a
- Art. 337
-- al. 1
- Art. 236
-- al. 2
aCL (RS 0.275.12, texte abrogé)
- Art. 16
-- ch. 4
TF, 23 février 2012, 4A_429/2011 et 4A_435/2011 (d)
sic! 7-8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II » ; marque défensive, motifs absolus d’exclusion, usage de la marque, usage partiel, preuve, vraisemblance, terme générique, classification de Nice, catégorie générale de produits ou services, obligation de motiver ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 2 lit. d LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 2 LPM ; cf. N 433 (vol. 2007-2011 ; ATF 136 III 102 ; sic! 6/2010, p. 436-438, « Yello / Yallo »).
L’absence d’intention d’utiliser la marque entraîne sa nullité, même si le délai de carence de l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas arrivé à échéance (c. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’absence d’intention d’utiliser la marque. S’agissant d’un fait négatif et interne qui ne peut pas être prouvé de manière positive, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit si la partie adverse n’a pas documenté ou au moins expliqué en quoi l’enregistrement contesté participe d’une stratégie non abusive (« fairness ») en matière de marque (c. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (c. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays ou l’activité du déposant est prohibée ne peut avoir pour objectif que d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier sans que cela s’accompagne de l’intention d’en faire usage (c. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués, et non uniquement pour ceux correspondant à l’activité principale du déposant (c. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (c. 5.4). Lorsqu’un signe est enregistré sous un terme générique de la classification de Nice, mais qu’il n’est utilisé que pour certains des produits ou services revendiqués sous ce terme générique, il s’agit d’un usage partiel. Un tel usage partiel ne vaut pour l’ensemble des produits ou services désignés sous un terme générique de la classification de Nice que si les destinataires pertinents considèrent ces produits comme un assortiment logique pour un fabricant de la branche concernée, ou si ces produits sont typiquement utilisés pour désigner l’ensemble des produits couverts par le terme générique concerné (c. 9.1). En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les produits ou services pour lesquels le signe « Yello » a été utilisé sont différents des autres produits ou services regroupés sous le terme générique déposé. En effet, faute d’avoir pu constater l’existence d’un usage partiel, l’autorité inférieure n’avait pas à examiner si un tel usage s’étendait également aux autres produits ou services couverts par les termes génériques sous lesquels le signe a été enregistré. Elle n’a donc pas enfreint l’obligation de motiver découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (c. 9.3). Les deux recours sont rejetés (c. 10). [JD]
- Art. 8
- Art. 2
-- al. 2
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 12
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 11
-- al. 2
- Art. 2
-- lit. d
sic! 5/2013, p. 300- 304, « Tara Jarmon » ; marque verbale, enseigne, raison de commerce, Tara Jarmon, Tarjarmo, risque de confusion admis, action en dommages-intérêts, acte illicite, faute, dommage, preuve, dilution de la force distinctive, gain manqué, contrat de licence, contrat de franchise ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 84 al. 1 CO, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 3 LCD ; cf. N 735
(TF, 6 février 2013, 4A_460/2012 ; arrêt du TF dans cette affaire).Tant la LPM (art. 55 al. 2 LPM) que la LCD (art. 9 al. 3 LCD), ou encore les dispositions sur le droit au nom (art. 29 al. 2 CC), réservent l’art. 41 CO concernant la réparation des dommages subis du fait de leur violation (c. VII.d). L’acte illicite résulte en l’espèce du risque de confusion entre la raison de commerce de la défenderesse et la marque de la demanderesse (c. VII.b.a qui renvoie au c. V.c). En continuant d’exploiter une boutique à l’enseigne « Tara Jarmon », alors qu’aucun contrat n’était conclu avec les titulaires de la marque correspondante, et en créant une société dont la raison sociale « Tarjarmo » ressemble à cette marque, les défenderesses ont commis une faute (c. VII.b.b). L’utilisation abusive de l’enseigne « Tara Jarmon », ainsi que de la raison sociale « Tarjarmo » par les défenderesses est propre à faire naître un risque de confusion en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par les demanderesses (c. VII.b.c). Le dommage peut consister en une réduction d’actifs, un accroissement des passifs ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre l’état du patrimoine après la survenance de l’événement dommageable, et l’état dans lequel ce patrimoine aurait été sans cet événement. Concernant la preuve du dommage conformément à l’art. 8 CC, il ne saurait être exigé du lésé davantage que d’alléguer et d’établir toutes les circonstances démontrant la survenance d’un dommage et permettant de l’évaluer dans les limites de ses possibilités et de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Si le lésé ne réussit pas à établir la preuve du montant du dommage, le juge doit déterminer équitablement, en considération du cours ordinaire des choses, l’étendue, mais également l’existence du dommage. La perturbation du marché et la dilution du caractère distinctif de la marque sont des éléments que le juge prend en compte dans son appréciation, respectivement sa détermination, du dommage. En l’espèce, l’utilisation de la marque « Tara Jarmon » par les défenderesses, alors qu’elles n’y étaient pas autorisées, a empêché les demanderesses d’accorder à des tiers l’autorisation d’ouvrir et d’exploiter une boutique « Tara Jarmon » à Genève et les a empêchées de poursuivre leur utilisation de cette marque en cette ville. Le manque à gagner ainsi subi par les demanderesses doit être calculé en fonction de la marge brute moyenne annuelle réalisée par les défenderesses lorsqu’elles étaient autorisées à utiliser la marque à Genève (soit pendant les années 2000 à 2003). Les frais d’une campagne publicitaire liée à l’ouverture d’une nouvelle boutique « Tara Jarmon » autorisée par les demanderesses, plus de trois ans après que l’usage abusif par les défenderesses ait cessé, ne peuvent pas être uniquement mis en relation avec cette utilisation abusive de la marque. Seul le remboursement d’une partie de ceux-ci (10 000 francs) peut ainsi être alloué aux demanderesses en application de l’art. 42 al. 2 CO (c. VII.b.d). En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il convient ainsi de rejeter une conclusion présentée en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère. Dans le cas d’espèce, l’atteinte à la marque a eu lieu en Suisse et la perturbation du public est intervenue sur le marché genevois. Elle doit donc être réparée en francs suisses, alors que le dommage relatif au gain manqué a touché le patrimoine de la demanderesse domiciliée en France et doit être arrêté en Euros, comme le précisaient les conclusions de cette dernière (c. VII.c). [NT]
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 8
- Art. 84
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 41
- Art. 9
-- al. 3
- Art. 55
-- al. 2
sic! 9/2012, p. 566-569, « fixateur interne » ; droit à la délivrance du brevet, invention de service, fonction publique, université, base légale, action en constatation de la nullité d’un brevet, action en cession du droit au brevet, secret de fabrication ou d’affaires, coinventeur, péremption, droit à la délivrance du brevet, usurpation, mauvaise foi ; art. 3 al. 1 CC, art. 8 CC, art. 332 CO, art. 3 LBI, art. 26 al. 1 lit. d LBI, art. 29 al. 1 LBI, art. 31 al. 1 LBI, art. 31 al. 2 LBI.
Il n'existait, en 1988 (moment de la réalisation de l'invention litigieuse), dans le canton de Berne, aucune règle de droit positif concernant les inventions de service réalisées au sein de la fonction publique, les bases légales correspondantes n'ayant été créées que dans le courant des années 1990. L'Université de Berne (respectivement le canton de Berne avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'Université de 1996 qui l'a dotée d'une certaine autonomie) n'a ainsi acquis aucun droit au brevet sur l'invention à la réalisation de laquelle un de ses professeurs, employé à plein temps, avait participé à l'époque, puisqu'il ne s'agissait pas d'une invention de service. Selon l'art. 29 al. 1 LBI, l'ayant droit peut agir en cession ou en constatation de la nullité d'un brevet si la demande de brevet a été déposée par une personne qui n'avait pas droit au brevet au sens de l'art. 3 LBI (c. 8.3). La demande en cession doit être introduite sous peine de péremption dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé de l'invention (art. 31 al. 1 LBI), sauf si elle dirigée contre un défendeur de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI). Le défendeur est de mauvaise foi s'il savait ou s'il aurait dû savoir en faisant preuve du soin nécessaire (art. 3 al. 2 CC) qu'il n'était pas le seul ayant droit au brevet. Le déposant est de mauvaise foi s'il a pris connaissance de l'invention d'une manière contraire au droit, par exemple en surprenant des secrets de fabrication ou en incitant des tiers à violer un contrat ou en utilisant de manière indue des informations qui lui avaient été confiées. La bonne foi n'est pas non plus donnée lorsque le déposant savait ou aurait dû admettre, d'après les circonstances, que l'inventeur s'apprêtait à déposer une demande de brevet sur l'invention (c. 9.1). Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le coinventeur, administrateur de la société qui a déposé le brevet, avait pris licitement connaissance de l'invention dans le cadre de sa collaboration avec le professeur de l'Université de Berne pour la réaliser. Comme la bonne foi est présumée en vertu de l'art. 3 al. 1 CC, c'est à celui qui agit en cession du brevet après le délai de deux ans de l'art. 31 al. 1 LBI d'établir la mauvaise foi du déposant (c. 9.2). In casu, le TFB expose, après s'être livré à un examen attentif de l'état des pratiques au sein des différentes hautes écoles suisses dans les années 1980, qu'il ne pouvait pas être généralement admis que les hautes écoles entendaient être investies des droits de propriété intellectuelle sur les inventions de leurs employés au moment où l'invention considérée a été effectuée, et que tel n'était en tout cas pas la pratique de l'Université de Berne. Par conséquent, la mauvaise foi du déposant n'a pas été retenue, même s'il savait que l'employé de la haute école y travaillait à plein temps au moment de sa participation à la réalisation de l'invention et qu'il avait eu recours à l'infrastructure de l'Université de Berne pour le faire. L'art. 26 al. 1 lit. b LBI ne pose pas les mêmes exigences de mauvaise foi et de délai pour agir que l'art. 31 LBI. Toutefois, l'action en constatation de la nullité du brevet prévue par l'art. 26 al. 1 lit. d LBI suppose que le demandeur soit l'unique ayant droit à la délivrance du brevet. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, deux ou plusieurs inventeurs ont participé à la réalisation de l'invention (c. 11). [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
Ayant droit à la délivrance du brevet
- légale
-- du brevet
- publique
- Art. 3
-- al. 1
- Art. 8
- Art. 332
- Art. 31
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 29
-- al. 1
- Art. 3
- Art. 26
-- al. 1 lit. d
HG BE, 28 février 2014, HG 13 116 SUN CAB (d) (mes. prov.)
sic! 10/2014, p. 634-637, « Converse All Star » ; droits conférés par la marque, concurrence déloyale, risque de confusion, indication publicitaire inexacte, mesures provisionnelles, vraisemblance, fardeau de la preuve, contrefaçon, importation parallèle, canaux de distribution, épuisement, chaussures, baskets, numéros de série, étiquette, fournisseur, OTTO’S ; art. 8 CC, art. 13 LPM, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 152 CPC, art. 156 CPC.
Les demanderesses requièrent qu’il soit interdit au discounter OTTO’S de diffuser diverses baskets prétendument falsifiées de marque Converse All Star, et que leur soient communiquées des informations sur les canaux de distribution. Elles indiquent que les chaussures litigieuses comportent des numéros de série ne figurant pas dans leur base de données. La défenderesse soutient que les baskets constituent des marchandises originales ayant fait l’objet d’importations parallèles. Tant que l’existence d’une contrefaçon n’est pas établie, l’intérêt de la défenderesse à ce que l’identité de ses fournisseurs ne soit pas révélée prime sur les intérêts des demanderesses à ce que leurs droits de parties soient respectés de manière intégrale et illimitée (c. 5c). En vertu de l’art. 8 CC, il incombe aux demanderesses d’établir la vraisemblance des faits qu’elles allèguent (c. 7). Le principe de l’épuisement ne s’applique qu’aux marchandises originales, et non aux contrefaçons. Le titulaire d’une marque qui prétend qu’elle a été contrefaite doit supporter le fardeau de la preuve de son affirmation (c. 9e). Il incombe par conséquent d’abord aux demanderesses de rendre vraisemblable que les chaussures litigieuses constituent des contrefaçons. Elles ne peuvent déduire du principe de l’épuisement qu’il incomberait préalablement à la défenderesse de rendre vraisemblable que les chaussures litigieuses ont été mises en circulation avec leur consentement. Un tel fardeau de la preuve ne serait concevable que si les demanderesses avaient affirmé et rendu vraisemblable que ces marchandises constitueraient des originaux, mis en circulation sans leur consentement (c. 9f). Le simple fait que les numéros de série imprimés sur les étiquettes apposées sur les chaussures ne figurent pas dans la base de données des demanderesses ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence d’une contrefaçon. Pour rendre vraisemblable l’existence de faux, il s’agit plutôt d’établir l’existence de divergences dans les propriétés spécifiques du produit. Dans la mesure où des numéros de série ne servent qu’au contrôle d’un système de distribution, même leur modification n’est pas condamnable en droit des marques (c. 13b). Des documents confidentiels retenus par les demanderesses, qui auraient selon elles pu rendre vraisemblable la contrefaçon, ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure de mesures provisionnelles. Les demanderesses auraient pu les verser au dossier en requérant que les mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts soient prises, en vertu de l’art. 156 CPC (c. 13c). La défenderesse parvient à rendre vraisemblable que la plupart des chaussures litigieuses ne constitue pas des contrefaçons (c. 14-15). Les demanderesses ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu’il s’agit de faux (c. 15). Elles ne parviennent pas non plus à rendre vraisemblable que la défenderesse ait émis des affirmations inexactes ou ait créé un risque de confusion au sens des art. 3 lit. b et d LCD (c. 16d). Pour ces motifs, les requêtes de mesures provisionnelles sont rejetées (c. 17). [SR]
- Art. 8
- Art. 156
- Art. 152
- Art. 3
-- al. 1 lit. b
-- al. 1 lit. d
- Art. 13
Marque combinée, action en constatation
de la nullité d’une marque, action en remise du gain, action en dommage
et intérêts, action en cessation, action en interdiction, action en fourniture de
renseignements, décision intermédiaire, décision incidente, produits pornographiques,
préservatif, valeur litigieuse, valeur litigieuse minimale, constatation des faits, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, appréciation des
preuves, administration des preuves, libre appréciation des preuves, fardeau de
la preuve, déclaration incomplète, droit d’être entendu, grief irrecevable, interpellation
du tribunal, interprétation d’un témoignage, témoin, for ; art. 29 al. 2
Cst., art. 30 Cst., art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 92
al. 1 LTF, art. 95 LTF, art. 99 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 8 CC,
art. 53 CPC, art. 56 CPC, art. 153 CPC, art. 154 CPC, art. 157 CPC, art. 172 CPC,
art. 109 al. 2 LDIP, cf. N 415 (vol. 2007-2011 ; Kantonsgericht SZ, 17 août 2010,
ZK 2008 19 ; sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) » ; arrêt
du tribunal cantonal schwyzois dans cette affaire) et N 900 (TF, 7 novembre
2013, 4A_224/2013 ; sic! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.)
II »).
Un recours en matière civile interjeté contre une décision incidente portant sur la compétence du tribunal au sens de l’art. 92 al. 1 LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). Le TF ne peut rectifier ou compléter la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De façon manifestement inexacte signifie arbitraire. Il faut en outre que la correction du vice soit décisive pour le sort de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). La partie qui attaque les constatations de faits de l’autorité précédente doit démontrer clairement et de manière substantielle en quoi ces conditions sont remplies. Dans la mesure où elle désire compléter l’état de fait, cette partie doit démontrer, pièces à l’appui, qu’elle avait déjà allégué les faits relevants en question et proposé les moyens de preuves correspondants, conformément à la procédure devant l’autorité précédente. Des faits nouveaux et des preuves nouvelles ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne l’occasion au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, ce qui doit être exposé précisément dans le recours (c. 1.3). La recourante qui qualifie de contradictoires et manifestement inexacts les propos tenus par les témoins au vu des exploits échangés dans la procédure cantonale et du comportement adopté dans cette procédure par le représentant de la partie adverse, et qui accessoirement remet en question la crédibilité du témoin, exerce des griefs de nature appellatoire concernant l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente, sur lesquels le TF n’entre pas en matière (c. 2.1.2). Du moment que, contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration du témoin n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni non plus manifestement incomplète, il n’est pas non plus évident que le tribunal aurait dû, en application par analogie de l’art. 56 CPC, donner l’occasion au témoin, par des questions ciblées, de clarifier et de compléter sa déclaration (c. 2.2.2). L’autorité précédente a ainsi retenu, sans violer le droit fédéral, qu’il ne pouvait qu’être raisonnablement déduit du témoignage intervenu que le témoin confirmait avoir vu et acheté dans la filiale du canton de Schwyz un paquet de préservatifs du type de celui litigieux (c. 2.2.3). La recourante adresse des griefs purement appellatoires concernant le résultat de l’administration des preuves opérée par l’autorité précédente. Elle ne démontre pas qu’une offre de preuves qu’elle aurait proposée régulièrement et en temps utile aurait été refusée, ni non plus dans quelle mesure l’autorité précédente se serait considérée de manière inadmissible comme liée, dans son administration des preuves, par des règles de preuves formelles. La recourante méconnaît en particulier le fait que le principe de la libre appréciation des preuves de l’art. 157 CPC ne change rien au fait que le résultat de l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente lie le TF. L’art. 157 CPC n’a ainsi pas pour conséquence que l’appréciation des preuves en elle-même constituerait une question de droit soumise au libre examen du TF selon l’art. 95 CPC. L’art. 8 CC ne prescrit pas par quels moyens les faits doivent être clarifiés, ni comment le résultat de l’administration des preuves doit être apprécié. La recourante n’établit enfin pas lequel de ses arguments concrets aurait été omis par l’autorité précédente, de sorte qu’elle aurait été empêchée, en violation de son droit d’être entendue, de faire valoir son point de vue dans la procédure. Le TF confirme ainsi que l’autorité précédente a retenu, sans violation du droit fédéral, sa compétence à raison du lieu (c. 3.2). [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
- en remise du gain, voir ég. remise du gain
- en fourniture de renseignements
- dans la constatation des faits
- combinée
- minimale
- Art. 8
- Art. 172
- Art. 157
- Art. 154
- Art. 153
- Art. 56
- Art. 53
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 30
- Art. 109
-- al. 2
- Art. 92
-- al. 1
- Art. 106
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 2
-- al. 1
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
- Art. 99
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
HG AG, 5 mars 2014, HOR.2012.23 (d)
sic! 9/2014, p. 545-554, « Rollmate » ;
conditions de la protection du design, novae, égouttoir mobile, principe de la
rapidité de la procédure, principe de la bonne foi en procédure, qualité pour
agir du preneur de licence, présomption de la nouveauté du design, présomption
de l’originalité du design, présomption du droit de déposer un design, nullité
d’un design, fardeau de la preuve, fait dirimant, représentation du design,
étendue de la protection, originalité en droit des designs, nouveauté en droit des
designs, impression générale, souvenir à court terme, caractère techniquement
nécessaire, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, concurrence
déloyale, concurrents, risque de confusion nié, numerus clausus des droits
de propriété intellectuelle ; art. 8 CC, art. 1 LDes, art. 2 al. 1 LDes, art. 2 al. 3 LDes,
art. 4 lit. a LDes, art. 4 lit. b LDes, art. 4 lit. c LDes, art. 8 LDes, art. 19 al. 1 lit. b LDes, art. 21 LDes, art. 35 al. 4 LDes, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 3 al. 1 lit. e LCD,
art. 9 al. 1 LCD, art. 52 CPC, art. 124 al. 1 CPC, art. 229 al. 1 lit. a CPC, art. 229
al. 1 lit. b CPC, art. 229 al. 2 CPC.
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne peuvent plus être invoqués que de manière limitée après un second échange d’écritures. Ne sont alors procéduralement plus admissibles que les novae proprement dit (art. 229 al. 1 lit. a CPC) ou les novae improprement dit qui, en dépit de la diligence requise, ne pouvaient être invoqués plus tôt (art. 229 al. 1 lit. bCPC). Ces novae doivent dans tous les cas être invoqués immédiatement après leur découverte. Les conserver « en réserve » pendant des semaines ou des mois jusqu’à l’audience principale viole les principes du respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52CPC), ainsi que de la conduite rapide de la procédure au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (c. 2.2). Invoquer comme en l’espèce des novae ou de faux novae plus de trois semaines après leur découverte est notoirement tardif (c. 2.3.2). En vertu de l’art. 35 al. 4 LDes, celui qui est au bénéfice d’une licence exclusive dispose de la qualité pour agir, indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. L’art. 35 al. 4 LDes confère ainsi au preneur de licence exclusif un droit d’agir général et indépendant. L’autorisation d’agir peut ensuite être limitée, matériellement, temporellement ou territorialement, par la portée de la licence (c. 3.2.1). Le tribunal considère qu’une confirmation écrite qu’une licence d’exploitation et de commercialisation du design enregistré « Rollmatte » pour la Suisse a été accordée au preneur de licence par le bénéficiaire de l’enregistrement de ce design, sans aucune restriction quant à la matière, ni quant au temps, constitue la preuve indirecte tant de l’existence d’un contrat de licence exclusive valant sans limitation pour l’ensemble du territoire de la Suisse, que de la qualité pour agir du preneur de licence (c. 3.2.2). La présomption de validité d’un design enregistré déduite de l’art. 21 LDes concerne les exigences de nouveauté et d’originalité du design, ainsi que celle se rapportant à la qualité pour le déposer. Cette présomption ne porte par contrepas sur le caractère techniquement nécessaire ou non du design, et il n’y a pas de raison d’en étendre le champ d’application au-delà de la lettre même de l’art. 21 LDes. Il devrait par conséquent revenir au titulaire du droit au design d’établir que les caractéristiques du design enregistré ne découlent pas exclusivement de sa fonction technique, au sens de l’art. 4 lit. c LDes. Comme toutefois il résulte d’une interprétation systématique de la LDes que le motif d’exclusion à l’enregistrement des caractéristiques techniquement nécessaires a été conçu par le législateur comme une exception à la protection qui ne doit être retenue que lorsque le caractère imposé par la technique d’un produit est établi, il s’agit d’un fait dirimant dont la preuve incombe à celui qui se prévaut de la nullité du design considéré (cons. 5.2). L’art. 4 lit. a LDes trouve application lorsque les illustrations déposées ne permettent pas de discerner clairement quel est l’objet de la protection ou lorsque la représentation qui en est donnée n’est pas suffisamment concrète. L’art. 19 al. 1 lit. b LDes ne précise pas quel doit être le contenu de la représentation du design que doit comporter le dépôt, dont il dit seulement qu’elle doit se prêter à la reproduction. Ce sont toutefois les représentations déposées qui constituent la base de la protection et leur choix est donc de grande importance, en particulier pour la détermination de l’étendue de la protection au sens de l’art. 8 LDes, et pour l’examen des conditions matérielles de la protection selon l’art. 2 LDes. N’est ainsi en particulier protégé que ce qui peut être reproduit sur la base de l’ensemble des représentations déposées ; et le titulaire d’un design ne peut pas se prévaloir dans la détermination du champ de protection de caractéristiques qui ne sont pas exprimées par les représentations déposées. De petites différences entre les illustrations ne portent pas à conséquence concernant l’existence même de l’enregistrement, mais sont prises en compte dans la détermination de l’étendue de la protection qu’elles contribuent le cas échéant à limiter en défaveur du déposant, dans la mesure où il convient alors d’ignorer les différences dans la détermination du champ de protection (c. 6.1.2 et c. 6.1.3). L’examen de l’exigence d’originalité de l’art. 2 al. 3 LDes constitue un examen élargi ou relatif de l’exigence de nouveauté, rendant l’examen séparé de cette dernière obsolète. Si l’exception d’absence d’originalité s’avérait infondée, celle se rapportant à l’absence de nouveauté le serait du même coup, l’absence d’originalité d’un design impliquant également son absence de nouveauté (c. 6.2.1.2). La Cour considère que l’acquéreur potentiel du produit, comme le professionnel d’ailleurs, sera attentif non seulement aux barreaux parallèles métalliques présents dans les deux objets, mais aussi à la terminaison de leurs extrémités dont la construction très différente marquera plus la mémoire que la présence de baguettes métalliques, l’utilisation de métal pour les ustensiles de cuisine étant peu frappante. Pour la Cour, la terminaison des côtés du dessous-de-plat détermine l’impression d’ensemble et génère une impression très technique avec ses différents maillons qui évoquent une chaîne de vélo et ressortent de manière proéminente en semblant opérer une coupure des baguettes, alors que celles-ci paraissent se prolonger jusqu’à l’extrémité des bords de l’égouttoir déroulant dans lesquels elles demeurent visibles en filigrane. Les deux produits étant d’une structure et d’une constitution largement différentes, le premier dessous-de-plat invoqué comme constituant une antériorité ne ruine pas l’originalité de l’égouttoir déroulant. Le deuxième dessous-de-plat examiné n’y réussit pas non plus, d’une part parce qu’il ne peut pas être roulé sur lui-même, ensuite parce qu’il est dépourvu d’éléments de liaison entre ses barres à leurs extrémités et que du fait des éléments métalliques utilisés et de la manière dont ils sont agencés, il frappe par son design minimaliste dont l’impression d’ensemble est marquée par des barreaux reposant sur deux éléments de liaison métallique également en forme de grille ouverte (c. 6.2.2.3). Le terme de « technique » doit être compris au sens large et englobe tous les aspects fonctionnels liés à l’utilisation d’un produit. Cela comprend les dispositions de forme qui découlent de l’utilisation conforme à sa destination, de l’emploi ou du maniement d’un produit sans qu’une liberté créatrice demeure, ou lorsqu’il n’existe aucune alternative de conception raisonnable pour atteindre le même effet technique. L’art. 4 lit. c LDes ne concerne ainsi que les cas dans lesquels aucune alternative de forme ne permet d’atteindre l’effet technique ou fonctionnel recherché et pour lesquels il n’existe donc qu’une seule forme d’exécution raisonnable (c. 6.3.2). Un égouttoir mobile doit bien remplir certaines caractéristiques techniques pour permettre à la fois l’écoulement de l’eau et la « portabilité » du dispositif. On peut se demander si le fait que l’égouttoir puisse se dérouler doit être ajouté à ces deux premières caractéristiques techniques dans la mesure où il s’agit seulement d’un élément nécessaire à la mobilité du tout, et pas à la qualité de l’égouttement. Comme toutefois l’enroulement du dispositif n’est qu’une manière d’en assurer le caractère mobile et qu’il en existe beaucoup d’autres, l’enroulement de l’égouttoir sur lui-même n’est pas un critère autonome à prendre en compte comme moyen technique d’assurer la mobilité de l’égouttoir, dans l’examen du caractère techniquement nécessaire du design. Dans le cas particulier du design dont la validité est attaquée, ni les baguettes parallèles dans leur milieu, ni leur dispositif de fixation aux extrémités ne sont dans leur apparence concrète exclusivement conditionnés par leur fonction technique. Les baguettes pourraient avoir d’autres formes (carrée, rectangulaire, ovale) permettant aussi bien l’égouttement que leur forme sphérique ; la distance entre les baguettes pourrait être différente. Elles pourraient aussi être de longueur différente avec des alternances, etc., et finalement le dispositif de fixation entre les baguettes pourrait aussi être conçu de manière complètement différente. Il existe ainsi, dans le cas d’espèce, une certaine liberté de création et des alternatives de forme qui permettraient d’obtenir le même effet fonctionnel recherché de disposer d’un égouttoir mobile déroulant (c. 6.3.3). Le caractère techniquement nécessaire du design de l’égouttoir n’est donc pas retenu. Le preneur de licence exclusive participe à la concurrence dans la mesure où il bénéfice des droits exclusifs d’utilisation et a la qualité pour agir au sens de l’art. 9 al. 1 LCD (c. 8.2.1). Cette légitimation active découle aussi de ce que les marchés visés par les deux produits sont les mêmes du point de vue matériel, temporel et géographique (c. 8.2.2). Les dispositions de la LCD s’appliquent indépendamment de celles du droit des biens immatériels et la théorie selon laquelle un acte ne tombant pas sous le coup d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait devenir illicite du fait de la LCD « Umwegthese » a été abandonnée. Les prétentions fondées sur le droit du design et celles découlant de la LCD sont ainsi indépendantes et peuvent être allouées indépendamment l’une de l’autre, pour autant que leurs conditions d’application respectives soient satisfaites (c. 8.3). La différence visuelle importante que les deux designs présentent du point de vue de leur impression d’ensemble exclut tout risque de confusion entre eux au sens de la LCD également. Le choix du consommateur, s’il est guidé par l’esthétique des deux produits, exclut lui aussi tout risque de confusion, d’autant qu’on peut attendre de ce public cible, soucieux de l’esthétique de sa cuisine, un degré d’attention accru (c. 8.4.3). L’apposition de la marque de la défenderesse de manière bien visible sur ses produits est aussi de nature à lever tout risque de confusion éventuel (c. 8.4.3). [NT]


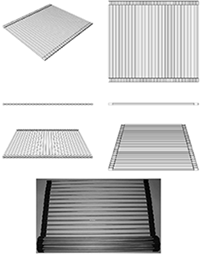
Caractère techniquement nécessaire
- déloyale
- accru
- dirimant
- générale
Numerus clausus des droits de propriété intellectuelle
- de la rapidité de la procédure
-- en procédure
- du droit de déposer un design
-- nié
- Art. 8
- Art. 124
-- al. 1
- Art. 52
- Art. 229
-- al. 2
-- al. 1 lit. b
-- al. 1 lit. a
- Art. 3
-- al. 1 lit. e
-- al. 1 lit. d
- Art. 9
-- al. 1
- Art. 35
-- al. 4
- Art. 21
- Art. 8
- Art. 4
-- lit. a
-- lit. b
-- lit. c
- Art. 19
-- al. 1 lit. b
- Art. 2
-- al. 1
-- al. 3
- Art. 1
sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée » ; brevet, horlogerie, violation d’un brevet, couronne dentée, affichage, mécanisme d’affichage, guichet de cadran, cadran, grande date, mouvement, montre, dispositif d’affichage, homme de métier, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’un brevet, action en fourniture de renseignements, action échelonnée, description du comportement illicite, cumul des titres de protection, extension illicite de l’objet du brevet, nouveauté en droit des brevets, non évidence, conclusions précises, remise du gain, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, maxime de disposition, concurrence déloyale ; art. 26 al. 1 lit. a LTFB, art. 26 al. 4 LTFB, art. 41 LTFB, art. 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011, art. 8 CC, art. 26 al. 1 lit. a LBI, art. 26 al. 1 lit. c LBI, art. 26 al. 1 lit. d LBI, art. 51 al. 1 LBI, art. 58 al. 2 LBI, art. 66 lit. a LBI, art. 66 lit. b LBI, art. 72 LBI, art. 125 al. 1 LBI, art. 3 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014 ; sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II ») et N 929 (TFB, 2 juin 2015, O2012_033 ; sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III »).
L’art. 41 LTFB implique un transfert automatique au TFB de tous les procès qui n’ont pas encore été plaidés sur le fond au 1er janvier 2012, quel que soit l’avancement de l’instruction. Selon l’art. 10 des Directives procédurales du TFB, le TFB reprend le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LTFB, sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, dans la mesure où la juridiction cantonale concernée justifie que les débats principaux n’ont pas encore eu lieu. L’interprétation du droit cantonal revient aux juridictions cantonales auxquelles il appartient de déterminer à quel moment il convient d’admettre, selon leur propre procédure cantonale, que les débats principaux sont réputés avoir eu lieu (c. 14). Les actions en cessation de trouble doivent viser l’interdiction d’un comportement précisément décrit. La partie condamnée doit apprendre ce qu’elle n’est plus en droit de faire, et les autorités d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quel comportement elles doivent empêcher ou peuvent assortir d’une peine. Si l’on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a répété un acte prohibé malgré l’interdiction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions factuelles invoquées sont remplies. En revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause. Mentionner l’essence des revendications d’un brevet dans les conclusions visant l’interdiction de sa violation peut s’avérer insuffisant. Le mode de violation du brevet ou le mode d’exécution allégué doit ainsi être décrit de façon à ce qu’un examen purement factuel permette sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée. Il faut donc décrire la forme de violation comme un acte technique réel, à travers certaines caractéristiques qui ne nécessitent aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus. Ceci en particulier parce que le dispositif du jugement, éventuellement interprété sur la base des considérants, doit exposer concrètement quelles caractéristiques du mode d’exécution sont attaquées en tant que mise en œuvre de l’enseignement technique. Il ne suffit ainsi pas de répéter les caractéristiques mentionnées dans le brevet. Une description du mode de violation est nécessaire; et ce n’est que lorsque les caractéristiques du mode d’exécution utilisant le brevet litigieux sont concrètement désignées qu’une éventuelle interdiction peut être exécutée. Ce n’est en fait que lorsque l’énoncé de la revendication est spécifique au point qu’un examen purement factuel permet sans autre de constater si on est en présence d’une forme d’exécution prohibée et que cet énoncé ne nécessite aucune interprétation juridique ou interprétation de termes techniques ambigus, que la désignation concrète des caractéristiques techniques concrètes du mode d’exécution peut se confondre avec l’énoncé de la revendication qui fonde l’interdiction. Ce qui a été admis en l’espèce (c. 17). Est réputée constituer une extension allant au-delà du contenu des pièces initialement déposées, une modification qui n’est pas divulguée à la date pertinente (de dépôt ou d’un éventuel report au sens de l’art. 58 a LBI), soit un enrichissement technique du contenu de la demande et donc un apport d’informations de nature technique qui ne se déduit pas – directement et sans ambiguïté – de l’intégralité du contenu technique – explicite ou implicite – soumis à la date pertinente. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond, en principe, le fardeau de l’allégation et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation. La partie qui entend se prévaloir d’un motif de nullité d’un brevet supporte le fardeau de la preuve, à moins que la loi n’en dispose autrement, conformément à l’art. 8 CC. Un état de fait qui n’a pas été allégué par la partie qui en supporte le fardeau ne peut pas être admis par le juge et, si en raison d’un défaut d’allégation, un état de fait ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit se prononcer en vertu de l’art. 8 CC en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Dès lors que la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité découlant d’une extension illicite de l’art. 26 al. 1 lit. c LBI supporte le fardeau de la preuve de cette extension illicite et doit alléguer de façon détaillée d’une part la modification en cause et d’autre part la détermination de l’homme du métier et l’étendue de ses connaissances à la date pertinente (date de dépôt ou de report). Le même principe d’allégation détaillée relative à l’homme du métier et à ses connaissances s’applique à la question de l’activité inventive et à la suffisance de description au sens des art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI. Il ne suffit dès lors pas de simplement alléguer qu’une modification particulière ne serait pas explicitée dans le contenu des pièces initialement déposées (à la date de dépôt ou de report). Encore faut-il identifier l’homme du métier (typiquement par sa profession et/ou sa formation) et ses connaissances générales (typiquement les sujets techniques qu’il doit maîtriser en sa qualité d’homme du métier déterminé) à la date pertinente et expliquer pour quels motifs une telle modification ne se déduirait pas du contenu explicite des pièces initialement déposées à l’aide des connaissances de l’homme du métier (c. 19). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour a retenu en outre qu’il résultait de l’examen des pièces modifiées en cours de procédure d’enregistrement qu’aucune extension illicite n’était intervenue (c. 20 et c. 21-23). Concernant la nouveauté, la Cour rappelle qu’une combinaison avec d’autres documents n’est pas admissible et considère qu’il convient dès lors d’admettre la nouveauté de l’invention revendiquée par rapport aux deux antériorités invoquées (c. 26). Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour l’homme du métier elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’homme du métier joue ainsi un rôle décisif dans l’appréciation de l’activité inventive. À l’instar de la question de l’examen de l’extension illicite, l’appréciation de l’activité inventive présuppose une allégation détaillée quant à la détermination de l’homme du métier et ses connaissances à la date pertinente par la partie qui souhaite se prévaloir du motif de nullité correspondant au sens de l’art. 26 al. 1 lit. a (en relation avec l’art. 1 al. 2) et 26 al. 1 lit. b LBI. Cette information est nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient incité et permis à l’homme du métier de combler une lacune entre une ou plusieurs antériorités déterminées (par exemple une ou plusieurs publications et/ou usage public antérieur) et l’invention revendiquée. Une telle allégation détaillée est également nécessaire afin de déterminer si ses connaissances générales auraient permis à l’homme du métier de combiner les enseignements contenus dans des antériorités différentes afin de les réduire en un mode d’exécution combinée (réelle) couvert par l’invention revendiquée. Le défaut d’une allégation détaillée en ce sens contraint en principe le juge à rejeter le motif de nullité invoqué, ainsi que cela a été fait en l’espèce, la demanderesse ayant présenté l’homme du métier uniquement comme un praticien du domaine technologique normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné et qui est censé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique (c. 32). Selon l’art. 125 al. 1 LBI, dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen. Dans le contexte de la LBI, une invention se comprend comme une règle de comportement technique portant sur l’utilisation des éléments naturels ou des forces de la nature et aboutissant à un résultat déterminé. L’invention est définie dans une ou plusieurs revendications du brevet (art. 51 al. 1 LBI). En l’espèce, la revendication 1 du brevet suisse concerné ne définit pas la même invention que celle de la revendication 1 du brevet européen. Le brevet suisse décrit ainsi une règle différente de celle du brevet européen. Par conséquent, les deux brevets ne protègent pas la même invention et les conditions d’application de l’art. 125 LBI ne sont pas réalisées (c. 37). L’art. 72 al. 1 LBI prévoit que celui qui est atteint ou menacé dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 LBI, notamment par la contrefaçon ou par l’imitation d’une invention brevetée (art. 66 lit. a LBI) peut demander la cessation de cet acte. Comme en l’espèce la demanderesse a prouvé que la défenderesse viole le brevet litigieux, comme l’atteinte a déjà commencé et, comme selon la correspondance échangée entre les parties respectives et leurs conseils, et selon les contestations intervenues dans la présente procédure, elle n’a pas pris fin, il convient d’ordonner à la défenderesse – sous la menace de l’art. 292 CP, soit l’amende – de cesser tout usage du mécanisme breveté en relation avec des montres (c. 40). Quand il est, comme en l’espèce, impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque l’ignorance résulte de faits qui sont entre les mains du défendeur ou d’un tiers, le demandeur peut intenter une action dite échelonnée, dans laquelle une conclusion en reddition de comptes est liée à une conclusion indéterminée en paiement de la somme due. La seconde est principale, la première est complémentaire. L’action en renseignement découle de l’art. 66 lit. b LBI (c. 41). [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
- en fourniture de renseignements
- précise
- déloyale
Extension illicite de l'objet du brevet
- du gain
- Art. 8
Directives procédurales du TFB du 28.11.2011
- Art. 10
- Art. 125
-- al. 1
- Art. 58
-- al. 2
- Art. 72
- Art. 66
-- lit. b
-- lit. a
- Art. 51
-- al. 1
- Art. 26
-- al. 1 lit. a
-- al. 1 lit. d
-- al. 1 lit. c
- Art. 3
-- al. 1 lit. b
- Art. 41
- Art. 26
-- al. 4
-- al. 1 lit. a
sic! 1/2015, p. 37-46, « Arthursgroup SA / SwissArthurProd SA », JdT2015 II 204, JdT 2015 II 208 ; raison de commerce, instance cantonale unique, marque de service, spectacle, services de production de spectacles, concert, péremption, usage à titre de marque, usage à titre de raison de commerce, usage de la marque, produit ou service accessoire, preuve d’un fait négatif, preuve de l’usage d’une marque, preuve du défaut d’usage, bonne foi, similarité des produits ou services, services de divertissement, activités culturelles, similarité des raisons de commerce, droit d’être entendu, principe de la spécialité, publication du jugement ; art. 9 Cst., art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 107 al. 1 LTF, art. 2 CC, art. 8 CC, art. 933 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 15 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC, art. 5 al. 1 lit. c CPC, art. 52 CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n’a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Le TF doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d’office les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. ou établies en violation du droit comme l’entend l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) (c. 1.3). Le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF) (c. 1.4). L’usage de la marque doit intervenir conformément à la fonction de celle-ci pour distinguer les produits ou les services, soit de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque au sens de l’art. 11 al. 1 LPM est une question de droit. Pour opérer cette qualification, il convient toutefois de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services enregistrés. Les circonstances du cas particulier doivent, pour cela, être prises en considération, notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, constatations qui relèvent du fait (c. 3.2). L’utilisation d’une marque en relation avec des produits ou services auxiliaires ne valide pas le droit à la marque pour de tels produits ou services. Sont considérés comme tels les produits ou services qui font partie de l’offre du produit ou service principal et qui lui sont accessoires sans être commercialisés de manière indépendante. Les produits ou les services qui, bien qu’accessoires au produit ou au service principal, sont offerts à titre onéreux ne peuvent plus être considérés, sous réserve des situations dans lesquelles la contrepartie ne serait que symbolique, comme produits/services auxiliaires. Il restera toutefois à établir l’existence d’un usage sérieux de la marque apposée sur ces produits/services (c. 3.3). Un usage purement symbolique fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit manifester l’intention de satisfaire toute demande de marchandise ou de service. Par ailleurs, l’usage doit être économiquement raisonnable et intervenir dans le commerce. Un usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Les usages commerciaux habituels sont déterminants (c. 3.4). En ce qui concerne la preuve du défaut d’usage, l’art. 12 al. 3 LPM tient compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif. Quiconque invoque le défaut d’usage doit donc le rendre vraisemblable, la (contre)-preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation de nature procédurale ne constitue toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve (c. 3.5). Pour satisfaire à l’exigence de la (contre)-preuve, il incombe au titulaire d’établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage intervient conformément à la fonction de la marque, que les produits ou services considérés ne sont pas des services auxiliaires et que l’usage de la marque est sérieux. Si la marque a été enregistrée pour plusieurs produits et/ou services, il appartient au titulaire d’apporter, en lien avec chacun des produits/services revendiqués, les éléments de preuves précités (c. 3.6). L’organisation de trois soirées entre 2007 et 2011 ne représente pas une exploitation suffisante pour satisfaire à l’exigence qui découle implicitement de l’art. 11 al. 1 LPM. Ce d’autant que la recourante ne fournit aucune donnée qui permettrait de compenser l’usage très limité sur le plan quantitatif (pendant le délai de carence) par un chiffre d’affaires particulièrement élevé (c. 3.7.1). Le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’usage de signes similaires et destinés à des produits ou des services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c et art. 13 al. 2 LPM). L’existence de ce risque est une question de droit que le TF examine librement dans le cadre d’un recours en matière civile (c. 4.2). Sous réserve de la marque de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM lorsque les produits et services ne sont pas similaires, indépendamment des signes qui sont confrontés. Le simple fait qu’il puisse exister des chevauchements entre les groupes de consommateurs concernés par les services examinés ou entre les lieux où les prestations sont fournies ne permet pas de conclure à la similitude des services (c. 4.3). Les services de divertissement, de spectacles et de concert, d’organisation et de production de manifestations culturelles sont des offres distinctes économiquement des services des cafetiers-restaurateurs. Une similitude entre les services liés à de la restauration (exploitation de cafés, restaurants, bars, dancings, cabarets et hôtels) et ceux d’organisation ou production de manifestations culturelles et de spectacles est exclue et tout risque de confusion entre les marques peut être écarté (c. 4.4). Le principe de la spécialité ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Les raisons de commerce litigieuses qui contiennent toutes deux le même élément essentiel Arthur ne se distinguent pas de manière suffisamment nette pour qu’un risque de confusion puisse être nié. L’existence de confusion concrète n’est qu’un indice de l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). La péremption du droit d’agir ne doit pas être admise facilement, car selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif. La péremption est admise avec encore plus de retenue en cas de conflit entre raisons de commerce. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 6.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, en vertu de l’effet positif du registre du commerce (au sens de l’art. 933 al. 1 CO), l’inscription de la raison de commerce devient opposable aux tiers dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le No de la Feuille Officielle Suisse du Commerce où est publiée l’inscription (art. 932 al. 2 CO) (c. 6.2). Plus la période pendant laquelle l’ayant droit tolère l’usage concurrent est longue, plus l’auteur de la violation sera fondé à admettre, selon les règles de la bonne foi, que l’ayant droit continuera à tolérer la violation et qu’on ne pourra exiger de lui qu’il doive abandonner la situation acquise. L’ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la péremption même vis-à-vis de celui qui s’est consciemment approprié un signe distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité, il amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction légitime que la violation est tolérée. La jurisprudence récente en matière de signe distinctif opte pour une période entre 4 et 8 ans. Dans un cas particulier, la péremption a déjà été admise au bout d’une année et demie et dans un autre cas envisagée après une période de 2 ans (c. 6.3). La répétition d’interpellations non suivies d’effet peut conforter l’auteur de l’atteinte dans la conviction que l’ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice (c. 6.4). S’agissant enfin de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (c. 6.5). À cet égard, la valeur appréciable créée par l’auteur de l’atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption. Le TF rappelle que le facteur temps revêt également une grande importance dans l’examen de la passivité de l’ayant droit et que dans le cas d’espèce une durée d’inaction de 19 mois jusqu’à la première mise en demeure est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Considérer la durée d’inactivité comme suffisante en l’espèce conduirait à une situation inacceptable. Cela reviendrait à favoriser les entreprises qui sont susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leurs signes au moyen d’une réclame massive, ce qui ne correspond pas au fondement de la péremption qui tend à une protection de la confiance et non à celle de la possession (c. 6.6). Considérant une éventuelle intervention de la péremption entre la première mise en demeure (16 mars 2010) et l’introduction de l’action (20 juin 2012), le TF relève qu’il s’agit de savoir si la passivité prolongée de l’ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu’il le serait également à l’avenir, mais qu’il ne s’agit pas de contraindre l’ayant droit à agir avec une certaine célérité. En l’espèce, le TF considère que la passivité de la lésée n’a pas pu créer une apparence d’autorisation ; et que le contenu des mises en demeure était clair et ne pouvait en soi laisser croire à la défenderesse que l’ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits. Si la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l’action indéfiniment, il serait néanmoins absurde d’admettre la péremption dans l’hypothèse où l’ayant droit interpelle plusieurs fois sa partie adverse (sur une brève période) pour communiquer à celle-ci qu’il n’entend précisément pas tolérer l’utilisation du signe litigieux, alors que ce droit d’action n’aurait pas été éteint s’il n’avait interpelé qu’une seule fois sa partie adverse. La jurisprudence n’exige pas le renouvellement des mises en demeure sur des périodes aussi brèves et la péremption doit être admise avec une encore plus grande retenue lorsque l’ayant droit a déjà mis en demeure l’auteur de la prétendue violation (c. 6.7). Le droit d’action de la demanderesse n’étant pas périmé, la violation de l’art. 956 CO pouvait être invoquée en justice par celle-ci (c. 6.8). L’usage indu consiste en l’occurrence à avoir transgressé la règle de l’art. 951 al. 2 CO qui contient l’obligation de choisir une raison de commerce qui se distingue suffisamment d’une autre raison de commerce antérieure. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l’activité commerciale, par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des catalogues, des listes de prix, des prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (c. 6.8.4). La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce que la publication, qui doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés, soit ordonnée par le juge. Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public. Le recours est partiellement admis s’agissant du risque de confusion entre les raisons de commerce. [NT]
- Art. 8
- Art. 2
- Art. 933
-- al. 1
- Art. 956
- Art. 951
-- al. 2
- Art. 52
- Art. 5
-- al. 1 lit. c
-- al. 1 lit. a
- Art. 9
- Art. 12
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2
- Art. 15
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
-- al. 1
- Art. 107
-- al. 1
- Art. 75
-- al. 2
-- al. 2 lit. a
- Art. 95
- Art. 105
-- al. 1
-- al. 2
- Art. 99
-- al. 2
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
« ABANCA », « ABANKA », usage de la marque, usage à titre de marque, marque internationale, banque, défaut d’usage, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, action en constatation de la nullité d’une marque, procédure administrative en radiation, intérêt pour agir, fardeau de la preuve, vraisemblance, expertise privée, rapport de recherche, maxime de disposition, cercle des destinataires pertinent ; art. 8 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 35 LPM, art. 35a al. 1 LPM, art. 55 CPC.
Le défaut d’usage peut être invoqué dans le cadre d’une action en radiation qui n’est pas expressément prévue par la LPM, mais découle implicitement de la loi. Chacun peut faire valoir un défaut d’usage au sens de l’art. 12 LPM. Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un intérêt particulier pour le faire car l’intérêt général à ne pas être entravé dans la libre formation d’un signe distinctif par des marques nulles faute d’usage suffit en règle générale. Exceptionnellement, un intérêt digne de protection au prononcé de la nullité d’une marque peut faire défaut, lorsque la partie qui requiert la constatation de cette nullité ne pourra pas utiliser le signe ou un signe semblable ou ne sera pas autorisée à le faire pour d’autres motifs qui lui sont propres, de sorte que l’enregistrement de la marque non utilisée ne constitue pas pour elle un empêchement supplémentaire à son libre choix d’un signe comme marque. En pareil cas, le défaut d’usage ne peut être invoqué que si l’opposante dispose néanmoins, en raison de circonstances particulières, d’un intérêt digne de protection à empêcher le maintien en vigueur d’une marque déchue faute d’usage (c. 3.1). A côté d’une action civile en radiation ou en nullité, existe désormais une procédure administrative en radiation, dans le cadre de laquelle chacun peut adresser une demande de radiation à l’IPI faute d’usage selon l’art. 35a al. 1 LPM (c. 3.2). L’obligation d’usage de l’art. 11 al. 1 LPM correspond à la fonction commerciale de la marque : seuls les signes qui sont effectivement utilisés dans le commerce après l'échéance du délai de grâce et qui remplissent ainsi leur fonction distinctive et d’indication de provenance industrielle peuvent bénéficier du monopole du droit des marques. L’obligation d’usage permet aussi d’éviter que des marques soient enregistrées à titre de réserve, que le registre des marques soit ainsi artificiellement gonflé et la création de nouvelles marques entravée (c. 3.3). Celui qui invoque un défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l’usage incombe alors au titulaire de la marque (c. 3.4). Une expertise de partie qui n’a que la valeur d’un allégué peut contribuer, en lien avec d’autres indices, à rendre une absence d’usage vraisemblable (c. 4.1). Parmi les moyens permettant de rendre vraisemblable un défaut d’usage, la doctrine en matière de marque mentionne en particulier les rapports de recherche négatifs qui documentent une absence de réponse des fournisseurs et des commerçants concernés, le matériel publicitaire se rapportant à la période concernée, une présence ou plutôt une non présence sur Internet, etc. L’avis d’un professionnel de la branche entre aussi en ligne de compte. Parmi les indices de non usage qui ont permis d’étayer le rapport de recherche qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais uniquement une expertise de partie, le TF relève l’absence d’établissement, de représentation et de collaborateurs en Suisse du titulaire de la marque concernée ; le fait qu’aucune publicité pour les produits ne soit intervenue en Suisse ; le fait enfin que le résultat de recherche en ligne ne permette pas d’établir d’activité, de publicité ou autre en Suisse, ni non plus une présence en ligne du titulaire de la marque (c. 4.1). Le défaut d’usage ayant été rendu vraisemblable, la recourante aurait dû apporter une preuve stricte de l’usage (c. 4.3). L’usage maintenant le droit à la marque doit être un usage sérieux, soit animé du désir de satisfaire toute la demande du marché, sans pour autant qu’un chiffre d’affaires minimum n’ait à être atteint. Pour être sérieux, l’usage doit être économiquement relevant et ne pas se limiter à une apparence d’usage seulement. Il doit être établi en Suisse, et le signe distinctif doit être utilisé dans le commerce. Enfin, l’usage doit intervenir conformément à la fonction d’une marque, soit comme signe distinctif de certains produits ou services. Tel est clairement le cas lorsque la marque est apposée sur les produits ou leur emballage. La marque peut toutefois aussi être utilisée autrement en relation avec les produits ou services revendiqués, pour autant que les acteurs commerciaux perçoivent concrètement l’utilisation comme étant celle d’un signe distinctif. C’est la perception des consommateurs auxquels est destinée l’offre des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, qui est déterminante pour décider du caractère sérieux de l’usage fait de celle-ci. Les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte, notamment les coutumes de la branche économique concernée. Le cercle des destinataires pertinent se détermine en fonction des produits/services pour lesquels la marque est revendiquée (c. 5.3). [NT]
- Art. 8
- Art. 55
- Art. 35a
-- al. 1
- Art. 11
-- al. 1
- Art. 12
-- al. 1
-- al. 3
- Art. 35
Bentley, usage à titre de marque, usage de la marque, usage pour l’exportation, territorialité, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque ; art. 8 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.
Les marques d’exportation étant appliquées sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, elles ne répondent pas à l’exigence de la commercialisation sur le territoire suisse. Le législateur en a tenu compte et a prévu, à l’art. 11 al. 2 in fine LPM, que « l’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque » (c. 2.1). Le législateur en introduisant dans la loi la « marque dite d’exportation » a explicitement manifesté son intention d'ancrer l’exigence de « l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) dans le souci de s’aligner par-là sur le droit communautaire qui posait (et pose toujours) cette exigence (voir réf.cit.). L’art. 11 al. 2 in fine LPM ne constitue pas à proprement parler une exception au principe de la territorialité, mais cette règle légale tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne sont pas commercialisés sur le territoire suisse ; elle concède, pour les marques dont les produits sont destinés exclusivement à l’exportation, un allègement de l’exigence de l’usage sur le territoire national, mais sans renoncer à tout rattachement concret avec ce territoire. La marque doit être utilisée en lien avec un produit déterminé. Ainsi, le seul fait d’apposer en Suisse la marque sur un support (hypothèse de l’impression d’étiquette comportant la marque) destiné à un produit maintenu à l’étranger ne répond pas à l’exigence de l’apposition, sur le territoire suisse, de la marque sur le produit (c. 2.2.1). Un usage à titre de marque doit intervenir conformément à la fonction de la marque, c’est-à-dire pour distinguer les produits ou les services. En d’autres termes, l’usage doit être public, la marque devant être utilisée de telle façon que le marché y voie un signe distinctif. Une utilisation dans la sphère interne de l’entreprise du titulaire de la marque ne suffit pas. Ainsi, l’utilisation à des fins privées (par exemple pour récompenser, à certaines occasions, les employés de l’entreprise) ou à l’intérieur de l’entreprise (notamment le flux de marchandises et le stockage à l’interne) n’est pas de nature à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. Dans ce dernier cas, même si les transferts de biens (notamment durant la période de fabrication d’un produit déterminé) entre les sociétés du « groupe » sont en principe inscrits comme des achats-ventes dans la comptabilité propre de chacune des sociétés, il ne s’agit que d’une utilisation (flux de marchandises) à l’interne du « groupe » qui ne vaut pas usage à titre de marque. Cet usage ne pourra alors être reconnu qu’au moment de leur (re)vente à des tiers (grossistes, détaillants, clientèle privée). Pour déterminer si on est en présence d’un usage en tant que marque (qui est une question de droit), il convient de se fonder sur la perception (présumée) des personnes auxquelles s’adressent les produits enregistrés. Les circonstances du cas particulier, et notamment les habitudes de la branche concernée et la catégorie de marque en cause, doivent ainsi être prises en considération (c. 2.3.1). Par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l’usage d’une marque que son non-usage. L’art. 12 al. 3 LPM prévoit ainsi que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire. Ce dernier doit établir tous les éléments de faits qui permettront ensuite au Juge, sous l’angle du droit, de déterminer que l’usage est intervenu conformément à la fonction de la marque (c. 2.3.2). Dans le cas d’espèce, la marque est appliquée sur le cadran destiné aux futures montres, à l’étranger, puis le cadran posé sur les montres en Suisse avant leur exportation. Il n’en résulte pas que l’apposition de la marque interviendrait à l’étranger uniquement et que la condition qu’elle intervienne dans notre pays ne serait pas réalisée, dans la mesure où la marque est simplement appliquée sur un support, le cadran, à l’étranger, puis apparaît réellement sur le produit fini, ce qui constitue l’élément déterminant, sur le territoire suisse, dans le cadre des opérations d’assemblage, au moment où le cadran est posé sur les montres (c. 2.4). Faute toutefois d’avoir établi un usage public, à l’extérieur des sociétés du « groupe » pendant le délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, la défenderesse n’a pas fourni les preuves permettant d’établir l’usage de la marque litigieuse durant la période de carence (c. 2.5.4). Le TF admet le recours en matière civile et réforme l’arrêt attaqué en ce sens que la nullité de la marque litigieuse (pour défaut d’usage) est constatée et qu’il ordonne à l’IPI de radier cette marque pour les produits de la classe 14 (c. 2.6). [NT]
- sérieux
Activité inventive, non-évidence, approche « problème-solution », état de la technique, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 1 al. 2 LBI, art. 7 al. 2 LBI.
Selon l’art. 7 al. 2 LBI, l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. L’état de la technique constitue la base à partir de laquelle sont examinées les exigences tant de nouveauté que d’activité inventive. Les documents qui constituent l’état de la technique doivent être interprétés en fonction de la compréhension de l’homme du métier déterminant au moment du jour du dépôt de la demande de brevet ou de celui du droit de priorité. La lettre même d’un document n’est pas seule déterminante. Doivent également être prises en compte les solutions qui sont présentes dans l’état de la technique et que l’homme du métier peut déduire de manière évidente de ce qui a déjà été publié ; il convient de tenir compte du contenu tout entier d’un document imprimé. C’est en particulier la connaissance technique générale d’une équipe de professionnels de la branche qu’il convient de considérer, telle qu’elle est accessible dans les ouvrages de référence du domaine technique concerné. Des connaissances internes, comme par exemple des résultats de tests ou d’expériences, ne font par contre pas partie de l’état de la technique (c. 2.2). L’approche « problème-solution » est un procédé structuré d’examen de l’activité inventive qui est basé sur le fait que toute invention consiste en un problème (Aufgabe) technique et sa solution. Le problème objectif résolu par l’invention revendiquée est tout d’abord examiné en partant de cette invention par la détermination du (seul) document de l’état de la technique dont l’invention revendiquée est la plus proche. Cet état de la technique le plus proche est ensuite comparé à l’invention revendiquée et les différences structurelles ou fonctionnelles sont listées une à une, pour ensuite formuler sur cette base le problème technique objectif que l’invention revendiquée résout. Immédiatement ensuite, il est déterminé quels pas l’homme du métier déterminant aurait dû entreprendre à partir de l’état de la technique le plus proche pour apporter une solution au problème technique individualisé, et si le procédé a permis d’individualiser, comme état de la technique le plus proche, un seul document qui révèle une solution technique de manière si précise et complète qu’un homme du métier puisse l’exécuter (c. 2.2.1). Une solution technique est exécutable lorsque l’homme du métier dispose d’une indication si précise et complète que sur la base de celle-ci et de ses connaissances professionnelles il est à même d’atteindre la solution proposée par l’enseignement technique d’une manière sûre et répétable. Une invention n’est ainsi brevetable que lorsque la solution technique recherchée peut être atteinte avec certitude et pas seulement par hasard. Le fascicule du brevet doit décrire l’enseignement technique de façon suffisante et l’invention y être présentée de manière à ce que l’homme du métier puisse l’exécuter. Il s’agit là de conditions de validité du brevet (art. 26 al. 1 lit. b LBI). Les éléments techniques évidents dans le domaine n’ont pas à être exposés. Que le fascicule de brevet comporte des erreurs ou des lacunes ne compromet pas l’exécution de l’invention si l’homme du métier est en mesure de les identifier et de les surmonter sur la base de ses connaissances professionnelles générales sans avoir à fournir un effort qui ne puisse pas être attendu de lui. Cela vaut aussi lorsque les indications fournies sont si limitées que l’homme du métier doit prendre un certain temps pour réussir à réaliser l’invention, ou même trouver une solution qui lui soit propre. Une invention n’est toutefois pas exécutable pour l’homme du métier lorsque l’effort à fournir pour l’atteindre dépasse ce qui peut être attendu de lui ou exige qu’il fasse preuve d’activité inventive. La publication d’au moins un mode de réalisation en particulier est exigée et est suffisante, si elle permet l’exécution de l’invention dans l’ensemble du domaine revendiqué. Ce qui compte est le fait que l’homme du métier soit mis en situation de réaliser pour l’essentiel tous les modes d’exécution entrant dans le champ de protection des revendications (c. 2.2.2). Un enseignement technique ne consiste pas seulement en un problème mais aussi en sa solution. Si seul le problème est exposé, et pas sa solution, on n’est pas en présence d’un enseignement technique, sauf dans le cas exceptionnel où le fait de poser le problème découle d’une activité inventive. Lorsqu’une solution technique n’est pas expressément exposée, il faut apporter la preuve que l’homme du métier déterminant, le cas échéant une équipe de professionnels de la branche, aurait trouvé sur la base des indications figurant dans le document et de ses connaissances professionnelles générales, en fournissant un effort pouvant raisonnablement être attendu de lui, au moins une solution concrète au problème technique (c. 2.2.3). L’« exécutabilité » d’un document appartenant à l’état de la technique ne peut pas être présumée, en tout cas lorsque cet état de la technique n’est pas un fascicule de brevet mais la description d’expériences (c. 2.2.5). Un document qui ne décrit qu’un problème sans proposer de solution ne peut pas être considéré comme constituant l’état de la technique la plus proche, lorsque l’examen de l’activité inventive se base sur l’approche « problème-solution » (c. 2.3.2). Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée au TFB. [NT]
« Tarif commun 5 » ; tarifs des sociétés de gestion, négociation des tarifs, devoir de collaboration accru des parties en procédure tarifaire, devoir d’informer les sociétés de gestion, location, prêt , épuisement, recettes brutes, augmentation de redevance, augmentation du tarif, équité du tarif, valeur litigieuse, frais de procédure, interprétation conforme au droit international, interprétation téléologique, égalité de traitement; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 63 al. 4bis PA, art. 1 lit. a OFIPA, art. 2 OFIPA, art. 14 à 18 OFIPA, art. 8 CC, art. 13 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 al. 1 LDA, art. 51 LDA, art. 60 LDA, art. 16a ODAu, art. 16b ODAu.
Même si les associations d’utilisateurs n’avaient pas négocié sérieusement le tarif, cela ne constituerait pas un motif de renvoi de la requête d’approbation (c. 1). En adressant celle-ci en commun à la CAF, les sociétés de gestion ont satisfait à l’obligation prévue à l’art. 47 al. 1 LDA (c. 2). Selon la jurisprudence du TF, les parties à une procédure tarifaire ont un devoir de collaboration accru d’après l’art. 13 al. 1 PA, qui relativise la maxime officielle prévue par l’art. 12 PA et en fait même partie. Ce devoir existe indépendamment de la question de savoir si la partie en question supporte les conséquences de l’absence de preuve. En tant que requérantes, les sociétés de gestion ont le fardeau de la preuve par application analogique de l’art. 8 CC, cela même si les utilisateurs ont l’obligation de les informer d’après l’art. 51 LDA (c. 4.1). Avant de contrôler l’équité d’un tarif, la CAF doit examiner si les utilisations visées par ce tarif sont réservées aux ayants droit et si elles sont soumises à la surveillance de la Confédération (c. 5). En l’espèce, il s’agit d’interpréter l’art. 13 LDA. La location contre paiement fait l’objet d’un droit à rémunération en faveur des auteurs, au contraire du prêt gratuit. En Allemagne, le prêt est aussi assujetti à un droit à rémunération (c. 6.1). La doctrine considère l’art. 13 LDA comme une exception au principe de l’épuisement ou comme un correctif à celui-ci (c. 6.2). En plus de l’interprétation grammatico-littérale, systématique, historique ou téléologique, une interprétation de droit comparé avec l’Europe est admissible, le TF ayant relevé la volonté du législateur d’harmoniser le droit d’auteur suisse avec le droit européen (c. 8). L’interprétation grammatico-littérale de l’art. 13 LDA n’exclut pas qu’il puisse y avoir une location au sens de cette disposition, si le loyer est payé forfaitairement et non pour chaque transaction (c. 8.1). L’interprétation systématique n’apporte rien sur cette question (c. 8.2). Dans le cadre des discussions parlementaires sur la LDA, l’introduction d’un droit de prêt était une question discutée, mais le législateur a finalement renoncé à un tel droit. Le Conseil fédéral est parti de l’idée que les bibliothèques procédaient à du prêt, pas à de la location, ce qui ne correspond plus à la situation actuelle. L’interprétation historique ne permet donc pas d’exclure de l’art. 13 LDA les mises à disposition contre paiement d’un forfait (c. 8.3). D’un point de vue téléologique, l’art. 13 LDA doit réaliser un équilibre équitable entre les intérêts des ayants droit, d’une part, et ceux de la communauté en général d’autre part, basés sur les libertés d’opinion et d’information de même que sur la politique culturelle et de la formation. Cet équilibre repose sur le caractère payant ou non de la mise à disposition. La loi ne considère pas que les ayants droit seraient à ce point redevables à la société qu’ils devraient renoncer à une participation lorsque leurs œuvres génèrent des revenus. Elle exonère du droit à rémunération non pas certains utilisateurs – comme les bibliothèques – mais certains actes, à savoir la mise à disposition gratuite d’exemplaires d’œuvres. Les bibliothèques sont assujetties à ce droit à rémunération dès lors qu’elles reçoivent un paiement, indépendamment de la question de savoir comment celui-ci est structuré (c. 8.4). L’interprétation de droit comparé avec le droit européen n’apporte rien vu les différences avec le droit suisse. Tout en plus peut-on constater que la différence entre le prêt et la location se fait aussi sur la base de considérations économiques (c. 8.5). Un principe fondamental du droit d’auteur est que les ayants droit doivent participer à toute exploitation économique de leurs œuvres et prestations. Le principe des recettes brutes figure à l’art. 60 al. 1 lit. a LDA, tandis que celui de la participation est ancré à l’art. 60 al. 2 LDA. Selon le principe des recettes brutes, les subventions font partie des recettes servant de base au calcul de la redevance ; et selon le principe de la participation, les auteurs doivent être intéressés au produit économique que des tiers réalisent grâce à leurs œuvres. La doctrine ne fait pas de différence entre un paiement forfaitaire et un paiement par transaction. Encore faut-il préciser que le montant versé doit être en relation avec l’intensité de l’utilisation par la bibliothèque. On ne peut pas encore parler d’une utilisation payante si la bibliothèque ne fait que demander une cotisation modeste servant à couvrir les coûts de la tenue d’une liste de ses membres et d’une publication à leur attention (c. 8.6). De même le paiement forfaitaire reçu par les bibliothèques doit être réduit pour tenir compte des prestations offertes par elles n’ayant rien à voir avec la mise à disposition d’exemplaires d’œuvres, ou pour tenir compte de la part du forfait servant à couvrir leurs simples frais d’administration. Il s’agit de la conséquence du fait que seule la mise à disposition payante est soumise à redevance selon l’art. 13 LDA. Pour des raisons de praticabilité, il convient d’opérer une déduction forfaitaire. Les sociétés de gestion n’ont pas démontré pourquoi une déduction de 10% serait suffisante et ont donc manqué à leur devoir de collaboration. Vu les difficultés à chiffrer cette déduction, la CAF estime équitable de la fixer à 50% (c. 9.1). Les frais d’inscription aux hautes écoles relèvent du droit public et ne peuvent pas être considérés comme un loyer de location, d’autant plus qu’ils donnent droit à une multitude de prestations, dont l’utilisation des bibliothèques représente une très petite partie. Egalement pour des raisons d’efficience, il ne serait pas opportun de prendre en compte, dans le cadre du tarif, une partie forcément très modique de ces écolages (c. 9.2). Cette solution n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement (c. 10). D’après la jurisprudence de la CAF, les augmentations abruptes de redevance doivent être évitées. Des augmentations importantes ont parfois été acceptées si elles étaient échelonnées dans le temps. Mais il est possible de renoncer à un tel échelonnement si les redevances antérieures étaient manifestement trop basses, si les augmentations sont dues à un changement de système tarifaire justifié objectivement ou si elles permettent une redevance plus juste. Le TAF a estimé que l’interdiction des augmentations abruptes devait être rattachée au principe de la continuité tarifaire, qui peut servir les intérêts de toutes les parties, et qu’elle ne relevait pas du contrôle de l’équité. Mais cette décision n’est pas encore entrée en force. En l’espèce, l’augmentation de redevance doit être échelonnée dans le temps (c. 13). L’approbation du nouveau tarif n’est pas contraire au principe de la confiance, car les sociétés de gestion avaient déjà signalé en 2006 que l’ancien tarif reposait sur des concessions de leur part. Les tarifs antérieurs n’étaient pas litigieux, si bien que la CAF a pu les approuver. C’est seulement depuis 2011 qu’elle doit examiner l’équité des tarifs sur lesquels les parties sont d’accord. De surcroît, la question litigieuse en l’espèce ne concerne pas l’équité du tarif (c. 14). La valeur litigieuse de la présente affaire consiste en la différence de redevances à payer par année, selon les conclusions des sociétés de gestion, d’une part, et selon les conclusions des associations d’utilisateurs d’autre part ; cette différence doit être multipliée par le nombre d’années de validité du tarif. C’est cette valeur litigieuse qui sert à fixer les frais de procédure (c. 17.1). Une indemnité de dépens n’est pas prévue en première instance (c. 17.2). [VS]
- du tarif
- de collaboration accru des parties en procédure tarifaire
- d'informer les sociétés de gestion
- conforme
- brutes
- Art. 14-18
- Art. 2
- Art. 1
-- lit. a
- Art. 8
- Art. 13
- Art. 47
-- al. 1
- Art. 51
- Art. 60
- Art. 46
-- al. 2
- Art. 16b
- Art. 16a
- Art. 63
-- al. 4bis
- Art. 13
- Art. 12
Harry Potter, préservatif, produits pornographiques, marque combinée, remise du gain, fourniture de renseignements, jugement partiel, action échelonnée, obligation de renseigner, intérêt digne de protection, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, appréciation des preuves, arbitraire, maxime des débats, participation à l’administration des preuves, droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 55 CPC, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 164 CPC ; cf. N415 (vol. 2007-2011 ; KGSZ, 17 août 2010, ZH 2008 19 ; sic ! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) ») ; N900 (TF, 7 novembre 2013, 4A_224/2013 ; sic ! 3/2014, p. 162-163, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) II ») et N902 (TF, 26 janvier 2015, 4A_552/2014).
Selon l’art. 42 al. 2 CO, le dommage qui ne peut pas être exactement établi doit être déterminé par le Juge équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Hormis dans le cas rare de la prise en compte des principes abstraits déduits de l’expérience, cette détermination équitable du dommage se base sur une appréciation de l’état de fait et relève ainsi de la détermination des faits qui n’est revue par le TF qu’en cas d’arbitraire. Il incombe au Juge dans le cadre d’un exercice correct de sa liberté d’appréciation de faire la lumière sur les critères de décision dont il envisage de tenir compte, respectivement sur ceux pour lesquels il a besoin d’informations complémentaires. La latitude donnée au Juge de considérer le dommage comme établi sur la base d’une simple estimation n’a pas pour but d’exonérer le demandeur de manière générale du fardeau de la preuve, ni non plus de lui conférer la possibilité d’élever des prétentions en dommages et intérêts de n’importe quelle hauteur sans avoir à fournir de plus amples indications. Bien au contraire, l’application de cette disposition ne le dispense pas d’alléguer, dans toute la mesure possible et exigible, toutes les circonstances qui constituent un indice de l’existence d’un dommage et en permettent la détermination. L’art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de son obligation d’étayer sa réclamation. Les circonstances alléguées doivent être de nature à justifier suffisamment l’existence d’un dommage, ainsi qu’à en rendre l’ordre de grandeur saisissable. Cela vaut aussi en cas de réclamation de la remise du gain en ce qui concerne les circonstances que la partie chargée du fardeau de la preuve souhaite invoquer concernant la réalisation d’un gain, respectivement sa diminution. Un établissement exact des faits ne doit cependant pas être exigé dans les cas où l’art. 42 al. 2 CO s’applique, dans la mesure où l’allégement du fardeau de la preuve consacré en faveur du demandeur par cette disposition comporte aussi une limitation du fardeau de l’allégation et de l’étayement des faits (« Substanziierung ») (c. 3.1). Du moment qu’en dépit de l’obligation qui découlait pour elle du jugement partiel précédent, la recourante refusait de communiquer à l’autre partie les informations nécessaires pour établir le montant du gain que cette dernière ne pouvait pas fournir, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en fixant le gain dans le cadre d’une application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO et en le déterminant en fonction de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire pour permettre de recourir à une telle application par analogie de l’art. 42 al. 2 CO de se trouver en présence d’un refus injustifié de collaborer au sens de l’art. 164 CPC (c. 3.5). Le respect du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique que le tribunal entende, examine et prenne en compte dans son processus décisionnel les éléments avancés par celui que la décision atteint dans ses droits. Le jugement doit être motivé pour que les parties puissent se faire une idée des considérants du tribunal. La motivation doit mentionner de manière succincte les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles il fonde son jugement. Il n’est par contre pas nécessaire que la décision passe en revue de manière détaillée et réfute chacun des arguments soulevés par les parties. Il suffit que le jugement soit motivé de telle sorte qu’il puisse, le cas échéant, être contesté de manière adéquate. Le fait qu’une autre solution ait pu entrer en ligne de compte ou même être préférable n’est pas déjà constitutif d’arbitraire. Tel n’est le cas que lorsque le jugement attaqué est manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, viole crassement une norme ou un principe de droit incontesté ou contrevient d’une manière choquante aux principes de la justice (c. 4.1). [NT]
- Art. 8
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 164
- Art. 59
-- al. 2 lit. a
- Art. 55
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 9
Marque verbale, marque mixte, enregistrement abusif, marque défensive, appréciation des preuves, fardeau de la preuve, preuve d’un fait négatif, preuve du défaut d’usage, nullité d’une marque; art. 8 CC, art. 12 al. 1 LPM.
La jurisprudence fédérale n’admet pas de protection pour les marques qui n’ont pas été déposées pour être utilisées, mais dans le dessein, en empêchant l’enregistrement de signes correspondants par des tiers, d’élargir le champ de protection de marques effectivement utilisées ou pour obtenir des avantages financiers ou autres de l’utilisateur antérieur. L’absence d’intention d’utiliser la marque en entraîne la nullité. L’inadmissibilité des marques enregistrées de mauvaise foi étant donné l’absence de volonté de les utiliser constitue, à côté du non-usage selon l’art. 12 al. 1 LPM, un motif propre et indépendant de perte du droit à la marque, et le titulaire d’une telle marque ne peut pas se prévaloir du délai de non-usage. La preuve de l’absence de volonté d’utiliser, outre qu’elle porte sur un fait négatif, concerne en plus un fait interne (« innere Tatsache ») qui peut à peine être prouvé de manière positive. En vertu de son obligation de collaborer à la preuve, il peut ainsi être exigé de la partie qui a enregistré la marque qu’elle documente, ou à tout le moins qu’elle allègue, les motifs qui dans le cas concret, en dépit du reproche qui lui est fait d’avoir enregistré la marque de manière abusive, seraient au contraire constitutifs d’une stratégie de marque fondée sur la bonne foi. Si ces indications ne convainquent pas le juge, la preuve abstraite d’une constellation typique d’une marque défensive suffit dans l’appréciation globale des preuves (c. 2.1). La répartition du fardeau de la preuve devient sans objet lorsque, comme dans le cas concret, le tribunal arrive à la conclusion, dans son appréciation des preuves, qu’un fait allégué est établi (c. 2.2.1). L’instance précédente a admis dans son appréciation des preuves présentées que le recourant avait enregistré la marque suisse No 624864 « WILD HEERBRUGG », ainsi d’ailleurs que la marque suisse No 567937 « WILD HEERBRUGG » qui ne fait pas l’objet du présent litige, sans l’intention de l’utiliser mais bien plutôt dans le dessein d’attaquer des marques comportant ces éléments et d’exiger de l’argent pour renoncer à la procédure. Il ne s’agit pas là d’un cas d’absence de preuve dont les circonstances devraient être revues (c. 2.2.1). Le recours est rejeté. [NT]
Pachmann, Bachmann, avocat, activité d’avocat, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, contenu sémantique, usage à titre de marque, violation du droit d’être entendu, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, arbitraire, maxime des débats, risque de confusion, droit au nom ; art. 9 Cst., art. 9 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 29 CC, art. 55 CPC, art. 150 al. 1 CPC, art. 951 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. c LCD.
La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (c. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent par possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (c. 3.2 et c. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (c. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (c. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (c. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]
- Art. 29
- Art. 8
- Art. 951
-- al. 2
- Art. 150
-- al. 1
- Art. 55
- Art. 9
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 2
- Art. 13
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.
Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]
Action, voir ég. cumul d’actions
- au nom
- notoire
-- relatifs
- sociale
-- direct
-- indirect
- dominant
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 8
- Art. 956
- Art. 951
-- al. 1
- Art. 151
- Art. 12
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 11
-- al. 2
-- al. 3
Contrat de distribution, escroquerie, concurrence déloyale, droit des marques, droit d’auteur, remise du gain, appréciation des preuves, arbitraire, allégation des parties, gestion d’affaires, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, remise du gain, atteinte combinée, concours de causes ; art. 9 Cst., art. 8 CC, art. 42 al. 2 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 70 CP, art. 62 al. 2 LDA.
Selon l’art. 423 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 62 al. 2 LDA (de même que l’art. 55 al. 2 LPM et l’art. 9 al. 3 LCD), lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (c. 3.1). Cette disposition vise l’hypothèse de la gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi, le gérant intervenant illicitement dans les affaires du maître en agissant non pas dans l’intérêt de ce dernier mais dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. L’art. 423 CO a pour but essentiel d’éviter que le gérant, auteur de l’ingérence, ne profite de celle-ci et qu’il en conserve les profits. La remise du gain remplit ainsi aujourd’hui également une fonction préventive (ou punitive) et plus seulement une fonction de rééquilibrage. Pour que la règle de l’art. 423 CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées : 1) une atteinte illicite aux droits d’autrui, l’intervention du gérant ayant lieu sans cause et ne reposant ni sur un contrat, ni sur la loi. En matière de droit d’auteur, toute utilisation non autorisée des droits appartenant à des tiers est considérée comme une intervention illicite ; 2) le gérant intervenant sans droit dans les affaires d’autrui doit avoir la volonté de gérer celle-ci exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt ; 3) la mauvaise foi du gérant est nécessaire qui est donnée s’il sait ou doit savoir qu’il s’immisce dans la sphère d’autrui sans avoir de motif pour le faire (c. 3.1.1). Si ces conditions sont remplies, le gérant est tenu de restituer au maître le profit (illégitime) qu’il a réalisé, soit tout avantage pécuniaire résultant de l’ingérence qui réside dans la différence entre le patrimoine effectif de l’auteur de la violation et la valeur qu’aurait ce patrimoine en l’absence de toute violation. Le profit doit être en lien de causalité avec l’atteinte illicite incriminée. Il incombe au maître de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’atteinte illicite à ses biens juridiques et les profits nets réalisés par le gérant. A cet égard, une vraisemblance prépondérante suffit (c. 3.1.2). On est en présence d’une « atteinte combinée » ou d’un « concours de causes » lorsque le profit réalisé par le gérant résulte aussi bien de l’atteinte aux biens juridiquement protégés d’un tiers (le maître) que de l’activité licite menée par le gérant lui-même (know-how, qualité de ses services, recours à une campagne de marketing particulièrement réussie, réseau de distribution performant, etc.). La restitution (au maître) ne peut alors porter que sur la partie du profit qui découle de l’atteinte, par le gérant, aux biens juridiquement protégés du maître. Ce concours de causes a été envisagé par le législateur puisque celui-ci a explicitement exprimé sa volonté de laisser le Juge apprécier librement (parmi les divers facteurs ayant permis au gérant de réaliser un gain) la mesure dans laquelle celui-ci résulte de l’atteinte illicite aux biens du maître. Lorsque le gérant ayant porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du maître a également commis une infraction pénale (in casu : une escroquerie) au détriment d’une tierce personne, la part du profit qui en découle (soit le produit de l’infraction) ne devra pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement au dépens du consommateur (lésé), donne naissance à un (nouveau) fondement juridique (distinct de celui à l’origine de la remise de gain) permettant exclusivement à ce lésé de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause (c. 3.1.3). Dans la mesure où la restitution porte sur l’enrichissement net du gérant, le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés. Une évaluation par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO n’est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au Juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de faits qui constituent des indices de l’existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indication plus précise, des prétentions en remise de gain de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le Juge doit refuser la réparation (c. 3.1.4). In casu, en amenant par une construction astucieuse, ses clients à lui payer des montants surfacturés, le défendeur a en réalité adopté un comportement constitutif d’escroquerie. Celui-ci lui a permis de s’enrichir illégitimement au dépens des clients lésés, donnant ainsi naissance à un (nouveau) fondement juridique (distinct de celui applicable pour la remise du gain). L’enrichissement du défendeur découle de la mise en scène, constitutive d’une infraction pénale, que celui-ci a élaborée au préjudice de ses clients. Lésés par les agissements du défendeur, ce sont ses clients qui, sur le plan civil, sont légitimés à demander la restitution de l’indu au défendeur qui s’est enrichi illégitimement (art. 62ss CO ; cf. éventuellement aussi l’art. 70 CP sur la confiscation de valeurs patrimoniales). La défenderesse ne saurait dès lors prétendre au paiement d’un montant dont un tiers (le client lésé) est le seul créancier et qui repose sur un fondement différent de celui qui sous-tend l’art. 423 CO (c. 3.2.1). Le recours est rejeté. [NT]
- Art. 8
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 423
- Art. 62
- Art. 70
- Art. 9
- Art. 62
Aviation, combustibles, carburant, Avia, raison sociale, risque de confusion, nom de domaine, swissaviaconsult.ch, péremption, principe de la spécialité, signe fantaisiste, force distinctive, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 951 CO.
Les actions défensives en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflits entre raisons de commerce. Selon l’art. 2 al. 2 CC en effet, un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. L’abus de droit réside dans le fait que l’ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l’inaction prolongée suscite l’apparence d’une tolérance, que contredit l’action en justice intentée des années plus tard. La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 3.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l’art. 2 al. 2 CC qui suppose une certaine élasticité. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant en règle générale entre 4 et 8 ans (c. 3.2). S’agissant de la position digne de protection, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages sérieux qui résulteraient pour l’auteur de la violation de l’abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard. Le préjudice économique que subirait l’auteur de la violation s’il devait cesser l’utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux. L’existence d’un chiffre d’affaires important n’est toutefois en soi pas suffisant, mais l’auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d’affaires et l’utilisation du signe litigieux. Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif : ce sera le cas lorsque l’utilisation du signe litigieux a, pour l’auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (c. 3.3). Depuis sa constitution, la défenderesse a développé ses activités dans le domaine de l’aviation et elle a noué des collaborations fructueuses avec des partenaires, soit environ 20 magasins de réparation et des fournisseurs de pièces détachées pour les avions. C’est grâce aux deux associés de la société défenderesse qui ont su profiter de leurs relations personnelles que celle-ci a acquis une position sur le marché. Il n’est pas établi qu’un changement de raison sociale, et en particulier l’abandon de l’élément « Avia » entraînerait de sérieux inconvénients pour la défenderesse puisque dans le domaine hautement spécialisé de l’aéronautique, les contrats se concluent en fonction des compétences personnelles des gérants ou des employés et que le nom de la société est secondaire (c. 3.4). Ainsi, si la passivité des demanderesses pendant 5 ans et demi (depuis l’inscription au registre du commerce) pourrait remplir la première condition de la péremption, la seconde condition (position digne de protection) n’est elle pas remplie (c. 3.5). En vertu de l’art. 951 CO, la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (c. 4.2). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d’une entreprise (l’auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l’ayant droit) – confusion dite directe – ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées mais qu’elles donnent l’impression erronée qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées – confusion dite indirecte –. Le principe de la spécialité qui prévaut en droit des marques ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Le champ de protection de la raison de commerce peut ainsi également couvrir les signes utilisés par d’autres entreprises qui offrent d’autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence. Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 4.2.1). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public concerné, celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises sont actives. Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale. Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d’un risque de confusion. Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mette particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante (vu les grandes possibilités de choix qui sont à disposition), à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d’un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s’être imposé par l’usage du signe dans le commerce (c. 4.2.2). L’examen d’un éventuel besoin absolu de libre disposition n’a de sens qu’en présence d’une désignation générique susceptible d’acquérir une force distinctive suite à un usage intensif (imposition dans le commerce). Or, le signe litigieux « Avia » revêt un caractère fantaisiste (donc une force distinctive) ce qui exclut toute discussion quant à un éventuel besoin absolu de libre disposition (c. 4.4.4). Le risque de confusion est une question de droit et il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves visant à établir d’éventuelles confusions effectives (réelles) (c. 4.4.6). Le signe « Avia » est doté d’une force distinctive originaire et il existe un risque de confusion entre les raisons sociales des parties (c. 4.4.7). Le nom « Avia » est notoire auprès du public suisse et l’utilisation de ce terme dans les raisons sociales fondent un risque de confusion indirecte très marqué (c. 5.1.2). Si, d’un point de vue technique, le nom de domaine n’est qu’un instrument qui a pour fonction d’identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l’usager d’Internet il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l’exploite, la chose ou les prestations qui s’y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire aux tiers non autorisés l’usage de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable possible. Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d’un titulaire et le nom de domaine d’une autre personne, il faut tenir compte de l’adresse Internet qui permet d’accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C’est uniquement cette adresse qui éveille l’intérêt du public et lui donne l’espoir d’obtenir des informations conformes à l’association d’idées évoquées par le nom de domaine. Partant, il n’importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (c. 6.1). In casu, dans le nom de domaine « swissaviaconsult.ch », la signification des mots « swiss » et « consult » étant évidente, le public concerné reconnaît sans aucune difficulté le mot « avia » entre les deux signes. Les considérations faites sur le risque de confusion existant entre les raisons de commerce peuvent sans autre être reprises en rapport avec le nom de domaine (c. 6.2). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu sans contester le fond de la décision n’a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (c. 7.1). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]
- sociale
HG AG, 29 novembre 2019, HOR.2018.49/ts/ts (d)
« Tarifs communs 8 et 9 » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance, fardeau de l’allégation, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 19 al. 1 lit. c LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA.
La notion d’entreprise utilisée à l’art. 19 al. 1 lit. c LDA doit être comprise largement. Elle concerne tout le monde du travail, qu’il soit public ou privé, des personnes indépendantes aux multinationales en passant par la fonction publique, les associations ou les organisations de défense d’intérêts (c. 3.2). La répartition du fardeau de l’allégation entre les parties suit celle du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. Celui qui prétend à un droit ou à un rapport juridique doit donc alléguer les faits pertinents (c. 4.1). Pour la reproduction d’œuvres en entreprise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, une rémunération doit être payée selon l’art. 20 al. 2 LDA. D’après la jurisprudence du TF, celle-ci est due déjà de par la possibilité de reproduire des œuvres, c’est-à-dire de par la possession d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne. A l’inverse, celui qui ne dispose pas de tels appareils ne doit aucune redevance. L’art. 51 al. 1 LDA, de même que le chiffre 8.4 des tarifs communs 8 et 9, consacre un devoir d’information des utilisateurs vis-à-vis des sociétés de gestion. Le chiffre 8.2 de ces tarifs dispose que les informations doivent être fournies au moyen d’un formulaire à retourner dans les 30 jours. Si cela n’est pas fait même après un rappel écrit et un délai supplémentaire, ProLitteris peut estimer les données nécessaires et procéder à la facturation sur cette base. Si l’utilisateur ne communique toujours pas les informations nécessaires, par écrit, dans les 30 jours suivant l’estimation, celle-ci est alors considérée comme reconnue (c. 5.4.3). Les tarifs des sociétés de gestion sont normalement contraignants pour les tribunaux. Cela sert la sécurité juridique et évite qu’un tarif approuvé par la CAF, le cas échéant par le TF, soit remis en question dans une action en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Le juge civil ne peut donc pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité. Cependant, cela ne signifie pas que les sociétés de gestion pourraient se fonder sur un tarif approuvé pour faire valoir devant les tribunaux civils des droits à rémunération contraires à des dispositions légales impératives. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif découlant de la loi (c. 5.4.2). L’allégation implicite de la demanderesse selon laquelle la défenderesse disposerait d’un photocopieur et d’un réseau informatique interne a été contestée. Elle n’est ni motivée, ni prouvée, quand bien même la demanderesse supporte le fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. A défaut d’appareil de reproduction ou de réseau interne, la défenderesse ne doit pas de redevance. Comme elle ne tombe pas dans le champ d’application des art. 19 al. 1 lit. c et 20 al. 2 LDA, la reconnaissance de l’estimation, telle que prévue par le tarif, demeure sans effet. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif de la loi. Ainsi, la demanderesse ne peut faire valoir aucune prétention contre la défenderesse (c. 5.5). [VS]
- Art. 8
- Art. 59
-- al. 3
- Art. 51
-- al. 1
- Art. 20
-- al. 2
- Art. 19
-- al. 1 lit. c
HG AG, 29 novembre 2019, HOR.2018.52/ts/ts (d)
« Tarifs communs 8 et 9 » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 8 CC, art. 19 al. 1 lit. c LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA.
La notion d’entreprise utilisée à l’art. 19 al. 1 lit. c LDA doit être comprise largement. La personnalité juridique ou un établissement stable ne sont pas nécessaires. Cette notion concerne tout le monde du travail, qu’il soit public ou privé, des personnes indépendantes aux multinationales en passant par la fonction publique, les associations ou les organisations de défense d’intérêts (c. 2.2). L’allégation implicite de la demanderesse selon laquelle la défenderesse disposerait d’un réseau informatique interne a été contestée. Elle n’est ni motivée, ni prouvée, quand bien même la demanderesse supporte le fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. A défaut d’un tel réseau, la défenderesse ne doit pas de redevance. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif de la loi (c. 3.3.5). [VS]
- Art. 8
- Art. 59
-- al. 3
- Art. 51
-- al. 1
- Art. 20
-- al. 2
- Art. 19
-- al. 1 lit. c
TF, 17 avril 2020, 4A_39/2020 et 4A_41/2020 (d)
« Tarifs communs 8 et 9 » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 105 LTF ; art. 8 CC, art. 19 al. 1 lit. c LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 20 al. 4 LDA, art. 46 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF (c. 1.1). Le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et les considérants de la décision de première instance, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées, sauf en cas de lacunes juridiques manifestes. En particulier, il n’est pas tenu d’examiner des points qui ne sont plus litigieux devant lui (c. 1.2). Il est en principe lié par l’état de fait, aussi en ce qui concerne le déroulement de la procédure de première instance, sauf s’il est manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit. « Manifestement inexact » est synonyme d’arbitraire. De plus, la correction des lacunes doit pouvoir influencer l’issue de la procédure. La partie qui s’en prend à des constatations de fait doit démontrer clairement et de manière motivée que ces conditions sont réalisées et, si elle entend compléter les faits, elle doit montrer, en se référant précisément au dossier, qu’elle a allégué et prouvé le fait pertinent manquant devant l’instance précédente, conformément aux règles de la procédure (c. 1.3). La reproduction d’exemplaires d’œuvres dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA. Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (c. 2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation (c. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne représente une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à des règles légales impératives. Les dispositions tarifaires y relatives tiennent compte de manière admissible des difficultés pratiques causées par les utilisations massives d’œuvres protégées. Elles ne créent pas un droit à rémunération incompatible avec les normes impératives de la loi (c. 2.2.3). [VS]
- Art. 8
- Art. 55
- Art. 59
-- al. 3
- Art. 51
-- al. 1
- Art. 46
- Art. 20
-- al. 4
-- al. 2
- Art. 19
-- al. 1 lit. c
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 105
- Art. 74
-- al. 2 lit. b
sic! 12/2012, p. 811-813, « Lego IV (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, forme géométrique simple, Lego, forme techniquement nécessaire, coûts de fabrication, signe alternatif, expertise, fardeau de la preuve, droit d’être entendu, compatibilité, secret de fabrication ou d’affaires ; art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM.
Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d'un examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme tridimensionnelle, au sens de l'art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d'une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu'il soit vérifié s'il existait des formes alternatives (tant compatibles qu'incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s'éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d'outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l'étaient pas (29 à 54 %). L'expertise avait permis de poser qu'au vu de la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu'à 50 % pour celles qui ne l'étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d'une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s'accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l'art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (c. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu'elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu'elles s'accompagnent de coûts de production plus élevés (c. 3.1). Comme le monopole lié à l'obtention d'une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s'accompagnent d'aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l'égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (c. 3.2). Lorsqu'elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d'affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l'expert chargé de la réalisation d'une expertise dans le cadre de l'administration des preuves, ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu si les indications qu'elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l'administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (c. 4.3.2). [NT]
Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.
Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]
- Art. 27
-- al. 2
- Art. 28
-- al. 2
- Art. 2
- Art. 12
-- al. 3
- Art. 11
-- al. 2
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 2
CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)
sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.
Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).
sic! 3/2013, p. 158-161, « Coop-Naturaplan- Bio-Huhn » ; medialex, 1/2013, p. 48 (rés.) ; propos mensongers, propos attentatoires, risque de récidive, droit de la personnalité, atteinte à la personnalité, action en constatation de l’illicéité de l’atteinte, caractère mensonger ; art. 28 CC, art. 28a al. 1 ch. 3 CC.
L'action en constatation de l'illicéité d'une atteinte est recevable dès que le demandeur établit l'existence d'un trouble persistant. Il en va de même lorsque l'atteinte à la personnalité survient de manière isolée entre deux parties ou dans un cercle restreint de personnes. L'intérêt à la constatation de l'atteinte sera jugé selon les mêmes principes que ceux posés par la jurisprudence du TF lorsque le trouble est causé par des publications dans les médias de masse (c. 2.2-2.3). Le TF considère que c'est le comportement de l'auteur qui permet de prévoir si le trouble est susceptible de se répéter de manière identique ou similaire. Le fait que les parties soient dans un rapport de concurrence et participent à des débats politiques de manière régulière et durable laisse envisager la survenance de propos semblables à l'avenir (c. 2.4.3). Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir du juge qu'il constate le caractère illicite de l'attente si le trouble qu'elle a créé subsiste. L'action en constatation porte sur l'illicéité de l'allégation et non pas sur son caractère mensonger. Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de faire cesser l'atteinte autrement que par la constatation de la véracité ou du caractère mensonger de propos offensants, l'action peut exceptionnellement avoir un tel objet. [LG]
sic! 5/2013, p. 293-295, « Blogs » ; medialex 2/2013, p. 78-80 (Fanti Sébastien,Remarques) ; droit de la personnalité, blog, action défensive, action en dommages-intérêts, remise du gain, qualité pour défendre, responsabilité de l’hébergeur, hébergeur ; art. 28 CC, art. 28a CC.
La question de la qualité pour défendre se détermine selon le droit au fond. La Suisse n’a pas adopté de législation particulière concernant la responsabilité civile ou pénale des hébergeurs de blogs, quand bien même la question est étudiée dans le cadre du postulat 11.3912 « Donnons un cadre juridique aux médias sociaux », adopté par le Conseil national le 23 décembre 2011. Actuellement, les art. 28 ss CC sont donc applicables (c. 6.1). D’après l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. En matière d’actions défensives, cette formulation vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise cette atteinte, sans qu’une faute soit nécessaire. En d’autres termes, peut être concerné celui qui, sans être l’auteur des propos litigieux ou en connaître le contenu ou l’auteur, contribue à leur transmission (c. 6.2). En l’espèce, l’atteinte à la personnalité résulte de la publication sur Internet d’un billet rédigé par un tiers, auquel la recourante a fourni un espace ayant permis la diffusion de ce billet. Si la recourante n’est donc pas l’auteur de l’atteinte, elle y a participé au sens de l’art. 28 al. 1 CC et a donc la légitimation passive. Le fait qu’elle n’ait pas la maîtrise des propos rapportés, ou qu’elle ne puisse pas contrôler tous les blogs qu’elle héberge, n’est pas pertinent. Ces éléments ressortissent en effet à la question de la faute, laquelle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une action défensive. Reconnaître la légitimation passive de l’hébergeur pour une telle action n’implique pas automatiquement que les fournisseurs d’accès se verront désormais actionnés en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. En effet, si le lésé peut aussi choisir contre qui il veut intenter une action réparatrice, son choix est limité par le fait qu’il ne peut s’adresser qu’à ceux dont il parvient à prouver la faute. Enfin, il n’appartient pas à la justice mais au législateur de réparer les prétendues « graves conséquences » pour Internet et les hébergeurs que pourrait avoir l’application du droit actuel (c. 6.3). [VS]
ATF 140 III 251 ; sic! 9/2014, p. 532-538,
« Croix rouge II » ; JdT 2015 II 203 ; marque combinée, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, services médicaux, service de permanence
médico-chirurgicale, permanence médico-chirurgicale SA, Croix-Rouge, noms
et emblèmes internationaux, revendication de couleur, action en constatation
de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, risque de confusion direct, risque
de confusion indirect, valeur litigieuse, force distinctive forte ; art. 28 CC, art. 29
CC, art. 2 lit. d LPM, art. 52 LPM, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 91 CPC.
L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (c. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (c. 5.1). La Croix-Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (c. 5.2). Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments - par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (c. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le Juge civil (c. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (c. 5.3.3). Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (c. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif ) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (c. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom(ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (c. 6.4). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (c. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300 000.-), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (c. 7). [NT]
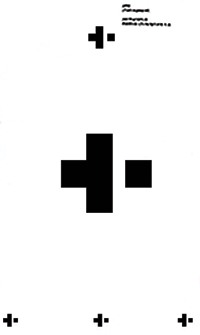
Action, voir ég. cumul d’actions
-- forte
- combinée
-- absolus
Noms et emblèmes internationaux
Permanence médico-chirurgicale SA
-- direct
-- indirect
- de permanence médico-chirurgicale
- médicaux
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 91
- Art. 7
-- al. 2
- Art. 52
- Art. 2
-- lit. d
HG BE, 16 août 2017, HG 15 100 (d)
« Blocage de sites internet illicites » ; action en cessation, blocage de sites internet, fournisseur d’accès, intérêt digne de protection, novae, droit d’auteur, précision des conclusions, qualité pour agir, qualité pour défendre, usage privé, piraterie ; art. 28 CC, art. 50 CO, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 1 LDA, art. 62 al. 3 LDA, art. 59 al. 2 lit. a CPC, art. 229 CPC.
La demanderesse conclut à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse, un fournisseur d’accès à Internet, de prendre des mesures techniques appropriées empêchant ses clients d’accéder à divers sites, lesquels fournissent des liens vers d’autres sites qui mettent à disposition des films de manière illicite (c. 1 à 13). Elle a un intérêt digne de protection à la demande, au sens de l’art. 59 al. 2 lit. a CPC, même si les mesures de blocage pourraient être contournées et même si les films litigieux resteraient disponibles sur d’autres sites (c. 17.3). Il est douteux que les conclusions soient suffisamment précises, car la demanderesse mentionne trois mesures de blocage sans expliquer laquelle lui donnerait satisfaction. De plus, si les conclusions étaient reprises telles quelles dans le dispositif, la défenderesse ne saurait pas comment s’exécuter (c. 18.5). Des novas – aussi bien proprement dits qu’improprement dits – ne sont plus admissibles après la clôture des débats principaux, lorsque le jugement est en délibération (c. 22.3.4). Le droit suisse est applicable en l’espèce, puisque la demanderesse et la défenderesse ont leurs sièges et leurs activités en Suisse, cela même si les sites internet litigieux sont étrangers (c. 23). La demanderesse dispose de la légitimation active, car il y a suffisamment d’éléments pour admettre qu’elle est licenciée exclusive au sens de l’art 62 al. 3 LDA (c. 25.7.7). Lorsque l’auteur principal d’une violation du droit d’auteur agit grâce aux services d’un tiers, il se pose la question de la participation de ce dernier à l’acte illicite et de sa légitimation passive (c. 26.2). Cette question se résout d’après l’art. 50 al. 1 CO, et non d’après l’art. 28 CC. En effet, les droits d’utilisation selon la LDA ont essentiellement une nature patrimoniale, tandis que le droit de la personnalité a une signification psychologique et spirituelle. Les deux domaines ne sont donc pas comparables. De surcroît, une application de l’art. 50 al. 1 CO n’empêche pas une approche unitaire de la légitimation passive dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (c. 26.3.4). Pour qu’il y ait une participation au sens de l’art. 50 al. 1 CO, il doit y avoir une violation du droit d’auteur par un tiers et une contribution juridiquement pertinente de la part du participant. De plus, la doctrine exige parfois la réalisation de certains éléments subjectifs concernant la conscience de participer à un acte illicite avec un tiers (c. 28). D’après le Conseil fédéral, les « déclarations communes » concernant le WCT excluent seulement que la fourniture d'installations techniques constitue un acte principal de communication au public au sens de l’art. 8 WCT ; elles n’empêchent pas la responsabilité en tant que participant secondaire (c. 29.1 et c. 29.2). Les conclusions de la demanderesse sont orientées vers le comportement des clients de la défenderesse, à savoir des internautes. Elles ne visent pas directement les personnes qui mettent les films à disposition sur Internet (c. 32.1.1). Or, les actes des internautes sont couverts par l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA et ne sont pas illicites. La première condition à laquelle la défenderesse pourrait se voir reprocher une participation au sens de l’art. 50 al. 1 CO n’est donc pas réalisée (c. 32.1.2 et c. 32.1.3). Au surplus, la défenderesse fournit un accès (automatique) à Internet. Elle intervient « en fin de chaîne » dans le processus de communication des œuvres et n’est pas très proche des actes illicites d’origine (c. 32.2.2). Sa prestation n’est pas apte à favoriser les infractions d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. Elle n’est donc pas dans un rapport de causalité adéquate avec les actes illicites et n’apporte aucune contribution juridiquement pertinente à ceux-ci (c. 32.2.3). La défenderesse n’est ainsi pas légitimée passivement, si bien que la question de savoir si des éléments subjectifs sont nécessaires peut être laissée ouverte (c. 32.4). Même si la défenderesse disposait de la légitimation passive, les mesures de blocage demandées devraient satisfaire au principe de la proportionnalité, ce qui signifie qu’elles devraient être appropriées pour atteindre le but visé, qu’elles ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire et qu’elles devraient être raisonnables compte tenu du rapport entre la fin et les moyens (c. 34). La première condition serait remplie, même si une partie des utilisateurs pouvaient contourner les mesures de blocage et même si les films continuaient à être disponibles sur d’autres sites internet (c. 34.1.3). En revanche, il serait douteux que la deuxième condition soit réalisée, car la demanderesse a investi de grands moyens pour agir contre la défenderesse, alors qu’elle s’est contentée de mesures limitées à l’encontre des auteurs principaux des violations (c. 34.2.3). La réalisation de la troisième condition serait également discutable car les blocages concerneraient aussi des films non visés par la demande, car l’accès à du contenu licite pourrait être bloqué collatéralement (« overblocking ») et car ces blocages pourraient avoir des effets techniques indésirables (c. 34.3.1). Le caractère raisonnable des mesures demandées serait douteux, car il faudrait au moins veiller à réduire au minimum le risque d’atteindre des tiers non concernés par le litige (c. 34.3.5). Enfin, le projet de révision de la LDA du 22 novembre 2017 prévoit divers nouveaux moyens de lutte contre le piratage, mais il a renoncé à instaurer des mesures de blocage à charge des fournisseurs d’accès (c. 36). La demande doit donc être rejetée. [VS]
- Art. 28
- Art. 50
- Art. 59
-- al. 2 lit. a
- Art. 229
- Art. 19
-- al. 1 lit. a
- Art. 62
-- al. 3
-- al. 1
« Blocage de sites internet illicites » ; action en cessation, blocage de sites internet, fournisseur d’accès, responsabilité du fournisseur d’accès, solidarité, acte illicite, acte de participation, causalité adéquate, intérêt digne de protection, droit d’auteur, précision des conclusions, usage privé, piraterie ; art. 8 WCT, art. 42 al. 2 LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 4 CC, art. 28 CC, art. 50 CO, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 24a LDA, art. 62 al. 1 LDA, art. 62 al. 3 LDA, art. 110 LDIP.
La recourante a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision. Son recours en matière civile est donc recevable, sous réserve qu’il soit suffisamment motivé (c. 1.1). Le droit d’auteur ne connait pas de disposition comme l’art. 66 lit. d LBI ou l’art. 9 al. 1 LDes qui traiterait des actes de participation. L’art. 50 CO ne règle pas seulement la responsabilité solidaire pour la réparation d’un dommage, mais il constitue la base légale de la responsabilité civile des participants. Cette disposition peut être invoquée non seulement en cas d’action réparatoire, mais aussi en cas d’action en cessation. Les normes particulières du droit de la personnalité – art. 28 al. 1 CC – ou des droits réels ne sont pas applicables en droit d’auteur. Comme l’action en dommages-intérêts, l’action en cessation suppose une violation du droit d’auteur et un rapport de causalité adéquate entre la contribution du participant attaqué et cette violation (c. 2.2.1). Les clients de l’intimée, auxquels celle-ci confère l’accès à Internet, n’accomplissent aucune violation du droit d’auteur en consommant des films : l’exception d’usage privé est applicable, même si ces films ont été mis à disposition illicitement. Il ne peut donc pas y avoir de responsabilité de l’intimée pour un acte de participation (c.2.2.2). La protection de la LDA s’étend aussi aux actes commis à l’étranger mais produisant leurs effets en Suisse (c. 2.2.3). La question est de savoir si l’intimée, qui fournit l’accès à Internet, répond selon l’art. 50 al. 1 CO pour une participation à la mise à disposition illicite des films. Le rapport de causalité adéquate doit être apprécié dans chaque cas particulier selon les règles du droit et de l’équité au sens de l’art. 4 CC. Il implique donc un jugement de valeur. Pour qu’une participation soit adéquate, il faut un rapport suffisamment étroit avec l’acte illicite (c. 2.3.1). La prestation de l’intimée se limite à fournir un accès automatisé à Internet. Elle n’offre pas à ses clients des contenus déterminés. Les copies temporaires qu’implique son activité sont licites d’après l’art. 24a LDA. La déclaration commune concernant l’art. 8 WCT exclut que la fourniture d'installations techniques constitue un acte principal de communication au public ; elle n’empêche toutefois pas une responsabilité pour participation secondaire. En l’espèce, les auteurs principaux des violations ne sont pas clients de l’intimée et n’ont aucune relation avec elle. L’acte de mise à disposition est accompli déjà lorsque les films sont placés sur Internet de sorte à pouvoir être appelés aussi depuis la Suisse. L’intimée ne contribue pas concrètement à cet acte. Admettre le contraire sur la base de l’art. 50 al. 1 CO conduirait à retenir une responsabilité de tous les fournisseurs d’accès en Suisse, pour toutes les violations du droit d’auteur commises sur le réseau mondial. Une telle responsabilité « systémique », impliquant des devoirs de contrôle et d’abstention sous la forme de mesures techniques de blocage d’accès, serait incompatible avec les principes de la responsabilité pour acte de participation. Il n’y a donc aucun rapport de causalité adéquat avec les violations, justifiant une action en cessation. Une implication des fournisseurs d’accès dans la lutte contre le piratage nécessiterait une intervention du législateur (c. 2.3.2). [VS]
Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.
Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]
- Art. 27
-- al. 2
- Art. 28
-- al. 2
- Art. 2
- Art. 12
-- al. 3
- Art. 11
-- al. 2
-- al. 2
- Art. 75
-- al. 2
sic! 5/2013, p. 293-295, « Blogs » ; medialex 2/2013, p. 78-80 (Fanti Sébastien,Remarques) ; droit de la personnalité, blog, action défensive, action en dommages-intérêts, remise du gain, qualité pour défendre, responsabilité de l’hébergeur, hébergeur ; art. 28 CC, art. 28a CC.
La question de la qualité pour défendre se détermine selon le droit au fond. La Suisse n’a pas adopté de législation particulière concernant la responsabilité civile ou pénale des hébergeurs de blogs, quand bien même la question est étudiée dans le cadre du postulat 11.3912 « Donnons un cadre juridique aux médias sociaux », adopté par le Conseil national le 23 décembre 2011. Actuellement, les art. 28 ss CC sont donc applicables (c. 6.1). D’après l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. En matière d’actions défensives, cette formulation vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise cette atteinte, sans qu’une faute soit nécessaire. En d’autres termes, peut être concerné celui qui, sans être l’auteur des propos litigieux ou en connaître le contenu ou l’auteur, contribue à leur transmission (c. 6.2). En l’espèce, l’atteinte à la personnalité résulte de la publication sur Internet d’un billet rédigé par un tiers, auquel la recourante a fourni un espace ayant permis la diffusion de ce billet. Si la recourante n’est donc pas l’auteur de l’atteinte, elle y a participé au sens de l’art. 28 al. 1 CC et a donc la légitimation passive. Le fait qu’elle n’ait pas la maîtrise des propos rapportés, ou qu’elle ne puisse pas contrôler tous les blogs qu’elle héberge, n’est pas pertinent. Ces éléments ressortissent en effet à la question de la faute, laquelle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une action défensive. Reconnaître la légitimation passive de l’hébergeur pour une telle action n’implique pas automatiquement que les fournisseurs d’accès se verront désormais actionnés en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. En effet, si le lésé peut aussi choisir contre qui il veut intenter une action réparatrice, son choix est limité par le fait qu’il ne peut s’adresser qu’à ceux dont il parvient à prouver la faute. Enfin, il n’appartient pas à la justice mais au législateur de réparer les prétendues « graves conséquences » pour Internet et les hébergeurs que pourrait avoir l’application du droit actuel (c. 6.3). [VS]
sic! 3/2013, p. 158-161, « Coop-Naturaplan- Bio-Huhn » ; medialex, 1/2013, p. 48 (rés.) ; propos mensongers, propos attentatoires, risque de récidive, droit de la personnalité, atteinte à la personnalité, action en constatation de l’illicéité de l’atteinte, caractère mensonger ; art. 28 CC, art. 28a al. 1 ch. 3 CC.
L'action en constatation de l'illicéité d'une atteinte est recevable dès que le demandeur établit l'existence d'un trouble persistant. Il en va de même lorsque l'atteinte à la personnalité survient de manière isolée entre deux parties ou dans un cercle restreint de personnes. L'intérêt à la constatation de l'atteinte sera jugé selon les mêmes principes que ceux posés par la jurisprudence du TF lorsque le trouble est causé par des publications dans les médias de masse (c. 2.2-2.3). Le TF considère que c'est le comportement de l'auteur qui permet de prévoir si le trouble est susceptible de se répéter de manière identique ou similaire. Le fait que les parties soient dans un rapport de concurrence et participent à des débats politiques de manière régulière et durable laisse envisager la survenance de propos semblables à l'avenir (c. 2.4.3). Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir du juge qu'il constate le caractère illicite de l'attente si le trouble qu'elle a créé subsiste. L'action en constatation porte sur l'illicéité de l'allégation et non pas sur son caractère mensonger. Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de faire cesser l'atteinte autrement que par la constatation de la véracité ou du caractère mensonger de propos offensants, l'action peut exceptionnellement avoir un tel objet. [LG]
KG GR, 24 septembre 2007, PZ 07 156 (d) (mes. prov.)
sic! 4/2008, p. 287-288, « Software Razzia » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, programme d’ordinateur, piraterie, dommage, preuve ; art. 28c CC, art. 28d CC, art. 2 al. 2 LDA, art. 10 al. 3 LDA, art. 65 LDA.
Admission de mesures superprovisoires urgentes, sans audition préalable, en cas de piraterie de logiciels supposée et vraisemblable, en dépit de l'absence d'une urgence temporelle, mais au vu de l'effet de surprise nécessaire pour la conservation de preuves que la désinstallation rapide des logiciels piratés et quelques manœuvres techniques supplémentaires seraient susceptibles de détruire à jamais. Ce d'autant que l'ordonnance de mesures superprovisoires urgentes n'est pas de nature à causer à la personne contestant ces mesures des dommages qu'elle ne subirait pas si elle avait été entendue au préalable.
- d'auteur
TC JU, 27 juillet 2009, CC 57/2009 (f) (mes. prov.)
sic! 4/2010, p. 279-284, « Willemin » ; mesures provisionnelles, signe distinctif, marque, raison sociale, nom de personne, Willemin, droit au nom, risque de confusion, préjudice irréparable, urgence, proportionnalité ; art. 28c CC, art. 29 CC.
Dès lors qu'un risque de confusion en matière de signes distinctifs est généralement propre à engendrer une perturbation de marché ainsi que d'autres dommages immatériels, la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (c. 3). En cas de conflit entre une marque et une raison sociale incluant un patronyme, le principe du droit au nom n'est pas prééminent, mais une pesée doit être effectuée entre les intérêts en présence (c. 4). L'urgence relative que requiert l'octroi de mesures provisionnelles n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin (c. 6.1). En vertu de l'exigence de proportionnalité à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles, seule l'utilisation de l'élément distinctif à l'origine du risque de confusion doit être interdite et non pas purement et simplement l'usage de la raison sociale contenant cet élément (c. 6.2).
KG GR, 24 septembre 2007, PZ 07 156 (d) (mes. prov.)
sic! 4/2008, p. 287-288, « Software Razzia » ; mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, programme d’ordinateur, piraterie, dommage, preuve ; art. 28c CC, art. 28d CC, art. 2 al. 2 LDA, art. 10 al. 3 LDA, art. 65 LDA.
Admission de mesures superprovisoires urgentes, sans audition préalable, en cas de piraterie de logiciels supposée et vraisemblable, en dépit de l'absence d'une urgence temporelle, mais au vu de l'effet de surprise nécessaire pour la conservation de preuves que la désinstallation rapide des logiciels piratés et quelques manœuvres techniques supplémentaires seraient susceptibles de détruire à jamais. Ce d'autant que l'ordonnance de mesures superprovisoires urgentes n'est pas de nature à causer à la personne contestant ces mesures des dommages qu'elle ne subirait pas si elle avait été entendue au préalable.
- d'auteur
KG FR, 2 novembre 2009, 102 2009-113 (d) (mes. prov.)
sic! 10/2010, p. 726-730, « Thermodiffusion » ; mesures provisionnelles, action en cessation, violation d’un brevet, qualité pour agir, urgence, préjudice irréparable, solvabilité, dommage, clientèle, sûretés, capital-actions, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 28d CC, art. 72 LBI, art. 9 LCD, art. 14 LCD ; cf. N 527 (arrêt du TF dans cette affaire).
Dans une action en cessation de l'acte (art. 72 LBI), la forme de la violation du brevet doit être décrite par des caractéristiques précises afin qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter des notions juridiques ou techniques ambiguës (c. 4.b). Celui qui prétend être titulaire d'un droit propre a toujours qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, à la différence de celui qui, ouvertement et sans y être autorisé, fait valoir en son propre nom le droit d'un tiers (c. 4.c). Il y a toujours urgence au sens de l'art. 28d CC (applicable en vertu de l'art. 14 LCD) lorsqu'une procédure ordinaire (y compris les voies de recours possibles) durerait clairement plus longtemps qu'une procédure de mesures provisoires (c. 4.d). La LCD et les lois de propriété intellectuelle sont applicables cumulativement lorsqu'il existe des motifs spécifiques du droit de la concurrence (en l'occurrence, l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié) qui ne se retrouvent pas dans le droit de la propriété intellectuelle (c. 4.e). Un préjudice est difficilement réparable lorsqu'un versement en argent ne permet pas de le compenser complètement ou lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. En droit de la concurrence, une injonction de cesser un acte prononcée au terme d'une procédure ordinaire peut, pratiquement, être sans intérêt pour le lésé; par ailleurs, le dommage est généralement difficile à déterminer, notamment lorsqu'il consiste en une perte de clientèle (c. 4.g). Il ne peut être renoncé à la fourniture de sûretés que lorsqu'il n'y a que de très faibles doutes sur le bien-fondé du droit exercé. À défaut d'autres éléments, le montant de la sûreté peut être fixé en fonction du montant du capital-actions de la requérante (c. 6.b.bb).
sic! 4/2008, p. 295-300, « sergio rossi (fig.) et al. ; Miss Rossi / Rossi (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, similarité des produits ou services,marque connue, risque de confusion ; art. 29 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 57 LPM.
Le nom « Sergio Rossi » n'est pas si connu que la seule manière d'éviter tout risque de confusion soit d'interdire purement et simplement son utilisation à tout homonyme en relation avec des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels il a été enregistré comme marque antérieure. En l'espèce, l'ajout d'une simple ellipse n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion résultant de l'identité des éléments verbaux qui sont prépondérants dans l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque verbale et figurative. S'il y ajoute des éléments distinctifs suffisants pour exclure tout risque de confusion tant direct qu'indirect avec les marques préexistantes, le deuxième venu a la possibilité d'utiliser son nom en relation avec ses produits.
TC JU, 27 juillet 2009, CC 57/2009 (f) (mes. prov.)
sic! 4/2010, p. 279-284, « Willemin » ; mesures provisionnelles, signe distinctif, marque, raison sociale, nom de personne, Willemin, droit au nom, risque de confusion, préjudice irréparable, urgence, proportionnalité ; art. 28c CC, art. 29 CC.
Dès lors qu'un risque de confusion en matière de signes distinctifs est généralement propre à engendrer une perturbation de marché ainsi que d'autres dommages immatériels, la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (c. 3). En cas de conflit entre une marque et une raison sociale incluant un patronyme, le principe du droit au nom n'est pas prééminent, mais une pesée doit être effectuée entre les intérêts en présence (c. 4). L'urgence relative que requiert l'octroi de mesures provisionnelles n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin (c. 6.1). En vertu de l'exigence de proportionnalité à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles, seule l'utilisation de l'élément distinctif à l'origine du risque de confusion doit être interdite et non pas purement et simplement l'usage de la raison sociale contenant cet élément (c. 6.2).
CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)
sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.
Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).
sic! 10/2013, p. 612- 620, « Comparis ; Comparis.ch / www.comparez.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, nom de domaine, contenu d’un site Internet, comparez.ch, risque de confusion nié, exploitation de la réputation, similarité des produits ou services, similarité des signes, domaine de deuxième niveau, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, principe de la spécialité, concurrence déloyale ; art. 2 CC, art. 29 CC, art. 3 LPM, art. 15 LPM, art. 3 LCD.
Sauf en présence d’une marque notoire au sens de l’art. 15 LPM, l’examen du contenu du site Internet est nécessaire pour déterminer le risque de confusion entre un nom de domaine et une marque, vu le principe de la spécialité qui s’applique en droit des marques. Même dans les autres domaines juridiques, il paraît difficile de faire abstraction du contenu du site, dès lors que le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances (c. 4.2.2). Si le public est provisoirement induit en erreur, mais que la méprise peut être corrigée en raison des circonstances – donc aussi en raison du contenu du site – il n’y a pas de risque de confusion, mais éventuellement une exploitation de la réputation d’autrui (c. 4.2.3). Celle-ci implique que l’on utilise un signe comme nom de domaine pour profiter de la renommée d’un tiers et diriger les internautes vers son propre site Internet. Il s’agit d’une notion pertinente en concurrence déloyale, en droit au nom et pour les marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM (c. 4.2.4). En l’espèce, les services commercialisés par les parties sont semblables (c. 4.3.3.2). Pour apprécier la similitude des signes, c’est avant tout le domaine de deuxième niveau qui est déterminant (c. 4.3.3.3.3). En l’espèce, l’élément « compar », qui est commun au nom de domaine litigieux et aux marques protégées, relève du domaine public (c. 4.3.3.3.2). Les internautes savent que le moindre détail a son importance en matière de nom de domaine. Lorsqu’un signe est utilisé exclusivement comme nom de domaine sur Internet, de petites différences par rapport à la marque protégée suffisent à exclure la similitude (c. 4.3.3.3.3). La prononciation des mots « comparez » et « comparis » n’est pas identique (c. 4.3.3.3.5). Le faible caractère distinctif d’une marque peut être accru par la publicité et l’usage de cette marque.Mais cela ne va pas jusqu’à empêcher un tiers d’utiliser des éléments de la marque appartenant au domaine public (c. 4.3.3.4.2). De même, le droit de la concurrence déloyale ne permet pas d’interdire l’utilisation d’une désignation relevant du domaine public selon le droit des marques (c. 4.4.1). Le seul fait d’employer la désignation usuelle « comparez » ne suffit pas à démontrer une exploitation de la réputation d’autrui au sens du droit de la concurrence déloyale (c. 4.4.2.3). [VS]
ATF 140 III 251 ; sic! 9/2014, p. 532-538,
« Croix rouge II » ; JdT 2015 II 203 ; marque combinée, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, services médicaux, service de permanence
médico-chirurgicale, permanence médico-chirurgicale SA, Croix-Rouge, noms
et emblèmes internationaux, revendication de couleur, action en constatation
de la nullité d’une marque, intérêt pour agir, risque de confusion direct, risque
de confusion indirect, valeur litigieuse, force distinctive forte ; art. 28 CC, art. 29
CC, art. 2 lit. d LPM, art. 52 LPM, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 91 CPC.
L’article 7 al. 2 de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (LPENCR) stipule que les marques et les designs « contraires à la présente loi » sont exclus du dépôt. Le projet « Swissness » adopté par le Parlement le 21 juin 2013 prévoit de remplacer cette disposition par le texte suivant qui ne conduira à aucun changement d’ordre matériel : « Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux, ne peuvent être enregistrés comme marques, designs, raisons de commerce, noms d’association ou de fondation, ni comme éléments de ceux-ci » (c. 3.1). L’action en constatation de droit de l’art. 52 LPM peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (c. 5.1). La Croix-Rouge suisse, en tant qu’association au sens de l’art. 60 CC, dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque de la recourante, même si la LPENCR ne lui permet pas de disposer librement de son emblème (c. 5.2). Il est de jurisprudence constante que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix Rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation. La LPENCR interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la Croix Rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque pour les produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix Rouge. Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la LPENCR (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments - par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Le but dans lequel le signe déposé est utilisé est sans importance, tout comme les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme « signe de protection » ou comme « signe indicatif » (c. 5.3.1). L’inscription de la marque au registre des marques tenu par l’IPI n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le Juge civil (c. 5.3.2). En l’espèce, le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la Croix-Rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge. En outre, si l’emblème de la Croix Rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services de permanence médico-chirurgicale, ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la Croix Rouge. L’existence d’un risque de confusion doit être retenue et le moyen tiré de la violation de l’art. 2 lit. d LPM admis (c. 5.3.3). Si la question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée, il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne. Ces dispositions protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (c. 6.2). La Croix Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif ) et le signe utilisé par un tiers et à éviter la perte de force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache. La Croix Rouge suisse est ainsi, en tant qu’association, légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 et 29 CC (c. 6.3). L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom(ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties alors qu’il n’en est rien. Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC) (c. 6.4). La manière dont la marque de la recourante est utilisée donne à penser que la Croix Rouge soutient ses activités et suscite un risque de confusion indirect dans l’esprit du public (c. 6.5). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que la Croix Rouge entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la Cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (CHF 300 000.-), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise bien établie (c. 7). [NT]
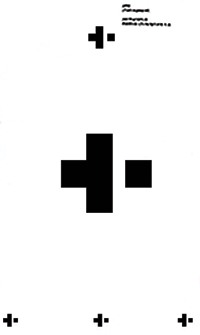
Action, voir ég. cumul d’actions
-- forte
- combinée
-- absolus
Noms et emblèmes internationaux
Permanence médico-chirurgicale SA
-- direct
-- indirect
- de permanence médico-chirurgicale
- médicaux
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 91
- Art. 7
-- al. 2
- Art. 52
- Art. 2
-- lit. d
Pachmann, Bachmann, avocat, activité d’avocat, marque verbale, marque combinée, raison de commerce, contenu sémantique, usage à titre de marque, violation du droit d’être entendu, fardeau de la preuve, fardeau de l’allégation, arbitraire, maxime des débats, risque de confusion, droit au nom ; art. 9 Cst., art. 9 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 29 CC, art. 55 CPC, art. 150 al. 1 CPC, art. 951 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. c LCD.
La notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs et il s’agit d’une question de droit que le TF revoit librement. Comme les sociétés anonymes peuvent choisir librement leurs raisons de commerce, la jurisprudence pose généralement des exigences élevées concernant leur force distinctive. Selon la jurisprudence constante, les raisons de commerce bénéficient d’une protection également à l’encontre des entreprises qui sont actives dans une autre branche du commerce. Mais les exigences concernant la différenciation des raisons de commerce sont plus strictes lorsque les entreprises peuvent entrer en concurrence de par leurs buts statutaires ou s’adressent, pour une autre raison, aux mêmes cercles de clients ; cela vaut aussi en cas de proximité géographique des entreprises. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent auprès du public que doit être tranchée la question de savoir si deux raisons de commerce sont suffisamment différentes pour coexister. Cela doit être vérifié non seulement dans le cadre d’un examen attentif et simultané des raisons de commerce, mais également en fonction du souvenir qu’elles laissent. Lequel est marqué par les éléments des raisons de commerce qui sont frappants de par leur effet sonore ou leur signification. Ces éléments revêtent une importance déterminante dans l’examen de l’impression d’ensemble générée par une raison de commerce. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui bénéficient en général d’une forte force distinctive. Il en va autrement pour les désignations descriptives qui appartiennent au domaine public. Il y a risque de confusion lorsque la raison de commerce d’une entreprise peut être prise pour celle d’une autre ou donne l’impression erronée que les entreprises seraient économiquement ou juridiquement liées (c. 3.1). En l’espèce, la Cour cantonale a retenu que les signes étaient semblables parce qu’ils se différenciaient seulement par leurs premières lettres « P » et « B » mais qu’en dépit de la similitude des domaines d’activité et de la proximité des sièges des deux entreprises, il convenait de tenir compte de ce que leurs raisons de commerce n’étaient pas de pure fantaisie mais reprenaient les noms de famille des avocats qui les exploitent. La Cour cantonale a en outre relevé que les noms de famille sont donnés par la nature et qu’une personne physique a un intérêt digne de protection à pouvoir désigner sous celui-ci les prestations qu’elle, ou les personnes qui sont sous sa responsabilité, dispense. De sorte qu’il existe très peu de possibilités de différenciation. En particulier, lorsque le service offert présente une composante personnelle forte, comme c’est le cas pour l’activité d’avocat. Il n’est par conséquent par possible de transposer sans autre aux noms de famille la portée de la protection accordée aux dénominations de fantaisie. Les noms de famille rares ont ainsi certes une force distinctive accrue, mais la portée de leur champ de protection se limite (sauf circonstances particulières relevant de la loi contre la concurrence déloyale) aux noms de famille identiques et ne s’étend pas à ceux qui sont semblables seulement. Le fait que les raisons de commerce considérées soient construites de la même manière (soit nom de famille – Avocats – SA) n’augmente pas le risque de confusion puisque cette configuration est usuelle. Dans le cas particulier, le fait que la première lettre de chacun des deux noms de famille (à laquelle une attention particulière est accordée parce qu’elle se trouve en début du mot) soit différente (P et B), la manière différente de les écrire et leur effet phonétique différent également, mais surtout le caractère extraordinairement rare de l’un des deux noms de famille et relativement commun de l’autre, ainsi que l’absence de cas de confusion effectif en dépit de la similitude des signes, de la proximité géographique des entreprises, et du caractère pour l’essentiel similaire de leurs activités, excluent l’existence d’un risque de confusion au sens du droit des raisons de commerce (c. 3.2 et c. 3.3.2). Le TF considère que la Cour cantonale a, à juste titre, examiné de manière différente le degré de différenciation nécessaire, selon que la raison de commerce concernée est formée de désignations de personnes, de désignations descriptives ou de désignations de fantaisie. Les éléments désignant l’activité professionnelle déployée (avocats) ainsi que la forme juridique (SA) constituent des éléments à faible force distinctive des raisons de commerce examinées. Le risque de confusion doit ainsi être déterminé en fonction des deux noms de famille « Pachmann » et « Bachmann » qui se différencient par leur première lettre qui joue un rôle marquant, parce qu’elle figure au début des dénominations considérées. Du point de vue du contenu sémantique, le public suisse ne décèle pas dans les termes « Pach » une ancienne manière d’écrire « Bach », et il est dès lors irrelevant que « Pachmann » soit la manière d’écrire « Bachmann » en haut allemand. Les jurisprudences « Adax » / « Hadax » et « Pawag » / « Bawag » rendues en relation avec des dénominations de pure fantaisie ne peuvent pas être transposées à l’examen du risque de confusion entre deux noms de famille. Outre la différence entre les premières lettres des deux noms, le caractère extraordinairement rare du nom de famille « Pachmann » alors que « Bachmann » est relativement répandu, amène le public usuellement attentif à faire la différence entre les deux raisons de commerce. Un risque de confusion n’entrerait pas non plus en ligne de compte si une force distinctive accrue devait être reconnue au patronyme « Pachmann » du fait de sa rareté (c. 4). Le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers d’utiliser des signes similaires à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c LPM). Lequel est donné lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude des signes et attribuent les produits, désignés par l’un ou l’autre des signes, au mauvais titulaire de la marque ; ou lorsque le public distingue bien les deux signes mais déduit de leur ressemblance de fausses relations entre leurs titulaires. Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. La question de savoir si deux marques se distinguent suffisamment ou sont au contraire susceptibles d’être confondues ne doit pas être résolue dans le cadre d’une comparaison abstraite des marques considérées, mais doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le risque que des confusions se produisent est élevé, et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. Le champ de protection d’une marque dépend de sa force distinctive. Une marque faible bénéficie d’un champ de protection plus limité contre les signes similaires qu’une marque forte. Lorsqu’une marque s’approche du domaine public, elle ne bénéficie que d’une force distinctive limitée tant qu’elle n’a pas été imposée comme signe distinctif dans l’esprit du public par des efforts publicitaires importants. Des différences modestes suffisent à exclure le risque de confusion en présence d’une marque faible. Constituent des marques faibles, celles dont les éléments essentiels se rapprochent étroitement de termes génériques du langage commun. Sont au contraire des marques fortes celles qui frappent par leur contenu fantaisiste ou qui se sont imposées dans le commerce (c. 4.1). Dans le cas particulier, l’utilisation du terme « Bachmann » sur les cartes de visite intervient bien à titre de marque mais dans une combinaison avec des éléments figuratifs qui en déterminent l’impression d’ensemble. C’est ainsi l’élément « B » qui prédomine de sorte que le cercle des destinataires pertinents qui est composé de personnes cherchant à obtenir des services juridiques, ainsi que des publications ou des imprimés dans le même domaine, ne risque pas d’être induit en erreur, même au cas où il ne déploierait qu’un degré d’attention usuel (c. 4.2). Selon l’art. 2 LCD, un comportement est déloyal et contraire au droit s’il est trompeur ou viole d’une autre manière le principe de la bonne foi dans les affaires et influence les relations entre commerçants et consommateurs. Adopte un comportement déloyal en particulier celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Entrent dans ce cas de figure tous les comportements qui par la création d’un risque de confusion induisent le public en erreur, en particulier afin d’exploiter la réputation d’un concurrent. C’est ainsi en fonction du comportement concrètement adopté sur le plan de la concurrence que doit être tranchée la question de l’existence d’un risque de confusion au sens de la LCD. Si la notion de risque de confusion est la même pour l’ensemble du droit des signes distinctifs, il convient dans la détermination de son existence dans le cadre du droit de la concurrence, de tenir compte de toutes les circonstances. Soit pas seulement de la manière dont le signe est enregistré, mais aussi de celle dont il est concrètement utilisé et des autres éléments en dehors des signes eux-mêmes. C’est ce que la Cour cantonale a fait in casu en examinant comment la marque mixte « Bachmann » était utilisée sur les cartes de visite de l’intimée et en tenant compte du fait que les personnes cherchant à obtenir les services d’un avocat ou d’autres prestations juridiques déploient un degré d’attention supérieur à la moyenne en raison du rapport de confiance particulier qui caractérise la relation entre un avocat et son client, ainsi que des dépenses supérieures à celles de l’acquisition d’un produit de masse qui l’accompagnent (c. 5.2). Le recours est rejeté. [NT]
Handelsgericht BE, 8 janvier 2009, HG 08 31 (d)
sic! 10/2009, p. 717-720, « Verpasste Prozesshandlung » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire au droit en vigueur, droits de la personnalité, usurpation, risque de confusion, risque de tromperie, enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, cession de créance, transfert de droits de propriété intellectuelle, action en radiation d'une marque, action en constatation de la nullité d'une marque, intérêt pour agir, usage de la marque ; art. 29 al. 2 CC, art. 167 CO, art. 2 lit. d LPM, art. 4 LPM, art. 52 LPM, art. 283 ss CPC/BE.
Les dispositions sur la cession de créance ne sont pas applicables au transfert de droits de propriété intellectuelle, car ces droits sont des droits absolus opposables à tous (c. II.1.e). L'action en radiation ou en constatation de la nullité d'une marque requiert un intérêt juridiquement protégé (art. 52 LPM), lequel ne doit pas répondre à des exigences élevées. Il suffit ainsi que le demandeur soit gêné dans ses activités économiques par la marque en question. Est par ailleurs considéré comme intérêt digne de protection l'intérêt général à ce que le registre soit épuré des marques qui ne remplissent plus les conditions de protection en raison du défaut de leur usage (c. II.2.c). Est nulle une marque portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, en particulier en cas d'usurpation du nom au sens de l'art. 29 al. 2 CC. Une telle usurpation doit être admise lorsqu'elle provoque un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu'elle est propre à induire le public en erreur sur l'existence d'une relation entre le porteur du nom et l'usurpateur. Une telle marque serait nulle dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'un tiers (c. III.2). L'enregistrement d'une marque en faveur d'un utilisateur autorisé (art. 4 LPM) n'est pas réservé aux seuls agents ou représentants, mais est en principe destiné à quiconque est autorisé à utiliser la marque d'un tiers (c. III.7).
Action, voir ég. cumul d’actions
- en faveur d'un utilisateur autorisé
-- absolus
- contraire au droit en vigueur
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 167
Droit cantonal
- CPC/BE
-- Art. 283~ss
- Art. 4
- Art. 52
- Art. 2
-- lit. d
sic! 7/8/2007 p. 543-545, « swiss-life.ch und la-suisse.com» ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, swiss-life.ch, la-suisse.com, risque de confusion, transfert de nom de domaine, action en cession du droit à la marque, for, lieu de consultation ; art. 5 ch. 3 CL, art. 29 al. 2 CC, art. 946 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 53 LPM, art. 55 LPM.
Confirmation de la compétence du tribunal du lieu d'où le nom de domaine peut être consulté et a vocation à toucher le public, ce lieu étant au moins toute la Suisse pour les noms de domaine en .ch. Confirmation aussi de l'examen abstrait du risque de confusion et de l'impossibilité de réduire ce dernier en faisant figurer sur le site des indications visant à informer le consommateur, la confusion intervenant déjà avant, lorsque l'internaute s'oriente dans ses recherches en fonction du nom de domaine et n'a pas encore eu accès au contenu du site. Admission, par analogie avec l'art. 53 LPM, de la possibilité de condamner l'auteur de la violation de la marque à accomplir les actes nécessaires au transfert du nom de domaine auprès de l'autorité d'enregistrement.
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 5
-- ch. 3
- Art. 956
-- al. 2
- Art. 951
-- al. 2
- Art. 946
-- al. 1
- Art. 55
- Art. 53
- Art. 13
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
KG GR, 4 mai 2009, ZFE 08 3 (d)
sic! 1/2010, p. 34-40, « stmoritz.com » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, nom de domaine, stmoritz.com, Suisse, force distinctive, droit au nom, risque de confusion, for, droit applicable ; art. 29 al. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 129 al. 1 LDIP, art. 133 al. 2 LDIP.
Il suffit qu'un nom de domaine soit utilisé pour désigner un site Internet consultable, conformément à sa destination, depuis la Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux du lieu de résultat en Suisse. Comme le résultat se produit en Suisse, le droit suisse est applicable. Du fait de l'attente qu'il suscite chez l'internaute quant à l'offre d'informations, de services ou de marchandises sur le site qu'il désigne, un nom de domaine est, en tant que signe distinctif, comparable à un nom, une raison de commerce ou une marque. Sa fonction distinctive a pour conséquence qu'il doit se différencier suffisamment des signes distinctifs protégés appartenant à des tiers pour éviter tout risque de confusion. Le contenu du site Internet consultable sous le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à exclure un éventuel risque de confusion, de même que les éléments techniques nécessaires à l'adressage sur Internet. La reprise du nom d'une commune sans aucune adjonction est de nature à provoquer un risque de confusion très élevé. L'utilisation pure du nom d'un État ou d'une commune comme nom de domaine suscite chez l'internaute l'attente d'une offre émanant de la collectivité publique en question.
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 133
-- al. 2
- Art. 129
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2 lit. e
- Art. 3
-- al. 1
HG BE, 5 mai 2009, HG 08 36 (d)
sic! 4/2010, p. 274-278, « SMW / www.smw-watch.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, horlogerie, signe déposé, signe descriptif, indication de provenance, nom de domaine, smw-watch.ch, droits conférés par la marque, droit au nom, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale, procédure d’opposition ; art. 29 al. 2 CC, art. 43 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.
Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 43
- Art. 3
-- al. 1 lit. e
-- al. 1 lit. d
- Art. 2
- Art. 55
-- al. 1
- Art. 53
- Art. 3
-- al. 1 lit. c
- Art. 2
-- lit. a
sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.
L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 8
- Art. 2
Conv. CH-D (1892) (RS 0.232.149.136)
- Art. 5
-- ch. 1
- Art. 12
-- al. 3
-- al. 1
- Art. 13
-- al. 2 lit. e
- Art. 4
- Art. 11
-- al. 1
sic! 12/2011, p. 727-730, « Jetfly » ; raison de commerce, société, organe, nom de domaine, jetfly.com, risque de confusion, droit au nom, nom commercial, Jetfly, usage, usurpation, Suisse, Benelux, territorialité, priorité, contrat de licence, droit des marques, action en cessation, arbitraire, renvoi de l’affaire ; art. 29 al. 2 CC.
La recourante no 2, active en Suisse, étant sa filiale, la recourante no 1 — société mère — peut invoquer la protection de son nom en Suisse (c. 5.2). Le nom de domaine « jetfly.com » exploité par l'intimée, active dans le même secteur commercial que les recourantes, reprend textuellement la partie principale du nom des recourantes. Le critère de la protection géographique est réalisé à l'échelle européenne, étant donné la spécificité du domaine d'activité des sociétés en cause. Il y a donc un risque de confusion entre le nom de domaine « jetfly.com » et le nom commercial des recourantes de sorte qu'elles sont lésées par cette usurpation (c. 6.2). En raison du principe de la territorialité, l'intimée ne peut pas se prévaloir en Suisse d'un droit de priorité résultant d'un contrat de licence limité au Benelux (c. 7.2). Ayant utilisé le nom « Jetfly » dans la vie commerciale en Suisse dès 2004 alors que la marque « Jetfly » n'a été enregistrée par B. SA qu'en 2006, les recourantes bénéficient d'un droit de priorité. C'est ainsi à tort que l'autorité inférieure a nié aux recourantes la possibilité de se prévaloir en Suisse de ce droit au nom commercial acquis par l'usage et donc indépendant de la marque. L'action en cessation de trouble (art. 29 al. 2 CC) est donc bien fondée (c. 8). En niant à tort que les recourantes ont allégué que l'intimée a exercé une activité en Suisse, l'autorité inférieure a versé dans l'arbitraire. La cause lui est donc renvoyée afin qu'elle détermine si les actes de l'intimée en tant qu'organe fondent une activité de l'intimé en Suisse (c. 9.2).
sic! 5/2013, p. 300- 304, « Tara Jarmon » ; marque verbale, enseigne, raison de commerce, Tara Jarmon, Tarjarmo, risque de confusion admis, action en dommages-intérêts, acte illicite, faute, dommage, preuve, dilution de la force distinctive, gain manqué, contrat de licence, contrat de franchise ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 84 al. 1 CO, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 3 LCD ; cf. N 735
(TF, 6 février 2013, 4A_460/2012 ; arrêt du TF dans cette affaire).Tant la LPM (art. 55 al. 2 LPM) que la LCD (art. 9 al. 3 LCD), ou encore les dispositions sur le droit au nom (art. 29 al. 2 CC), réservent l’art. 41 CO concernant la réparation des dommages subis du fait de leur violation (c. VII.d). L’acte illicite résulte en l’espèce du risque de confusion entre la raison de commerce de la défenderesse et la marque de la demanderesse (c. VII.b.a qui renvoie au c. V.c). En continuant d’exploiter une boutique à l’enseigne « Tara Jarmon », alors qu’aucun contrat n’était conclu avec les titulaires de la marque correspondante, et en créant une société dont la raison sociale « Tarjarmo » ressemble à cette marque, les défenderesses ont commis une faute (c. VII.b.b). L’utilisation abusive de l’enseigne « Tara Jarmon », ainsi que de la raison sociale « Tarjarmo » par les défenderesses est propre à faire naître un risque de confusion en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par les demanderesses (c. VII.b.c). Le dommage peut consister en une réduction d’actifs, un accroissement des passifs ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre l’état du patrimoine après la survenance de l’événement dommageable, et l’état dans lequel ce patrimoine aurait été sans cet événement. Concernant la preuve du dommage conformément à l’art. 8 CC, il ne saurait être exigé du lésé davantage que d’alléguer et d’établir toutes les circonstances démontrant la survenance d’un dommage et permettant de l’évaluer dans les limites de ses possibilités et de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui. Si le lésé ne réussit pas à établir la preuve du montant du dommage, le juge doit déterminer équitablement, en considération du cours ordinaire des choses, l’étendue, mais également l’existence du dommage. La perturbation du marché et la dilution du caractère distinctif de la marque sont des éléments que le juge prend en compte dans son appréciation, respectivement sa détermination, du dommage. En l’espèce, l’utilisation de la marque « Tara Jarmon » par les défenderesses, alors qu’elles n’y étaient pas autorisées, a empêché les demanderesses d’accorder à des tiers l’autorisation d’ouvrir et d’exploiter une boutique « Tara Jarmon » à Genève et les a empêchées de poursuivre leur utilisation de cette marque en cette ville. Le manque à gagner ainsi subi par les demanderesses doit être calculé en fonction de la marge brute moyenne annuelle réalisée par les défenderesses lorsqu’elles étaient autorisées à utiliser la marque à Genève (soit pendant les années 2000 à 2003). Les frais d’une campagne publicitaire liée à l’ouverture d’une nouvelle boutique « Tara Jarmon » autorisée par les demanderesses, plus de trois ans après que l’usage abusif par les défenderesses ait cessé, ne peuvent pas être uniquement mis en relation avec cette utilisation abusive de la marque. Seul le remboursement d’une partie de ceux-ci (10 000 francs) peut ainsi être alloué aux demanderesses en application de l’art. 42 al. 2 CO (c. VII.b.d). En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il convient ainsi de rejeter une conclusion présentée en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère. Dans le cas d’espèce, l’atteinte à la marque a eu lieu en Suisse et la perturbation du public est intervenue sur le marché genevois. Elle doit donc être réparée en francs suisses, alors que le dommage relatif au gain manqué a touché le patrimoine de la demanderesse domiciliée en France et doit être arrêté en Euros, comme le précisaient les conclusions de cette dernière (c. VII.c). [NT]
- Art. 29
-- al. 2
- Art. 8
- Art. 84
-- al. 1
- Art. 42
-- al. 2
- Art. 41
- Art. 9
-- al. 3
- Art. 55
-- al. 2
sic! 12/2012, p. 816-819, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » (Marbach Eugen, Anmerkung) ; raison de commerce, Keytrade AG, Keytrade Bank SA, droit au nom, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, force distinctive faible, impression générale, signe descriptif, réputation ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO.
La force distinctive d’une raison de commerce ne s’évalue pas en fonction de ses éléments pris isolément, mais en rapport avec l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Bien qu’elle se compose d’un élément descriptif (« trade ») renforcé par un élément promotionnel (« Key »), la combinaison de mots « Keytrade » n’est pas un signe faible, mais un néologisme qui ne permet pas de déduire l’activité commerciale ou la nature des produits de l’entreprise qui l’utilise à titre de raison de commerce (c. 3.3.1). La recourante reprend intact l’élément prédominant (« Keytrade ») de la raison de commerce antérieure de l’intimée. Sa propre raison de commerce ne se distingue que par l’ajout des éléments « Bank », « Bruxelles » et « succursale de Genève » qui ne sont pas distinctifs, dès lors qu’ils renvoient directement à l’activité de la recourante, respectivement à l’emplacement de son siège à l’étranger ainsi qu’à son statut de succursale en Suisse. Il y a ainsi un risque de confusion – au moins indirect – entre les raisons de commerce « Keytrade AG » (intimée) et « Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève » (recourante) (c. 3.3.2), indépendamment du fait que leur titulaires soient concurrentes ou non (c. 3.2.2 et 3.3.2). Contrairement à ce qui prévaut en droit des marques, l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce ne se réduit pas au point de vue des acheteurs des produits ou services concernés,mais prend en compte un public plus large incluant notamment les personnes en recherche d’emploi, les autorités ainsi que les services publics (c. 3.3.3). Un risque de confusion constitue à lui se une lésion du droit au nom au sens de l’art. 29 al. 2 CC (c. 4.1). La réputation du signe « Keytrade » à l’étranger ne peut pas être prise en compte dans une procédure en Suisse dès lors que la recourante ne démontre pas que ce signe est connu du public suisse. Il n’y a pas, en l’espèce, de violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 4.2). La modification de la forme graphique d’une raison de commerce n’est pas pertinente dans l’examen d’un risque de confusion : seule est prise en compte l’inscription au registre (c. 5.1). Le recours est rejeté (c. 7). [JD]
Droit de la personnalité, droit au nom, concurrence déloyale, usurpation, risque de confusion admis, nom de domaine, Internet, site Internet, sigle, signe descriptif, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, action en constatation, action en cessation, demande reconventionnelle, banque, canton, lettre ; art. 29 al. 2 CC, art. 292 CP.
La demanderesse est détentrice des noms de domaine « ...-blog.ch », « ...- online.ch » et « ...24.ch », débutant par un sigle identique au sigle de la défenderesse, sur lesquels elle publie principalement des articles financiers. Elle demande qu’il soit constaté qu’elle est titulaire de ces noms de domaine, et qu’elle n’a violé aucun des droits de la défenderesse, une banque cantonale. Cette dernière demande reconventionnellement qu’il soit interdit à la demanderesse d’utiliser son sigle comme élément principal dans le cadre commercial en Suisse, et qu’il lui soit ordonné de lui transférer ces noms de domaine. Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Un sigle peut bénéficier de la protection du droit au nom lorsque le public le perçoit comme un nom. L’existence d’un risque de confusion est décisive pour l’application de l’art. 29 al. 2 CC, également lorsqu’un nom est utilisé comme nom de domaine. Un tel risque existe notamment lorsqu’il y a un danger que des utilisateurs souhaitant visiter la page d’accueil du titulaire du droit au nom aboutissent de manière involontaire sur une autre page (c. 4.1.1). La défenderesse a établi de manière convaincante qu’elle utilise son sigle aux niveaux régional et suprarégional, est qu’elle est connue sous cette désignation. Les banques cantonales, à tout le moins dans la partie germanophone de la Suisse, abrègent leur nom comme la défenderesse le fait depuis plus de dix ans : les deux dernières lettres « KB » signifient « Kantonalbank », et la première ou les deux premières lettres désignent le canton concerné. Le sigle utilisé par la défenderesse est propre à la distinguer des autres sujets de droit. En raison de cette fonction d’individualisation, il jouit de la protection du droit au nom. La banque cantonale bénéficie d’une priorité, puisqu’elle a lancé en 2001 son site web, sur lequel elle utilise son sigle, alors que la demanderesse n’a enregistré les noms de domaines litigieux qu’en octobre 2012 (c. 4.1.3). Ces noms de domaine se composent de deux éléments, soit d’abord le sigle protégé par le droit au nom, puis une désignation d’activité (« blog », « online ») ou un numéro (« 24 »). Dans les trois noms de domaine, le deuxième élément est descriptif, et n’a donc qu’une très faible force distinctive. Ainsi, pour chacun d’entre eux, le sigle est l’élément déterminant pour l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Les deux parties s’adressent au même cercle de destinataires. Le risque que la banque cantonale soit associée à la demanderesse est évident. Les éléments descriptifs présents dans les trois adresses litigieuses renforcent encore l’impression d’une relation avec la banque cantonale. L’adjonction « blog » évoque un portail de nouvelles en ligne, tel que l’offre la banque sur son site. L’adjonction « online » évoque une présence sur Internet, comme l’exerce la banque depuis 2001. L’adjonction « 24 » suggère une accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui est une caractéristique qu’on attend d’une banque cantonale, à tout le moins en ce qui concerne l’accès en ligne. Le fait qu’on puisse relativement facilement reconnaître, après avoir accédé aux sites de la défenderesse, qu’on ne se trouve pas sur le site de la banque, n’est pas décisif. Par l’utilisation des noms de domaines litigieux, la demanderesse lèse de manière illicite les intérêts juridiquement protégés de la défenderesse, en créant un risque de confusion. La demande reconventionnelle est admise. La question de savoir si les actes de la demanderesse constituent aussi des actes de concurrence déloyale peut être laissée ouverte (c. 4.1.5). [SR]
sic! 7-8/2019, p. 436-439, « Riverlake / RiverLake » ; raison de commerce, raison sociale, signe fantaisiste, néologisme, force distinctive moyenne, reprise d’une raison de commerce, terme générique, terme descriptif, droit de la personnalité, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, impression générale, registre du commerce, droit au nom, usurpation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, site Internet, anglais, Riverlake, RiverLake Capital AG, riverlake.com, transport maritime, finance, services financiers ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.
Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (c. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (c. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (c. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public Suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond. La recourante n’explique pas en quoi la décision de l’instance précédente serait disproportionnée, et ne met pas en cause le fondement de la prétention au transfert du nom de domaine (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]
TECTON/DEKTON, droit des marques, droit de la personnalité, droit au nom, raison de commerce, raison sociale, action en constatation de la nullité d’une marque, action en interdiction, motifs d’exclusion relatifs, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des raisons de commerce, élément caractéristique essentiel, élément dominant, degré d’attention légèrement accru, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, service de construction, matériaux de construction, usage de la marque, usage à titre de marque, fait notoire, fardeau de la preuve ; art. 8 CC, art. 29 al. 2 CC, art. 951 al. 1 CO, art. 956 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 151 CPC.
Un risque de confusion existe au sens de l’art. 3 al. 1 LPM lorsqu’un signe plus récent porte atteinte à la force distinctive d’une marque antérieure. Tel est le cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires pertinents soient induits en erreur par la similitude du signe et que les produits ou les services portant l’un ou l’autre des signes soient attribués au mauvais titulaire de la marque (risque de confusion direct) ou au cas où le public fait la différence entre les deux signes, s’il déduit de leur ressemblance l’existence de liens en fait inexistants, en particulier s’il croit y voir des marques de séries qui désignent les différentes lignes de produits de la même entreprise ou de différentes entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect). Pour trancher du risque de confusion entre des marques, c’est l’impression d’ensemble que celles-ci laissent dans le souvenir du consommateur qui est déterminante. Plus un signe s’est imposé de manière forte dans le commerce, plus son champ de protection est large et plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque que des confusions interviennent est élevé et plus le signe le plus récent doit se différencier nettement des signes antérieurs pour bannir tout risque de confusion. La vérification de l’existence d’un tel risque de confusion est une question de droit. Le TF examine ainsi en particulier librement comment a été établi le cercle des destinataires pertinent des produits ou services enregistrés et – pour les biens de consommation courante – comment les destinataires perçoivent le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 2.1). Après l’écoulement du délai de carence de 5 ans de l’art. 12 al. 1 LPM, une marque n’est protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée en relation avec les produits et les services enregistrés (au sens de l’art. 11 al. 1 LPM). L’objet de l’utilisation à titre de marque doit en outre concorder avec l’objet de la protection à titre de marque. La marque doit dès lors fondamentalement être utilisée telle qu’elle est enregistrée puisque ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra déployer l’effet distinctif qui correspond à sa fonction. L’art. 11 al. 2 LPM admet cependant que l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de celle qui est enregistrée suffit pour maintenir le droit. Il convient alors que l’identité du noyau distinctif de la maque qui en détermine l’impression d’ensemble soit conservée et qu’en dépit de l’utilisation différente qui en est faite, le caractère distinctif de la maque demeure. Cela n’est le cas selon la jurisprudence du TF que lorsque le commerce, malgré sa perception des différences, met l’impression d’ensemble dégagée par le signe différent utilisé sur le même plan que celle de la marque enregistrée et voit ainsi encore et toujours la même marque dans la forme utilisée. Il faut donc se demander si le commerce voit dans la forme enregistrée et la forme utilisée un seul et même signe et n’attribue aucun effet distinctif propre aux éléments modifiés, ajoutés ou abandonnés. Les exigences d’identité des signes lorsqu’elles concernent l’élément central (« Kernbereich ») de la marque sont ainsi bien plus élevées que dans le cadre de l’examen d’une confusion. Enfin, l’usage destiné à maintenir le droit ne suppose pas que le titulaire de la marque utilise lui-même le signe en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire selon l’art. 11 al. 3 LPM (c. 2.3.1). Une utilisation de la marque avec des éléments descriptifs additionnels qui ne font pas disparaître l’identité de l’élément caractéristique central de celle-ci, soit in casu le vocable « tecton », vaut usage de la marque, le commerce voyant un seul et même signe entre la marque enregistrée et la forme sous laquelle elle est utilisée. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu’il fasse du marketing, mais uniquement qu’il utilise effectivement sa marque. Ce qui est déterminant est l’existence d’un usage conforme de la marque au sens de l’art. 11 LPM. Il ne saurait être considéré qu’un usage de la marque sur des cartes de visite, la home page du site de la société ou des documents de présentation de celle-ci, sur des véhicules ou des bâtiments ne serait pas sérieux (c. 2.3.1.3). Le cercle des destinataires pertinents pour des travaux de couverture et de construction offerts sous les marques « tecton » et « tecton (fig.) » sont des acheteurs privés et publics du domaine du bâtiment auxquels les prestations du titulaire de la marque sont généralement présentées par un architecte. Aucune des marques litigieuses ne vise exclusivement des professionnels. Du moment que les prestations offertes par le titulaire de ces marques dans le domaine de la construction ne se rapportent pas à des besoins courants, un degré d’attention légèrement accru peut être attendu de leurs destinataires. Il ne suffit toutefois pas à exclure l’existence d’un risque de confusion (c. 2.3.2). Un risque de confusion direct entre les deux signes doit être admis. En effet, ces derniers, respectivement en tout cas leurs éléments caractéristiques essentiels « tecton » et « dekton » sont si semblables tant sur les plans visuel que sonore qu’ils sont susceptibles d’être confondus même par ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention légèrement accru, par exemple en étant perçus comme résultant de simples fautes de frappe. Dans la mesure où des produits semblables sont offerts sous ces désignations, un risque de confusion est sans autre donné, de sorte que le signe le plus récent doit se voir dénier la protection à titre de marque (c. 2.3.3). Il y a similitude entre des services d’une part et des produits d’autre part lorsqu’il existe un lien commercialement usuel entre eux dans le sens où les deux sont typiquement offerts par les mêmes entreprises comme constituant un paquet de prestations unique (c. 2.3.4). Tel est le cas entre des matériaux de construction comme produits de la classe 19, d’une part, et des travaux de construction, de réparation et d’installation en tant que services de la classe 37, d’autre part. Le tout constitue en effet du point de vue de l’acheteur un paquet de prestations cohérent impliquant qu’une similitude soit admise au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 2.3.4.1-2.3.4.5). Selon l’art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits enregistrés. Le titulaire peut, selon l’art. 13 al. 2 LPM ; interdire à des tiers l’usage d’un signe exclu de la protection en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM. L’action en interdiction que le titulaire déduit de l’art. 13 al. 2 LPM découle de son enregistrement au registre des marques et vaut pour toute la Suisse (c. 3). Il en va de même pour la protection de la raison sociale d’une société commerciale (c. 4.4). Une prétention à la protection du nom, selon l’art. 29 al. 2 CC, suppose que le titulaire du nom soit lésé par l’usurpation qu’en fait un tiers. Tel est le cas lorsque cette dernière occasionne un risque de confusion ou de tromperie ou lorsqu’elle est de nature à susciter par une association d’idées dans l’esprit du public l’existence de liens en fait non avérés entre le titulaire du nom et celui qui l’usurpe. Le titulaire peut ainsi être lésé du fait que l’association d’idées suggère une relation qui n’existe pas, que le titulaire n’admet pas et qu’il est raisonnablement fondé à ne pas admettre. Il n’y a pas usurpation seulement en cas de reprise injustifiée de l’entier du nom d’un tiers, mais aussi de l’élément caractéristique essentiel de celui-ci, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (c. 5.2). La portée matérielle et spatiale de la protection du nom se détermine en fonction d’utilisations concrètes de ce nom et de ses répercussions effectives. Comme la portée de la protection du nom dépend de l’activité effectivement déployée sur un certain territoire respectivement, pour ce qui est du risque de confusion, des contacts avec certains adressataires, elle ne peut être déterminée sur la seule base de l’enregistrement au registre du commerce. Si un extrait du registre du commerce est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, il ne permet pas de déterminer si la société exerce bien aussi son activité statutaire au lieu de son siège. Pour admettre une violation du droit au nom, il convient de vérifier dans quelle mesure son titulaire l’utilisait sur le territoire concerné et est par conséquent lésé par l’usurpation dont il se plaint (c. 5.5). Le recours est partiellement admis. [NT]
HG SG, 25 mars 2010, HG.2008.137 (d)
sic! 11/2010, p. 789-794, « Refoderm » (KaiserMarkus, Anmerkung) ; action, action en interdiction, for, nom de domaine, refoderm.ch, Suisse, organe de fait, fondé de procuration, qualité pour défendre, intérêt pour agir, risque de récidive, risque de confusion, droits conférés par la marque, épuisement, importation parallèle, produits cosmétiques, produit périmé, frais et dépens ; art. 55 al. 3 CC, art. 13 al. 2 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 129 al. 2 a LDIP.
Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).
- Art. 55
-- al. 3
- Art. 3
-- al. 1 lit. d
- Art. 129
-- al. 2
- Art. 55
-- al. 1 lit. a
- Art. 13
-- al. 2
HG AG, 21 janvier 2020, HOR.2019.9/ts/ts (d)
« Responsabilité de l’organe d’une association » ; responsabilité, violation des droits de propriété intellectuelle, dommage, preuve du dommage, faute, fixation du dommage, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 55 al. 3 CC, art. 41 CO, art. 10 LDA, art. 35 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 62 al. 2 LDA.
Les organes d’une personne morale sont personnellement responsables de leurs fautes d’après l’art. 55 al. 3 CC. Tel est le cas lorsque le comportement de l’organe remplit les conditions d’une norme de droit matériel concernant la responsabilité. La jurisprudence rendue sous l’aLDA a retenu que la responsabilité personnelle de l’organe était engagée vis-à-vis des tiers en cas d’exécution illicite de musique lors d’une manifestation associative (c. 4.2.2). Lorsqu’un droit de l’auteur selon l’art. 10 al. 1 LDA est violé, des dommages-intérêts peuvent être demandés selon l’art. 62 al. 2 LDA, en relation avec l’art. 41 CO. Comme l’établissement du dommage est fréquemment impossible, la jurisprudence du TF admet un calcul hypothétique du gain manqué selon la méthode de l’analogie avec la licence. Le dommage correspond alors à la redevance hypothétique qui aurait été convenue par des parties raisonnables à un contrat de licence. On peut se référer aux tarifs des sociétés de gestion. La méthode de l’analogie n’est toutefois admissible, selon le TF, que s’il s’avère qu’un contrat de licence aurait pu être conclu. D’après l’art. 35 LDA, les artistes interprètes ont une prétention en paiement lorsque des phonogrammes disponibles sur la marché sont utilisés, notamment à des fins de représentation. Il s’agit cependant d’un droit à rémunération légal, qui n’est pas soumis aux conditions de l’art. 41 CO (c. 5.2.1). D’après l’art. 51 al. 1 LDA et le tarif commun Hb, les organisateurs de manifestations récréatives avec de la musique doivent renseigner les sociétés de gestion. Les informations nécessaires sont à fournir dans les 30 jours, sinon les données peuvent être estimées par SUISA. En outre, le tarif commun Hb prévoit que la redevance peut être doublée lorsque la musique est utilisée sans autorisation ou lorsque l’utilisateur fournit des données fausses ou lacunaires afin de se procurer un avantage indû. Si l’utilisateur ne communique toujours pas les informations nécessaires, par écrit, dans les 30 jours suivant l’estimation, celle-ci est alors considérée comme reconnue (c. 5.2.2). Les tarifs des sociétés de gestion sont contraignants pour les tribunaux civils, sauf s’ils sont contraires à des dispositions légales impératives (c. 5.2.3). En l’espèce, des exécutions publiques de musique ont eu lieu sans que l’organisateur n’ait requis d’autorisation. Il y a donc une violation de l’art. 10 LDA et ainsi une illicéité par rapport au dommage causé. Le rapport de causalité entre les exécutions musicales et le dommage existe également. En ce qui concerne la faute, une personne raisonnable idéale qui organise chaque année une manifestation réunissant environ 1'000 personnes doit se préoccuper des exigences réglementaires. Une prolongation de l’heure normale de fermeture peut ainsi être nécessaire, de même qu’une patente ou un dispositif de sécurité. En effectuant de telles recherches, le défendeur aurait constaté l’obligation d’annoncer la manifestation à la demanderesse et de requérir une licence. Sa faute doit donc être reconnue (c. 5.3.1.2). Le défendeur a agi comme organe au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a violé l’art. 10 LDA. Le dommage subi par la demanderesse est ainsi intervenu illicitement et l’exigence du rapport de causalité est remplie. En outre, le défendeur est en faute car il ne s’est pas suffisamment préoccupé des aspects réglementaires et n’a pas satisfait aux exigences de la demanderesse. Il répond ainsi personnellement et solidairement de la violation du droit d’auteur (c. 5.3.1.3). En revanche, l’art. 35 LDA prévoit une licence légale et n’est pas une norme qui justifierait une responsabilité solidaire et personnelle du défendeur en tant qu’organe. Seule l’association organisatrice est responsable du paiement de la redevance découlant du droit à rémunération (c. 5.3.2). Le dommage doit être calculé selon la méthode de l’analogie avec la licence. Il n’apparaît pas que le tarif commun Hb soit contraire à la loi. En particulier, le doublement de la redevance qu’il prévoit en l’absence d’autorisation a été admis par le TF, comme peine conventionnelle de droit privé. Puisque le défendeur, en tant qu’organe, a violé son devoir d’information vis-à-vis de la demanderesse, celle-ci était en droit de procéder à une estimation. Le tarif prescrit en outre un supplément de CHF 40.- lorsqu’aucune liste des morceaux exécutés n’est remise à la demanderesse. Mais seule la moitié de ce montant peut être ajoutée à la créance en réparation du dommage pour violation du droit d’auteur, l’autre moitié concernant la créance basée sur l’art. 35 LDA pour les droits voisins (c. 5.3.3). [VS]
- d'informer les sociétés de gestion
- contraignant pour les tribunaux
- Art. 55
-- al. 3
- Art. 41
- Art. 35
- Art. 59
-- al. 3
- Art. 51
-- al. 1
- Art. 62
-- al. 2
- Art. 10